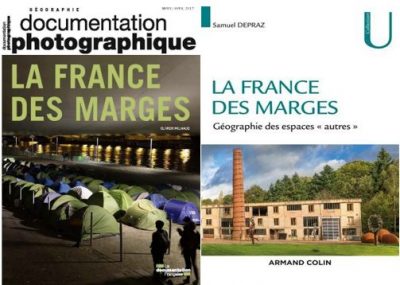Compte-rendu de la matinée « France des marges » avec Samuel DEPRAZ (Université de Lyon / Jean Moulin-Lyon 3) et Olivier MILHAUD (Sorbonne Université, Paris) organisée à l’Institut de géographie de Paris, samedi 3 février 2018.
En guise d’introduction à la séance, Elisabeth Bonnet-Pineau rappelle à quel point le modèle « centre-périphérie » théorisé par Alain Reynaud dans son ouvrage « Société, espace et justice » paru en 1981, et étayé sur des critères principalement économiques, a fait les beaux jours de la géographie. Une application du modèle est d’ailleurs illustrée à l’échelle départementale par une carte de la France selon des données INSEE 2014 (p. 20 dans l’ouvrage de Samuel Depraz, La France des marges, Géographie des espaces « autres », Armand Colin, 2017).
Pourtant, penser en termes de marges impose de prendre de la distance par-rapport à ce modèle, c’est-à-dire par-rapport au centre et à la norme dominante. La distinction centre/périphérie/marges a été introduite au tournant du XXIe siècle, notamment par Christiane Rolland-May qui a dressé un tableau comparatif des trois concepts en soulignant leurs propriétés respectives (Tableau p. 22 dans l’ouvrage de Samuel Depraz). On lira aussi avec profit Antoine Bailly et Brigitte Prost sur ce sujet.
Le vocabulaire de marges a certes été utilisé auparavant en géographie physique, en lien avec l’étude de l’expansion des fonds océaniques – des marges passives sont distinguées des marges actives. Mais le concept de « marge » a ensuite été repris par les sciences sociales et largement enrichi.
Olivier Milhaud, maître de conférences à Sorbonne Université, et auteur d’un numéro de la Documentation photographique sur La France des marges (2017) et Samuel Depraz, maître de conférences à l’Université de Lyon et auteur de l’ouvrage déjà mentionné paru chez Armand Colin en 2017, déclinent un ensemble d’analyses complémentaires sur ce thème proposé aux concours du Capes et des agrégations externes d’histoire et de géographie.
Définir la marge : inviter au décentrement
Olivier Milhaud commence par une première définition de la marge : « un espace excentré et excentrique », ce qui permet d’embrasser la relation au centre comme la relation à la norme. Néanmoins, cette définition présente l’inconvénient de n’être pas assez restrictive. Tout est excentré à une échelle qui le dépasse (Paris par rapport à Berlin, New York ou Shanghai), et tout peut paraître excentrique pour qui le considère.
Samuel Depraz propose quant à lui une définition opératoire qui définit la marge comme un « écart » par rapport à un centre et à sa norme, « écart » étant ici moins spatial que social : ceci permet d’évacuer le rapport d’infériorité économique que l’on retrouve avec les périphéries. Il est plus pertinent de mettre en avant la différence que représentent les marges : la marge est un « espace autre ». La marge relève plus d’une construction sociale, car les différences sont construites socialement. Insister sur la différence évite de tomber dans le misérabilisme, qui est si tentant quand on traite des marges, rappelle Olivier Milhaud.
Samuel Depraz continue par une rapide mise au point épistémologique. La géographie a bénéficié d’une « relégitimation », grâce au spatial turn, ce tournant spatial qui a saisi bon nombre de sciences sociales depuis la fin des grands récits et la réaffirmation de l’espace dans les théories sociales. Après avoir obéi à une pensée temporelle du développement, qui toucherait graduellement l’ensemble de la planète selon une même trajectoire (les pays développés étant en avance, les pays sous-développés en retard), la géographie a perdu à la faveur de la post-modernité son obsession pour le structuralisme et l’objectivité universalisante. L’entrée dans la post-modernité a mené à une remise en cause des catégories habituelles et à une prise de conscience plus affirmée de la construction sociale des réalités. C’est dans le cadre de cette transformation épistémologique qu’il faut penser la notion de marge. La notion de marge est plus fluide que celle de périphérie. Il faut sortir du prétendu modèle, où la périphérie se réduit trop souvent au faire valoir d’un centre… Il faut résolument opter pour le décentrement, ne plus penser la France depuis ses cœurs métropolitains ou économiques, mais la penser depuis ses marges.
Les espaces de marge donnent lieu à des représentations puissantes, souvent négatives (l’abandon, la friche, le territoire en attente…). Il faut se départir des grilles de la modernité – à commencer par celles de la colonisation quand on aborde l’Outre-mer. Si l’on considère les anciennes colonies comme des territoires propres et que l’on opère un retour sur les politiques menées par l’Etat français, on constate que l’Outre-mer est trop souvent considérée comme une simple marge éloignée de la métropole. Or ces territoires peuvent être porteurs de dynamiques très originales et ils connaissent des transformations accélérées.
Olivier Milhaud mentionne aussi l’exemple de « la jungle de Calais », bel exemple de construction sociale : une « verrue » dans le système migratoire européen, un « abcès de fixation » sur les routes migratoires, une « zone de non-droit », alors même que les spécialistes de sciences sociales travaillant là-bas s’émerveillaient de la vie urbaine qui s’inventait spontanément dans cette « jungle », qui avait ses quartiers, ses restaurants, ses écoles, tout une véritable vie urbaine, pleinement urbaine. Un mode de vie original s’y est inventé, mode de vie précaire certes, et s’inscrivant à l’écart du modèle de la ville française avec son conseil municipal, son clocher et sa mairie.
En quoi la marge est-elle aussi un concept spatial ?
Olivier Milhaud invite à porter des regards différents sur les lieux en marge et les populations peu visibles. Les populations dites « non-sédentaires » qui habitent sur les bords d’autoroute ou les aires d’accueil des gens du voyage, et qui recréent au quotidien des repères de vie inscrits dans leur environnement immédiat, éclairent en réalité la sédentarité profonde de notre société, sédentarité que l’on croit à tort dissoute dans les discours sur la multi-résidence ou le tourisme et les injonctions à la mobilité (sociale, professionnelle, géographique).
Prenons aussi des pratiques marginales, pas spécialement le fait de populations marginales, mais qui recèlent toute une nouvelle géographie. L’exemple du commerce équitable, certes ultra-minoritaire, offre le mérite de faire prendre conscience au consommateur que ce qu’il achète ici, dans son magasin, a un impact direct là-bas, en termes de conditions sociales et de rémunération des travailleurs. Les échelles sont plurielles (le local, le global). Le comportement marginal éclaire des représentations et des pratiques originales de l’espace.
Samuel Depraz rappelle que l’étude de la France des marges que mènent les géographes porte assurément sur l’espace. Mais en quoi la géographie peut-elle parler en propre de la marginalité, comment peut-on passer de la marginalité (sociale) à la marge (spatiale) ? Il faut d’abord distinguer la marginalité subie de la marginalité choisie, afin de ne pas mélanger des propos qui vont définir très différemment les espaces en marge : une prison n’est pas une gated community, la zone cœur d’un parc national n’est pas un ghetto urbain connaissant de graves dysfonctionnements sociaux. Cependant, en grande majorité, c’est tout de même la contrainte qui, à des degrés divers, alimente la production d’espaces marginaux.
De ce fait, pour bien ancrer spatialement la réflexion, il faut envisager la marge (spatiale) comme un révélateur de marginalité (sociale), c’est-à-dire comme une inscription des processus de domination dans l’espace. Ainsi, l’espace peut rendre visible voire accentuer la marginalisation, à l’image des zonages de la carte scolaire qui participent bien souvent à accroître la ségrégation scolaire contre laquelle cet outil entendait lutter.
De même, les banlieues françaises, bien souvent érigées en archétypes de la marginalisation par la relégation de groupes sociaux minoritaires loin des centres urbains, ne sont pas produites par cette localisation éloignée. Elles résultent d’abord d’un choix politique (résorber la pénurie de logements de l’après-guerre et du baby-boom, développer le segment locatif social) et d’un dysfonctionnement social (absence de mixité sociale, déficit d’urbanité). La marginalité est alors rendue visible par certaines formes du bâti (les grands ensembles) et accentuée par des éléments de l’espace : coupures urbaines, voies de communication, etc. Cependant, il s’agit bien d’abord d’un produit social qui s’inscrit de manière caractéristique dans l’espace.
Olivier Milhaud renvoie quant à lui à la Documentation photographique et à l’exemple de la Guyane qui lui sert d’introduction : l’éloignement, les populations autochtones, les espèces endémiques, la masse forestière, le climat équatorial, la pauvreté, tout semble faire marge. Mais l’introduction se poursuit avec l’exemple d’une personne sans domicile installée près de La Sorbonne, à Paris, sur une plaque d’aération qui souffle un air chaud si appréciable par temps froid, à proximité du CROUS et de toilettes publiques, dans un lieu de passage d’étudiants et de touristes qui donnent volontiers. L’espace est tout à fait central, sa pratique spatiale d’ultra-sédentarité (il ne quitte jamais son territoire par peur du vol de ses rares affaires) et de vie dehors est assurément marginale, néanmoins, pour le reste, ses autres pratiques spatiales sont tout à fait dans la norme : pensons à la façon dont il étale ses affaires sur le trottoir pour se ménager un espace, personne n’osant marcher au milieu de ses maigres réserves de nourriture ou sur son duvet. Ce processus de territorialisation n’est pas si marginal que cela dans l’espèce humaine, bien au contraire !
La marge, une question politique ?
La France des marges est une question éminemment politique : faire la géographie de la France à partir d’espaces qui dérogent à la norme commune, qui s’écartent de la République unificatrice est une approche très délicate à mener. On comprend mieux la prudence du jury de l’agrégation interne qui a tout bonnement refusé de mettre la question au programme d’un concours qui s’adresse pourtant à des professeurs en exercice !
Pour Samuel Depraz, il faut pourtant réconcilier les marges avec l’étude de la géographie de la France, et réincorporer ces territoires dans les discours et les programmes d’enseignement du secondaire. C’est un réel enrichissement, et une manière de renouveler la géographie nationale, voire de « refaire de la géographie », comme le proposent les deux auteurs. De fait, la marge ne doit pas faire peur ; elle n’est pas un espace totalement sauvage ou exotique, ni une « géographie en négatif » comme le disait Brigitte Prost : elle parle d’une autre manière de se comporter dans l’espace, d’une autre civilité. Dans les squats ou les ZAD par exemple, la vie est extrêmement normée – certes par des pratiques alternatives, mais néanmoins organisées ; l’espace y est également bien contrôlé et surveillé, ne serait-ce que par crainte des descentes de police. On y découvre un autre rapport à l’espace, mais il y a bien un ordre social.
On mesure alors toute l’utilité de la géographie lorsqu’elle permet de mettre à jour les différences sociales à travers les espaces dans lesquels ces dernières s’inscrivent, et qu’elle s’interroge sur la justice spatiale. Bien sûr, toute différence n’est pas une inégalité, et toute inégalité n’est pas une injustice ; mais en filigrane est alors utilement rappelée la question de l’équité dans l’exercice des droits de chaque citoyen face à un modèle républicain qui revendique l’égalité.
Trois exemples : l’hyper-ruralité, le handicap, l’Outre-mer
En prenant l’exemple des espaces ruraux de la très basse densité, parfois nommés « hyper-ruraux », on peut se demander comment réussir à articuler les revendications de la part des représentants de ces territoires avec la tendance contemporaine à la métropolisation de l’économie et du peuplement, mais aussi avec le principe d’égalité républicaine. Cette marge est – par excellence – socialement construite, elle est même ici revendiquée pour chercher à obtenir des aides spécifiques et des mesures de soutien aux services publics (cf. le rapport sénatorial Bertrand, 2014). Mais que permet de dire cette marge « hyper-rurale » ?
Elle cherche d’abord à aller à l’encontre d’une grande méconnaissance du milieu rural, uniformément portraituré comme en déprise, menacé par la désertification médicale et commerciale… Or la reprise démographique existe bel et bien dans les marges rurales, y compris dans des espaces de très basses densités. La « diagonale du vide » est désormais un concept obsolète, précisément marqué par une approche centre-périphérie. Plus encore, il se produit un certain enrichissement dans le rural, alors que les revenus issus de l’économie productive (agriculture, industrie rurale) sont en déclin constant et que l’accès aux services y demeure problématique. La circulation des richesses, l’arrivée de néo-ruraux (résidents secondaires et étrangers, jeunes retraités, touristes, etc.) et le développement de l’économie résidentielle en font en réalité un espace d’innovation et de croissance. Bien sûr, quelques cantons ruraux sont toujours en déprise – mais ce n’est plus la tendance de fond, alors que ce sont les villes qui, pour certaines, connaissent désormais la décroissance (« villes rétrécissantes », « exode urbain »). Olivier Milhaud renvoie d’ailleurs à la carte de l’hyperruralité de l’ouvrage de Samuel Depraz (p. 141) qui montre bien qu’il n’y a pas du tout de corrélation automatique entre bassins de vie hyper-ruraux et espaces en déprise démographique.
En réalité, les espaces ruraux offrent une grande diversité que l’agenda politique ne prend pas en compte. L’égalitarisme reste la norme, lorsque c’est un principe d’équité républicaine qui devrait prévaloir : ce principe suppose au contraire d’admettre de sur-doter certains territoires et de poursuivre la maximisation du minimum pour les territoires les plus marginalisés, afin que tout citoyen ait les mêmes possibilités d’accès aux services et d’exercice de ses droits et devoirs républicains.
Il convient de changer de logiciel politique, mais aussi de représentations sociales. Une planche sur le handicap dans la Documentation photographique, qui montre une publicité de l’Association des Paralysés de France, avec une boulangerie accessible seulement en franchissant une marche dans l’entrée (« dites clairement que vous ne voulez pas de nous. Supprimons les obstacles qui paralysent ») renverse la perspective : le handicap n’est pas seulement un processus biologique de la personne atteinte, il est aussi aggravé par la société et produit par l’espace de vie où l’on prend bien peu en compte les personnes à mobilité réduite. Mais il y a la marge de la marge : tous les handicaps non visibles ! Les personnes en fauteuil ne représentent que 5% des personnes handicapées de France. Faut-il penser normalisation/uniformisation de l’espace (rampes d’accès et ascenseurs larges partout), donc suppression des marges, ou adaptations spatiales fines (sonnette pour personnes en fauteuil devant l’entrée pour que le commerçant vienne servir le client sans forcément adapter tous les commerces) ?
Le logiciel politique et géographique est aussi à revoir pour l’Outre-mer, question piégée s’il en est. Samuel Depraz rappelle combien les manques sont bien plus des conséquences de processus socialement construits que des causes. Plutôt que de commencer classiquement par l’éloignement de ces territoires vis-à-vis de la métropole, ou par les risques « naturels » de ces terres surtout tropicales, et de prêter le flanc à une explication de la marge par le déterminisme de la distance, Samuel Depraz a choisi de lire les auteurs locaux, écrivains, sociologues et anthropologues, ce qui facilite le décentrement du regard. Ensuite seulement, on en vient aux statistiques. Sous cet angle, ce n’est pas l’espace ou ses contraintes climatiques qui produisent la marge, ni la mer qui crée la distance. Saint-Barthélemy n’est pas vraiment une île marginalisée, par exemple. C’est d’abord l’asymétrie de la relation à la métropole et la pauvreté entretenue par un système local oligarchique qui font la marge. Dans la plupart des DROM (Départements et régions d’Outre-mer), on est passé d’une économie de plantations et d’esclavage à une logique d’import/export qui permet à une élite de se nourrir de la dépendance à la métropole par une agriculture commerciale subventionnée et un monopole sur les produits importés. Plutôt qu’une production spatiale, on a bien affaire à toute une production sociale de la marge.
Comment en sortir ? En repérant les atouts de l’Outre-mer, qui nous force à voir la France autrement, rappelle Olivier Milhaud. On a là un fonctionnement différent par rapport à la norme républicaine : Samuel Depraz rappelle l’importance de la coutume à Wallis et Futuna, l’adaptation locale à l’héritage du droit coranique à Mayotte, l’inventivité institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, etc. Dans ces territoires ouverts, on a aussi une hybridation fertile avec chaque contexte régional : antillais, africain ou océanien.
Certes, depuis le début des années 2000, l’État a développé un certain gradualisme des statuts politiques de l’Outre-mer. Il faut une nécessaire adaptation de la loi nationale pour se conformer aux trajectoires différenciées. Olivier Milhaud s’étonne pourtant de l’incapacité française à s’adapter à la mondialisation, alors même que l’Outre-mer nous offre toutes les ressources pour comprendre le monde dans sa diversité. La Guyane fait du Brésil le premier voisin en linéaire frontalier terrestre de la France. La Nouvelle-Calédonie fait de même avec l’Australie pour le linéaire frontalier maritime. Les DROM nous placent sur tous les continents ou presque (Asie) dans des forums régionaux où dialoguer avec le monde. La Martinique ou la Guadeloupe nous montrent que la France peut exister avec l’euro mais sans Schengen, la Polynésie que la France existe déjà hors de l’euro et hors de l’Union européenne ! Ce n’est pas forcément une destinée à souhaiter pour la France entière, mais cela montre qu’il faut renouveler nos imaginaires géographiques.
Questions de la salle
Le débat a d’abord permis de revenir sur la distinction entre « marges » et « confins ». Ce dernier terme, d’essence historique, est à rapprocher de l’idée de « marche » d’un pays : le terme de « confins » connote la distance kilométrique au centre, et désigne surtout des espaces frontaliers – l’étymologie renvoyant également à l’idée de voisinage.
Une question sur les zones à défendre (ZAD) a permis ensuite à Samuel Depraz de montrer comment des mouvements sociaux s’approprient des territoires marginaux. Les militants des ZAD ont réussi à politiser l’espace en-dehors des processus de la démocratie représentative : c’est là encore un moyen de la part de groupes sociaux minoritaires et alternatifs de rendre visible leur marginalité et de tenter d’équilibrer le débat politique par le recours à une arme « spatiale » qui les survalorise. Va-t-on, dès lors, évoluer vers une banalisation des ZAD ? La contestation est cristallisée en un petit nombre de lieux, même si beaucoup de ZAD sont peu connues et peu médiatisées. Leur banalisation en émousserait sans doute l’efficacité médiatique. À l’inverse, lorsqu’elles sont très visibles, les ZAD forcent le débat public : il est intéressant de voir que le discours du Premier Ministre, Edouard Philippe, renonçant à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, a lui aussi pris un tour fortement spatial en étant éminemment géographique et multi-scalaire. L’espace est ici, par excellence, le révélateur des luttes de domination.
Le motif de la lamentation, souvent prédominant sur les espaces en marge, éclipse-t-il toute dynamique positive ? Rappelons d’abord que certains textes développent intentionnellement cette tonalité négative, comme celui de Sylvain Tesson, Sur les chemins noirs (voir Documentation photographique), qui propose un discours romantique et nostalgique sur les marges délaissées, confondant nature et ruralité : on est dans le registre littéraire, dans l’émotion, et non dans l’analyse géographique. Existe-t-il pour autant un développement endogène dans les marges ? Parfois oui, mais pas partout, loin de là, car le modèle du développement endogène ne peut pas s’appliquer sur tous types de territoires, sur les moins fragiles surtout. Cela tient surtout aux personnes, à l’engagement d’acteurs locaux. L’innovation dans les marges doit peu à l’action publique, qui s’y épuise, et encore moins au secteur privé, faute de grande rentabilité. Elle repose plutôt sur des solutions hybrides, notamment dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, l’action associative. C’est une innovation souvent discrète, développée à l’échelle locale.
Le périurbain, qui cristallise bon nombre de discours négatifs, est-il vraiment une marge ? Rappelons que ces campagnes proches des villes sont, en moyenne, l’espace le plus riche du territoire national, tout en connaissant des taux de chômage minima (sachant que le fait d’avoir un emploi en ville est un critère de détermination des couronnes périurbaines). De ce fait, il est vrai que les périurbains semblent être ceux qui ont choisi de vivre dans l’entre-soi des lotissements, qui polluent avec leur recours systématique à la voiture, qui contribuent à l’étalement des villes et donc à l’artificialisation des sols, etc. À l’autre bout du spectre, on y trouve aussi des situations contraintes avec les « captifs du périurbain », qui sont bloqués par des remboursements d’emprunts immobilier et des coûts de transport mal anticipés : c’est donc une marge choisie et une marge subie à la fois.
Pour autant, le portrait de ces territoires doit être plus nuancé. La rencontre avec l’altérité ne se vit pas qu’en ville, tandis que les citadins qui prennent plus souvent l’avion que les périurbains détériorent leur bilan carbone eux aussi. Et si domine une difficulté pour le politique à imaginer le fonctionnement de tels espaces résidentiels, comme leur accès aux services, rappelons que le périurbain ne se réduit pas aux lotissements, et que beaucoup de périurbains ne vont pas travailler dans le pôle urbain le plus proche ! Beaucoup ne sont pas sous la dépendance de la ville. Les géographes ne seraient-ils pas prisonniers de leurs propres représentations ? Bien sûr qu’on observe une destruction des espaces naturels au fur et à mesure de l’extension périurbaine. Mais si 40% de la population active se déplace vers un lieu d’emploi urbain (seuil statistique retenu par l’INSEE pour parler du périurbain), 60% échappent à ce fonctionnement… Il ne faut pas non plus oublier que le périurbain constitue le territoire le plus jeune de France, avec une vie sociale intense, notamment autour des écoles. Ce n’est pas une marge pour tout le monde.
Quant à savoir si on peut produire une carte de la France des marges, la réponse est clairement non. Il faudrait au contraire des cartes multiples, selon les types de marge que l’on souhaite observer. Une carte de synthèse unique, traitant de toutes les marges (ultra-marines, naturelles, rurales, périurbaines, banlieusardes, urbaines, etc), est impossible à bâtir car la « marge » n’est pas une catégorie spatiale a priori, mais bien une manière d’aborder l’étude d’un territoire, quel qu’il soit.
De ce fait, certains dans l’assistance s’étonnent que l’on n’ait pas parlé des grands types d’espaces abordés très classiquement dans la géographie (les piémonts, les plateaux, les massifs…). Mais c’est bien parce que la marge impose de faire de la géographie autrement. Pour étudier les marges, il faut d’abord étudier les processus de marginalisation pour ensuite voir quels types d’espace sont concernés. Et même si l’ouvrage de Samuel Depraz semble procéder, chapitre après chapitre, par grandes catégories d’espace posées a priori comme candidates au titre de marge, c’est pour mieux déconstruire ce cliché et entrer dans la diversité des logiques de domination au sein de chacun d’eux.
On ne peut donc pas partir de la montagne, par exemple, puis décréter qu’elle est, ou n’est pas, une marge. Il n’y a rien de plus intégré aux centres métropolitains que les « associats » touristiques des grandes stations de sport d’hiver des Alpes du Nord, où tous les services urbains sont offerts, tout comme l’accessibilité aux moyens de communication les plus variés, tandis que d’autres espaces sont, à l’inverse, toujours soumis à une déprise sociale durable. Il faut au contraire voir ce qui construit certains espaces montagnards comme des espaces marginaux et à quelles échelles spatiales, puisque ce n’est pas le fait montagnard qui provoque la marginalité, mais bien la marginalité qui se révèle à plusieurs degrés d’analyse dans les reliefs. L’étude des marges impose une lecture multiscalaire, des échelles les plus vastes aux échelles les plus fines.
Compte-rendu Elisabeth Bonnet Pineau, Olivier Milhaud et Samuel Depraz