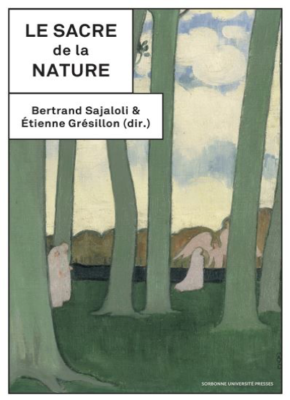
SAJALOLI Bertrand et GRESILLON Etienne (dir.), Le Sacre de la Nature, Paris, Sorbonne Université Presses, 2019
Titre et image de couverture (le détail d’un tableau de Maurice Denis) peuvent tromper le futur lecteur sur la nature de l’ouvrage. Réflexion philosophique, esthétique, religieuse ? C’est aussi cela, mais c’est avant tout un ouvrage collectif dirigé par deux géographes spécialisés dans les relations entre homme et nature, entre religion et écologie.
Le livre paraît après un été caniculaire qui a redonné force et arguments aux mouvements écologistes qui prédisent l’apocalypse, et la consécration de Greta Thunberg comme icone mondiale de la défense planétaire. On pourrait donc évoquer un livre d’actualité. Mais l’objectif de Bertrand Sajaloli et d’Étienne Grésillon est d’appréhender les liens entre nature et sacré dans leur profondeur historique et leur diversité culturelle et géographique. Pour cela ils ont fait appel à plusieurs spécialistes des sciences humaines et même à des théologiens et ont demandé une préface à un historien qui a consacré son travail aux spiritualités médiévales, André Vauchez. Ce dernier définit bien la « nature » comme « construction sociale », mais ni la préface ni l’introduction des deux directeurs de publication ne donnent de définition approfondie des termes « sacré » et « nature »… En fait, il faut les 370 pages de l’ouvrage pour essayer de cerner leur(s) signification(s) dans le temps et dans l’espace.
L’ouvrage qui a réuni les communications de vingt-neuf auteurs, est découpé en trois parties dont la première traite de la place de la nature dans les principales religions et pratiques sacrées. Mais c’est essentiellement le christianisme qui est au cœur de la réflexion, parfois confronté au monde religieux gréco-romain, les autres univers religieux ne sont évoqués qu’incidemment.
Si on peut clairement distinguer une nature, incréée, imprégnée de sacralité chez les Anciens, de la Création biblique fortement anthropocentrique où le sacré est banni du quotidien, les approches de la nature ont varié au sein même de christianisme.
Chez les chrétiens, le courant majoritaire est marqué par la pensée de Saint Thomas d’Aquin qui a repris l’héritage aristotélicien de la raison pour instaurer une coupure nette entre l’homme et la nature. La nature y est seconde dans l’ordre divin. Elle est faite pour l’homme « créé à l’image de Dieu ». C’est cette conception qui inspire, à l’époque moderne, la pensée de Descartes pour qui l’homme est habilité à « se rendre comme maître et possesseur de la nature », pensée au cœur de la culture occidentale, où la désacralisation de l’univers lui a permis de devenir compréhensible à la science.
A cette vision qui demande au chrétien de se retirer du monde, livré au péché, derrière une clôture (monastère) pour se livrer à la méditation, la théologie médiévale a opposé deux autres voies, celle de l’érémitisme dans les premiers siècles de l’Eglise et le franciscanisme à partir du XIIIe siècle. La première fait de la nature le lieu de rencontre avec Dieu. Dans la seconde, l’homme fraternise avec la Création qu’il continue à développer. D’ailleurs le cloître, fermé et n’accueillant qu’un nombre réduit de plantes porteuses d’un symbole biblique, est ouvert dans les monastères franciscains et accueillent un grand nombre de plantes s’y développant librement.
Même si pensée cartésienne de la nature est dominante, la nature sauvage a suscité des inquiétudes. Si aujourd’hui on fait la queue pour se hisser sur l’Everest, la haute montagne a été longtemps considérée comme un lieu maléfique abritant des créatures dangereuses comme les dragons et les fées. Pour P. Joutard, cette malédiction commence à céder la place à une vision positive dès la fin du Moyen Age. Il en voit la preuve dans des textes d’humanistes bernois mais surtout dans la peinture, celle de peintres du nord de l’Europe amenés à traverser les Alpes pour se rendre en Italie. Dans La Vierge au chancelier Rolin de Van Eyck, la barrière montagneuse du dernier plan représenterait soit le Sinaï, lieu de l’alliance entre Dieu et son peuple, soit le Mont Hermon d’où sort le Jourdain, lieu de la transfiguration du Christ. K. Witz, A. Dürer, Bruegel l’Ancien témoigneraient aussi de cette vision positive de la montagne, expression de la bonté divine. Montagne qui n’a été conquise physiquement qu’au XVIIIe siècle.

Jan Van Eyck, La Vierge au chancelier Rolin, vers 1435, Paris, musée du Louvre (détail)
Les éléments naturels, comme les montagnes mais aussi les eaux et les rochers, appréhendés comme éléments spirituels, ont aussi été étudiés par le géographe Elisée Reclus après sa rupture avec le christianisme. Il étudie de nombreux exemples empruntés à la mythologie chrétienne, tel le Mont Ararat où se serait déposée l’Arche de Noé, ou à l’hindouisme consacrant le Gange comme une divinité. Devant la disparition du mystère face à la nature induite par les progrès des sciences, Reclus est nostalgique. Le monde est-il désenchanté ?
Mais en ce début de XXIe siècle, l’idéologie du progrès est renversée au profit de la catastrophe annoncée. Le discours eschatologique des écologistes est lié à l’épuisement des ressources terrestres, ce qui le distingue de la Tradition chrétienne qui définit la fin du monde, non comme sa destruction mais comme le temps du Jugement.
Face à cette vision commune de « crise écologique » mettant en péril l’avenir de l’homme, Teilhard de Chardin et M. Serres dont les convergences sont analysées par H. Brédif, proposent une vision dynamique de la nature façonnée de plus en plus par les humains qui doivent changer leurs habitudes pour créer une symbiose entre la Terre et l’Humanité. Au sein du christianisme plusieurs théologiens insistent sur la nécessité d’un « tournant cosmologique », c’est à dire une nouvelle attention au monde.
La deuxième partie de l’ouvrage traite du « sacré » comme « fabrique du paysage ». Dans son introduction, P. Claval insiste à son tour sur le désenchantement du monde introduit par les monothéismes, limitant le sacré à quelques lieux marqués par la Révélation (Sinaï, La Mecque…), désenchantement accentué par la Réforme protestante. Pourtant cette laïcisation des sociétés occidentales semble récemment bouleversée par de nouvelles formes de croyances (sectes, idéologies…) suscitées en partie par les inquiétudes concernant l’environnement.
Malgré ce propos liminaire sur le désenchantement, quelques articles traitent de lieux dont on ne sait s’il faut les qualifier de « religieux » ou de « sacrés » et qui relèvent des aménagements humains (églises, croix…) plus que de la nature.
Dans l’Occident christianisé, des pratiques très anciennes que les anthropologues font remonter parfois à la Préhistoire se sont maintenues jusqu’à nos jours. C’est le cas de la Corse, christianisée au IVe siècle mais dont certains comportements échappaient à la domination spirituelle de l’Église, comme s’en inquiétait le pape Grégoire VII au XIe siècle. Pour s’implanter le christianisme a dû s’appuyer sur les religiosités pré-chrétiennes et a même été inspiré par ces dernières. C’est le culte des morts qui est à l’origine d’une géographie sacrée dont les points marquants sont les lieux de passage entre les trois mondes définis dans les récits mythiques transmis oralement. Les franchissements entre l’espace terrestre, le monde d’en-haut et le monde du dessous sont signalés par des éléments naturels, rochers, grottes, cours d’eau… ou construits (le « dolmen », dans sa verticalité, assurerait ainsi le lien entre les trois mondes). En fait la présence d’espaces sacrés à l’intérieur de la Corse chrétienne (dans les cimetières par exemple) relève de la superposition de plusieurs strates de religiosité, archaïques puis gréco-romaines. L’Eglise a pris appui sur ces croyances anciennes.
La perception du sacré dans les paysages scandinaves et finnois est d’une tout autre nature et sans doute conviendrait-il mieux de parle de spiritualité plutôt que de sacré. La diffusion de la Réforme au XVIe siècle est à la source d’un rapport rationnel au monde fondé sur l’observation. Les travaux botaniques de Linné puis de Laestadius montrent le souci de comprendre l’organisation de la nature et donc de déchiffrer la logique divine de la Création. Mais dans l’Europe des nationalités du XIXe siècle, Norvégiens, Danois, Suédois et Finnois dont les histoires se sont entrecroisées, cherchent à affirmer une identité justifiant leur revendication d’indépendance. Le paysage a joué ce rôle de marqueur identitaire, tel que peint par de nombreux artistes de la fin du siècle. Austères paysages agricoles au Danemark, montagnes et cascades norvégiennes, forêts et lacs finlandais…acquièrent une valeur spirituelle. Le Sublime transcendant le Beau relève-t-il du domaine du sacré ? Cette exaltation de la nature témoigne aussi de la résurgence d’un panthéisme ancien.
Trois articles sont consacrés à l’Antiquité préchrétienne, l’un à l’Égypte du IIIe millénaire, les deux autres à des cités grecques du Ier millénaire avant J.-C.
Dans tous les cas la nature est sacralisée dans toutes ses composantes. Culte du Nil et culte du Strymon à Amphipolis, fleuves qui dans les deux cas jouent un rôle protecteur et nourricier, bois sacrés abritant les nymphes des sources et des arbres…Phénomènes naturels et réalités géographiques sont des divinités. Et les citoyens athéniens sont descendants de Gaïa et d’Héphaïstos par leur ancêtre commun, Erichtonios « né du sol de l’Attique ».
Mais l’espace politique de l’Empire du pharaon ou de la cité grecque est un espace construit où les hommes comme les dieux doivent trouver une place équitable. Les paysages sauvages, désert dangereux ou montagnes hostiles à l’homme, sont rejetés hors du monde civilisé, alors que la Terre nourricière fournit les récoltes qui sont les dons des dieux. Le paysage aménagé par les hommes répond à des besoins techniques (produire la nourriture), administratifs (fournir l’impôt) et religieux (respecter l’ordre du monde). Les sanctuaires qui maillent le territoire, assurent la cohésion du corps civique. Bien que reconnaissant le divin dans l’espace sauvage comme dans l’espace cultivé, les Grecs ont organisé une mise en valeur rationnelle de leur milieu.
La dernière étude de cas porte sur les paysages actuels du Nord Cameroun. Situés dans la zone sahélienne, ils ont été façonnés par une histoire longue d’au moins deux siècles où se sont superposées trois pratiques religieuses successives : les pratiques animistes des « autochtones », celles des musulmans apportées par les envahisseurs peuls du XIXe siècle puis celles des colons chrétiens.
Dans les vastes plaines dominées par des montagnes abruptes, l’arbre, seul élément verdoyant pendant la saison sèche, joue un rôle majeur, non seulement pour sa valeur économique, médicinale mais aussi par sa fonction symbolique.
Avant les conquêtes peules, les arbres sont regroupés dans des parcs arborés où ils fournissent aux hommes aliments, boissons, fibres textiles, bois…mais certains sont sacralisés comme le ficus qui assure le lien entre le monde des morts et celui des vivants. Les nomades musulmans installés au Nord Cameroun au début du XIXe siècle, procèdent à un fort déboisement, car ils privilégient l’herbe aux dépens de l’arbre et pensent effacer les croyances animistes en détruisant les parcs arborés. La colonisation chrétienne, un siècle plus tard, amène la renaissance des parcs, espérant à son tour fragiliser l’Islam. Préoccupations religieuses et économiques sont à nouveau entremêlées. On développe l’Acacia albida favorable aux cultures pluviales et on fait entrer l’arbre en ville car le jardin arboré est propice à la prière et à la méditation.
Aujourd’hui les paysages traduisent l’imbrication des différentes pratiques religieuses (l’arbre est dans les champs, dans la savane et dans les villes), mais aussi les préoccupations matérielles des habitants. C’est ainsi que la hausse du coût de la vie amène le recours à certains produits traditionnels, notamment en matière de santé, ce qui se traduit par la surexploitation de Kaya senegalensis, considéré comme une pharmacie vivante.
Egypte de l’Ancien Empire, cités grecques antiques, Nord Cameroun… ces différents exemples ont montré la coupure que les hommes faisaient entre monde sauvage et monde civilisé. Dans ce dernier les hommes font une place au divin, place qui prend en compte leurs propres besoins terrestres.
Comment la sacralisation de la nature a-t-elle été – est-elle – utilisée comme enjeu politique ? C’est le thème de la troisième partie introduite par B. Lemartinel qui s’interroge sur le besoin du religieux pour comprendre la nature. Il semble que dès la préhistoire, les hommes aient réfléchi à l’organisation du cosmos, porteur d’ordre ou de chaos. A l’époque moderne, la connaissance scientifique n’a pas eu besoin de faire intervenir l’hypothèse d’un Dieu pour se développer. Pourtant on assiste à un retour des mysticismes scientifico-religieux du géosystème terrestre. Hypothèse Gaïa avec J. Lovelock qui fait de la Terre un organisme vivant s’autorégulant, Deep Ecology voulant éradiquer l’humain prédateur de la surface de la Terre, fondamentalismes évangélique et musulman prêchant le créationnisme…Plus récemment nouvelle « religion » du changement climatique qui trouve des prosélytes au plus haut niveau des Etats.
Comment recompose-t-on le passé pour servir les idéologies et projets politiques contemporains ?
- Glon démontre comment l’ « indigène », l’Amérindien, a été l’objet de manipulations par les colons et leurs successeurs en Amérique du nord, particulièrement au Canada, à partir du XVIIe siècle. Deux images de l’Indien se sont développées parallèlement, celle du « mauvais sauvage », vivant dans la forêt répulsive « contre la nature », c’est-à-dire contre la civilisation, et celle du « bon sauvage » promoteur d’une culture « authentique » construite en harmonie avec la nature. Dans le premier camp, on trouve des conquérants comme le fondateur de la Nouvelle-France, S. Champlain, dans le second, des intellectuels comme Montaigne et Las Casas. L’image positive de l’ « indigène » a lentement progressé au XIXe siècle, portée par le mouvement romantique. Elle trouve une nouvelle vigueur dans les années 1960/1970 où les adeptes de la contre-culture, hippies et Nouvelle gauche, militent contre la société de consommation. L’Indien devient la nouvelle icône d’un mode de vie écologique anticonsumériste.
Aujourd’hui deux orthodoxies s’affrontent. L’orthodoxie autochtone porte les revendications des peuples indiens, développées aussi dans certains travaux scientifiques, reprenant le mythe de l’Indien écologiste, dont les relations avec la nature sont imprégnées de spiritualité, et qui, en fonction de son antériorité sur le territoire, est fondé à réclamer sa souveraineté sur de vastes espaces. A l’opposé l’orthodoxie postcoloniale libérale place les Indiens au bas de l’échelle de l’évolution (ils ne pratiquent pas l’agriculture) et leur dénie toute prétention à une souveraineté car ils sont dépourvus de gouvernement.
Pour E. Glon les excès des deux orthodoxies occultent la situation réelle des Amérindiens, marginalisés et paupérisés au sein des sociétés des Etats-Unis et du Canada. Les autorités politiques canadiennes n’ont reconnu que récemment (2008, excuses du Premier Ministre, S. Harper) l’ethnocide culturel qu’avaient constitué les « residential schools » où les enfants indiens, éloignés de leurs parents, étaient soumis à une assimilation forcée et brutale. La question de l’autonomie reste délicate. Mais, ce que l’article, écrit plus tôt, ne dit pas, c’est que le Canada, après avoir voté contre la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones en 2007, a publié un Enoncé d’appui en 2010. Et, en 2016, la Ministre des Affaires autochtones et du Nord a annoncé que le Canada appuyait « pleinement et sans réserve la Déclaration ». Comme exemple de cheminement vers l’autonomie est cité le cas des Lil’watt, Indiens de Colombie britannique, qui mettent en œuvre un projet de développement communautaire prenant en compte la prospérité économique autant que le respect de la spiritualité religieuse et culturelle, exigences qui pourraient se révéler contradictoires dans l’avenir.
Cette quête d’autonomie des Indiens montre leur volonté de se réapproprier leur propre culture et leur sens du sacré, face à la politique longtemps assimilationniste de l’Etat.
La terre sacrée n’est pas seulement celle des divinités et des esprits. C’est aussi celle qui renferme les soldats morts pour la patrie. Et la guerre de tranchées, plus que tout autre, mêla de façon intime le corps des hommes avec l’humus et les plantes, le long des 700 km de la ligne du front occidental entre 1914 et 1918. Comment doter le lieu des batailles du caractère sacré qui leur assurerait le recueillement des générations futures ? J.-P. Amat a étudié la réponse des autorités publiques françaises à cette problématique dans le cas du champ de bataille de Verdun.
Le premier travail des Eaux et Forêts dans l’immédiat après-guerre a été de recueillir les ossements pour procéder à leur inhumation dans ce qui va constituer l’Ossuaire de Douaumont. Mais que faire du paysage, alors que très vite une végétation buissonnante spontanée se met à pousser là où ne restaient, en novembre 1918, que quelques chandelles et souches de taillis ? En 1921 a été mise en place une Commission spéciale pour la patrimonialisation des champs de bataille. Des trois zones distinguées, bleue, jaune et rouge, la rouge, celle où eurent lieu les plus fortes destructions, fut l’objet d’une polémique entre forestiers et anciens combattants. Les premiers étaient tenants du boisement intégral ; la forêt, semblable à un sanctuaire, serait le meilleur symbole de reconnaissance à l’encontre des soldats sacrifiés. Les seconds s’opposaient à un boisement considéré comme une volonté d’oublier la guerre. A partir de 1929 la plantation de la forêt domaniale de Verdun commence et la polémique s’éteint en 1932 grâce à un accord sur le maintien d’un espace boisé autour du Mémorial, le « Plateau de Douaumont ».
Le champ de bataille de Verdun a une dimension spirituelle, républicaine et religieuse, ce que ressentent les nombreux visiteurs de toutes générations.
Comment le sacré est-il instrumentalisé pour servir les intérêts ou les ambitions de groupes et d’individus ?
Trois études de cas, situés dans des univers cultuels très différents, sont présentées.
La logique des pratiques rituelles des Kabiyè au Nord-Togo contredit le dogme de l’intouchabilité des sites sacrés généralement pratiquée. A chaque site sacré (bois, collines…), correspond une zone du territoire sur laquelle s’exerce son influence. Pour que, sur le reste du territoire, la chasse soit productive, les pluies fertilisantes et pour « évacuer la mort » (c’est-à-dire les sources du malheur), il faut périodiquement débroussailler et brûler les bois sacrés. Ces pratiques rituelles modifient donc régulièrement les parts sacrées du paysage.
L’article de V. Antomarchi, spécialiste des Inuits dans le Grand Nord canadien, montre comment deux formes de sacralisation différentes d’un même territoire, le parc des Pingualuit au Nunavik (Nord du Québec), peuvent mener à sa profanation. Sacralisation du territoire pour les Inuits car il est saturé de présences visibles et invisibles qui en font avant tout un lieu de mémoire. Sacralisation pour les Occidentaux à cause du vide et de la blancheur liée à la pureté et au Sublime. Créé en 2004, le parc est l’objet du marketing actif de tours-opérateurs vendant aux touristes américains et européens ancrage spirituel ancestral des Nunamiuts et pureté du paysage arctique. Mais la spiritualité du lieu, notamment celle de son cratère creusé par une météorite il y a plus d’un million d’années, est-elle compatible avec le tourisme de masse ? Actuellement, si beaucoup d’Inuit sont favorables à la valorisation économique de leur territoire par le tourisme, ce sont des écologistes « extrémistes » qui en réclament la surprotection. Nouvelle forme de sacralisation ?
Peu après son départ du pouvoir, l’ex vice – président des Etats-Unis, Al Gore est le meneur de jeu d’un film réalisé par D. Guggenheim, Une vérité qui dérange, ce qui lui a valu le Prix Nobel de la paix en 2007. Documentaire ou film militant au profit d’une thèse cherchant à démontrer que le réchauffement climatique et ses effets catastrophiques sont le résultat du mode de vie des pays riches ? M. Tabeaud et X. Broaeys ont montré, par l’analyse du film, comment le spectateur pouvait être manipulé par quelqu’un qu’ils qualifient de « gourou du changement climatique ». Le montage fait alterner des plans en rafale de photos sur les effets des catastrophes climatiques (inondations dues à Katrina par exemple) avec de longs plans séquences sur de beaux paysages vides de toute présence humaine. Au ressenti angoissant provoqué par les premiers succède l’apaisement devant les espaces infinis. Les couleurs crépusculaires du noir, du rouge et du gris accompagnent les activités humaines qui martyrisent la Terre alors que le blanc et le bleu, couleurs mariales, révèlent la pureté de la nature vierge.
L’atmosphère de religiosité du film est amplifiée par la présence d’Al Gore à l’écran, entouré d’un halo de lumière, utilisant la gestuelle et le vocabulaire des ministres du culte pour évoquer les catastrophes à venir qui font écho aux prédictions bibliques.
Les auteurs de l’article insistent sur les ambiguïtés des exemples fournis et les imprécisions des graphiques. Ils déplorent le manichéisme du film dont ils ne nient pas que le succès puisse avoir des effets bénéfiques sur l’environnement.
Dans la conclusion de la troisième partie, D. Chartier reconnait la recrudescence du mysticisme dans de nombreux discours officiels sur l’environnement, mais il regrette que l’on associe trop souvent ces dérives à tous les discours environnementaux. Il est très sévère à l’égard des géographes français qui méconnaitraient la diversité de l’écologie politique et fait une critique virulente de l’ouvrage de L. Ferry, Le Nouvel Ordre écologique (1992), dont il n’a été pourtant question dans aucun des articles publiés.
En conclusion générale on peut insister sur la grande diversité des communications, diversité qui ne tient pas uniquement aux sociétés, époques et religions étudiées, mais aussi aux différentes approches, certaines très descriptives, d’autres très abstraites. Cette diversité fait la richesse de l’ouvrage, parfois sa difficulté. Il semble que certains articles aient été écrits il y a quelques années. Une datation précise aurait permis une meilleure mise en perspective de leur contenu.
Comme le souligne B. Sajaloli et E. Grésillon, la reconsécration de la nature est un sujet majeur de notre société contemporaine : la « liberté de la nature vis-à-vis des hommes pose in fine la question de la destinée du monde ».
Michèle Vignaux, novembre 2019


