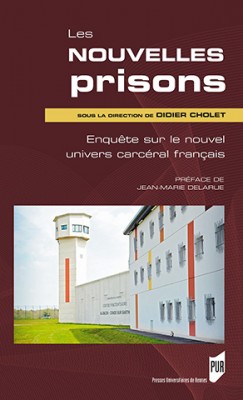Café géo du 30 septembre 2016, avec Olivier Milhaud, maître de conférences en géographie à Paris 4 et Lucie Bony, chargée de recherche au CNRS, à l’UMR Passages de Bordeaux. Ils ont notamment contribué au numéro 702-703 (2015) des Annales de Géographie consacré aux géographies de l’enfermement.
Le sujet de ce café géographique a été choisi par rapport au thème du Festival International de Géographie 2016 : « Un monde qui va plus vite ? ». Il s’agit ici de prendre le contrepied du thème du festival: au-delà du lieu commun d’une société hypermobile, ne se cache-t-il pas un monde des marges, qui semble ne pas changer ?
Olivier Milhaud et Lucie Bony ont évoqué trois dimensions de l’espace apparemment immobile des prisons : d’abord, il s’agissait d’appréhender les changements et permanences de la prison comme institution, avant de se pencher sur la prison comme lieu : quels changements dans les localisations des prisons françaises ? Comment leur architecture a-t-elle évolué ? Ces transformations amenaient alors à s’interroger sur l’enfermement comme expérience géographique : comment la punition par l’espace se traduit en termes d’immobilité ?
-
Appréhender la prison. Une institution entre clôture et décloisonnement
Cette institution s’est généralisée dans le monde entier : « elle a été finalement reprise dans tous les contextes politiques et sociaux. Cela a été une si formidable invention, et si merveilleuse qu’elle s’est répandue presque comme la machine à vapeur et est devenue une forme d’encadrement général de la plupart des sociétés modernes, qu’elles soient capitalistes ou qu’elles soient socialistes » (Foucault, 1994). Mais la durabilité de l’institution s’explique aussi peut-être par les nombreuses tentatives de réforme qu’elle a connu.
Olivier Milhaud précise qu’à propos de la prison, il ne faut pas confondre les notions de changement et de réforme. Dans Surveiller et Punir, Michel Foucault explique qu’il est consubstantiel à la prison de vouloir la réformer, car c’est une institution qui n’arrive pas à remplir ses fonctions, qui est condamnée à l’insatisfaction. Il faut dire que c’est l’institution chargée de réussir là où toutes les autres ont échoué (famille, école, religion, monde du travail, etc). Il semble qu’on lui demande trop : résoudre la crise de l’illettrisme, du lien social (on y trouve massivement des SDF, des « paumés »), de la prise en charge de la santé mentale (que de cas psychiatriques en détention), de la masculinité (en France, les femmes représentent seulement 4% des détenus) et depuis peu, on lui demande aussi de déradicaliser. On a donc d’un côté une insatisfaction, qui appelle à la réforme, mais cette dernière ne suffit jamais. Ce paradoxe donne alors à l’institution une impression d’immobilisme, d’un échec reconduit et répété.
Lucie Bony récapitule alors brièvement l’historique de l’institution carcérale pour montrer l’ampleur des réformes que cette dernière a connu, en s’appuyant sur les travaux de Michelle Perrot, historienne de la prison. La prison « moderne » nait avec la loi pénale de 1791, avec l’idée de corriger les détenus. C’est à cette époque, dans le contexte des Lumières et de la Révolution française, qu’émerge alors l’idée d’une « bonne peine », qui a pour objectif de transformer le détenu par le travail et la discipline. Le système est réformé au début du XIXe siècle, et notamment en 1819 avec la création de la Société Royale pour l’amélioration des prisons, puis vient la disparition des peines infâmantes (1830) et l’abolition du pilori (1848).
Fin XIXe, la question carcérale est mise de côté. Il faut attendre la deuxième partie du XXe siècle pour voir d’autres réformes de l’institution. Dans les années 1970 sont engagées des mesures pour libéraliser les conditions de détention suite aux révoltes de 1970, 1971 et 1974 : autorisation de la presse, de fumer, élargissement des conditions de semi-liberté. Les miroirs sont également autorisés : le détenu peut désormais voir son visage se transformer avec le temps. Cela a été perçu comme une véritable révolution dans l’expérience individuelle de la prison.
Les années 1980 constituent un second tournant. L’arrivée de la gauche au pouvoir entraîne une rupture avec la politique pénitentiaire sécuritaire du ministère Peyrefitte. On autorise le port de vêtements civils, le téléphone, les parloirs sans séparation. Après l’abolition de la peine de mort en octobre 1981, le ministère de Robert Badinter met en place des peines de substitution en 1983. Cela montre une volonté de lier la peine à la réinsertion.
Dans les années 2000, la question pénitentiaire revient à l’agenda politique suite à la publication du livre de Véronique Vasseur, Médecin-chef à la Santé (2000), où elle décrit les conditions terribles de détention. Un certain nombre de rapports parlementaires indiquent la nécessité d’une nouvelle réforme. Mais celle-ci est tributaire de l’ambiance sécuritaire qui caractérise l’élection présidentielle de 2002. Malgré tout, quelques changements ont lieu dans les prisons des années 2000 : des sites pilotes sont choisis pour adopter les règles pénitentiaires européennes, ou encore la loi pénitentiaire de 2009 qui modifie les modalités d’exécution des peines.
La prison n’est donc plus la même qu’au XVIIIe siècle. Aujourd’hui, de nouveaux problèmes sont pointés du doigt (radicalisation, surpopulation) et donnent à voir un système carcéral marqué par une sensation d’inertie. La politique pénitentiaire tente d’échapper à la critique, mais ne comporte dans les faits que peu d’ambitions, sans réflexion sur le sens de la peine et sur le lieu prison.
Cependant, il faut aller au-delà de ces réformes législatives pour voir ce qu’elles impliquent dans la vie quotidienne des prisons : peut-on parler d’une normalisation de l’institution carcérale ?