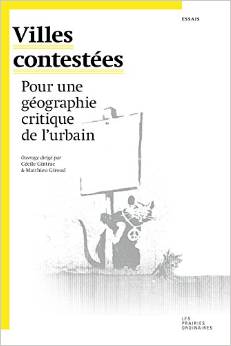Les Cafés Géo rencontrent des auteurs
Villes contestées
Pour une géographie critique de l’urbain
Ouvrage dirigé par Cécile Gintrac et Matthieu Giroud
Les Prairies Ordinaires, 2014, 408 p.
Cécile Gintrac et Matthieu Giroud, vous avez dirigé un important volume intitulé Villes contestées. Pour une géographie critique de l’urbain, qui déboulonne l’idéologie mainstream de la ville créative, compétitive, globale, écologique, sûre, ou encore multiculturelle. Quels étaient vos objectifs, à la fois scientifiques et politiques (puisque c’est l’une des originalités de l’ouvrage dans la géographie francophone de ne pas découpler les deux aspects), en faisant paraître un livre de 400 pages sur le sujet?
CG- Notre premier objectif est de donner à voir une vision de la richesse du champ de la géographie urbaine radicale et critique non francophone et de ses évolutions récentes. Diversité des objets, des approches, des influences et des productions théoriques, des terrains d’investigation… Mais il nous importait surtout de réunir des textes qui participent malgré tout d’un « projet » commun à savoir identifier et surtout contester les nombreuses contradictions spatiales et urbaines que le système capitaliste, dans toutes ses variantes, produit et reproduit. Bien sûr, cet ouvrage a aussi des objectifs pédagogiques et de transmission de connaissances clairement identifiés. Rendre accessible des textes originellement écrits en anglais ou en allemand, et de fait inédits en français, a été pour nous une motivation majeure. Tout comme introduire ces textes par des présentations des auteurs, de leur œuvre et de la réception de leur travail, en donner quelques clés de lecture.
MG- La seconde partie du titre de l’ouvrage, « Pour une géographie critique de l’urbain », est pour nous importante. D’abord elle insiste sur l’idée qu’il existe bien sûr d’autres « géographies », au sens strict, critiques de l’urbain… Et que ce recueil ne doit pas être considéré comme un instrument d’autorité voire autoritaire, comme pourraient l’être certains readers anglophones qui ont tendance à graver dans la marbre de la postérité certains auteurs/textes et à en écarter d’autres. Le recours à une telle expression nous conduit surtout à mettre en avant deux hypothèses fortes, qui peuvent d’ailleurs être envisagées comme deux contributions possibles des géographes aux débats plus généraux sur la théorie critique. Comme vient de le dire Cécile, ce qui est transversal aux différents textes est qu’ils proposent une analyse et une contestation des inégalités produites et reproduites par les mécanismes et les acteurs du capitalisme contemporain. En offrant une réflexion sur l’évolution du capitalisme, ces textes interrogent donc aussi l’évolution de ces formes d’inégalité, dans leur intensité, leur morphologie, leur distribution au sein des catégories de populations, dans leur échelle et leur inscription spatiale. C’est ici qu’une des hypothèses fortes de l’ouvrage peut être annoncée : est-ce que la ville ou l’urbain est le lieu privilégié pour observer et analyser ces transformations ? En associant « urbain » à géographie critique, nous faisons l’hypothèse que la ville est un des ces lieux privilégiés… même si nous sommes bien conscients qu’il n’est pas le seul ! Ce qui nous amène à notre seconde hypothèse qui est de considérer que le/la géographe a son mot à dire, et sa place à prendre, pour comprendre et dénoncer ce qu’on pourrait appeler imparfaitement des formes « spatiales » (morphologies, spatialités, représentations) de dominations « sociales ». La variété de ses méthodes, de ses approches et de ses concepts peut sans nul doute aider à comprendre comment l’espace est mobilisé comme instrument et ressource du pouvoir, que ce pouvoir soit dominant ou alternatif. Ceci induit toutefois la nécessité d’une adaptation continue de la recherche et de ses outils aux transformations du capitalisme contemporain. Et là est la difficulté ! Cette exigence d’adaptation méthodologique renvoie aussi à celle d’une nécessaire adaptation théorique et idéologique. Si l’idéologie est sans doute à la base de l’adoption d’une approche critique, et encore plus radicale, il ne faut pas non plus que l’idéologie aveugle en apportant des réponses avant même de se poser les questions. La démarche qualifiée « d’idéologique » est trop facilement attaquable si elle est trop visible. Il faut donc parvenir à être plus tactique… et cela passe sans doute, d’abord, par une relation honnête et concrète au terrain, critique que l’on peut faire à de nombreux auteurs anglophones critiques ou radicaux ; d’autre part, en affrontant la complexité du réel, ce qui renvoie à mon sens à considérer avec sérieux les effets de contextes, les singularités locales, que ce soit en termes de coalitions d’acteurs, de peuplement, de trajectoires et de morphologies urbaines, en interaction avec des processus plus globaux et structurels ; ce que font à mon sens très bien des auteurs comme David Harvey ou Neil Smith – même s’ils sont souvent critiqués de ne pas le faire.
Votre introduction souligne votre objectif pédagogique et militant, disant combien le fait de se plonger dans des textes sur Toronto, Rio, Berlin, Baltimore, sur des villes européennes ou sud-africaines, peut nourrir la pensée des chercheurs comme des acteurs de terrain. A votre sens, qu’apportent ces réflexions à des militants critiques de l’ordre urbain contemporain?
MG – Très souvent les chercheurs en sciences sociales sont critiqués pour leur regard surplombant, ou bien pour leur trop grande distance à l’égard du terrain des luttes et du militantisme… Ces critiques proviennent bien entendu des activistes et militants de terrain, mais aussi de la communauté universitaire elle-même. C’est d’ailleurs d’une certaine manière le sens de l’article écrit par Aurélie Quentin (université de Nanterre) et Stéphanie Vermeersch (CNRS) et paru dans Le Monde du 10 janvier 2015, suite aux attaques terroristes sur Paris. Un court texte, intitulé « Intellectuels, l’heure du réveil a sonné », qui fustige notre « disparition collective » du débat et de l’action publics… C’est une vaste question et nous ne la résoudrons pas ici ! Ce qui est certain c’est que les militants, en tout cas ceux que nous rencontrons en tant que chercheurs ou simples habitants-citadins, sont demandeurs d’analyses poussées, réfléchies, mêlant apports empiriques et propositions théoriques.
CG – Cette anthologie peut fonctionner comme une boîte à outils militante. Les textes sélectionnés permettent, à notre sens, de mieux comprendre les mécanismes de production de la ville capitaliste contemporaine (grands projets, gentrification), en entrant dans le détail des processus à l’oeuvre. Je pense que les militants qui, en ville ou ailleurs, luttent contre les grands projets de d’aménagement (Triangle de Gonesse, Plateau de Saclay) ou contre les politiques qui accompagnent l’éviction des classes populaires y trouveront des clés d’explication, voire de contre-arguments. Les textes partent souvent des discours dominants: ville créative, ville multiculturelle, ville globale…. Tous ces slogans sont déconstruits et critiqués par les auteurs du recueil. Je pense par exemple au texte de Kanishka Goonewardena et de Stefan Kipfer sur la ville multiculturelle : dénoncer ce slogan, cela ne revient pas à refuser l’idée du multiculturalisme en soi, mais c’est chercher à comprendre comment il est mobilisé dans le cadre des politiques urbaines néolibérales. En mobilisant Nancy Fraser, Henri Lefebvre ou Frantz Fanon, les deux auteurs tentent d’articuler la reconnaissance “ethnique” – qui ne saurait se limiter à l’organisation de quelques festivals culturels – et la remise en cause en profondeur de la ville capitaliste. Enfin, je pense qu’on peut lire le recueil au prisme de la question des échelles d’intervention militante en ville. Il est crucial de s’interroger sur l’échelle où le militantisme a le plus de chance d’être fructueux. Neil Smith s’était interrogé sur les stratégies de “saut d’échelle” (jumping scale), une manière de se demander comment dépasser l’échelle locale. Dans le texte de Roger Keil et Julie-Anne Boudreau, l’émergence du nouvel échelon métropolitain à Toronto (un peu à l’image du Grand Paris) est vu comme une opportunité à cet égard pour les revendications écologistes. Je crois qu’il faut l’avoir particulièrement en tête, à l’heure où la “gouvernance” du Grand Paris se met en place (pour le moment de manière tout à fait technocratique) : il y a là de nouvelles échelles d’intervention pour les militants.
L’ouvrage est formé de la réunion de onze textes, chacun introduit par une courte présentation, le livre commençant par votre introduction générale à quatre mains. Comment s’est fait le choix de ces textes, tous très géographiques quoique pas toujours signés de géographes?
MG – Cet ouvrage est un projet collectif ! L’ampleur du travail mais aussi le fait de travailler avec un éditeur, Les Prairies ordinaires, n’ayant pas les moyens de mettre à disposition un budget de traduction nous ont naturellement conduit à mobiliser une équipe prête à s’investir « gracieusement »… Ce qui n’est pas choquant pour des collègues universitaires, mais plus délicat pour des traducteurs… On a donc monté une équipe avec certes beaucoup de géographes mais pas seulement ! Des collègues ayant en tout cas une certaine expérience de la littérature non francophone et des pensées critiques, et même d’un champ des études urbaines ou d’une thématique en particulier. Le choix des auteurs et des textes relève donc en premier lieu des collègues investis. La sélection finale a été réalisée collectivement dans un second temps, en tentant d’intégrer plusieurs critères : la diversité des auteurs, de leur notoriété comme de leur origine, la pluralité des approches suivies et des objets traités, la variété des dates de parution des textes originaux, sans oublier, « l’affinité » des contributeurs français pour certains auteurs »
CG – Nous avons réuni des géographes autour de leurs sujets de recherche, de leur spécialité. Nous leur avons demandé de sélectionner des textes qu’ils utilisaient dans leur travaux, qui leur paraissaient incontournables, mais qui n’étaient pas traduits. Ce sont aussi des textes qu’ils utilisaient dans leur cours, avec leurs étudiants. L’idée, c’est que la langue ne soit plus une barrière pour les mobiliser.
L’ensemble des textes est non seulement abordé dans l’introduction générale, mais aussi par des brèves présentations, on l’a dit, assurées par des géographes français. Vous même vous nous présentez, Cécile Gintrac, un texte très rigoureux de Melissa Gilbert intitulé « “Race”, espace et pouvoir : stratégies de survie des travailleuses pauvres » et qui porte sur le confinement spatial des femmes afro-américaines à Worcester (Massachussets). Qu’est-ce qui vous a motivée, sur les plans pédagogiques et militants, à présenter un tel texte?
CG – Ce texte est exemplaire à plusieurs titres. D’abord, il n’envisage pas qu’une seule forme de domination. Il n’est pas seulement féministe. En s’intéressant aux travailleuses pauvres blanches et afro-américaines, il souligne les effets conjugués de la pauvreté, du genre et de la “race” (employé ici, comme dans l’article entre guillemets). C’est ici une manière de réfléchir à ce qu’il est convenu d’appeler l’intersectionnalité, non pas seulement théoriquement, mais dans les faits. Les relations de domination se croisent, s’accumulent parfois et produisent des pratiques spatiales complexes, au-delà des schémas et des modèles préétablis. Partir des pratiques et du terrain, c’est évidemment la meilleure manière de comprendre comment les individus et les groupes d’individus subissent simultanément plusieurs formes de domination et de discrimination. Ensuite, la réflexion menée par Melissa Gilbert va à l’encontre des analyses déterministes. L’espace n’est pas qu’une contrainte, c’est aussi une ressource, même pour les populations marginalisées. C’est très différent d’une approche où l’on assigne des populations à des espaces, comme l’a fait récemment Christophe Guilluy dans ses ouvrages comme La France périphérique. Faire de la géographie, cela ne peut pas se limiter à appliquer une grille déterministe, ce n’est pas assigner un groupe de populations à un espace. C’est ce piège que le texte de Melissa Gilbert déjoue avec finesse. Le confinement spatial observé chez les femmes étudiées à Clark n’est pas définitif, il n’est pas seulement subi, il est le fruit de stratégies spatiales individuelles, de solidarités. Les individus ne sont pas seulement “agis”, ils agissent !
Quant à vous, Matthieu Giroud, vous nous présentez le texte de Marcelo Lopes de Souza « Ensemble avec l’Etat, malgré l’Etat, contre l’Etat. Les mouvements sociaux, agents d’un urbanisme critique » qui présente l’approche à la fois libertaire (capable de faire avec, malgré et contre l’Etat) et semi-périphérique (depuis le Brésil où les dynamiques du capitalisme contemporain sont peut-être plus visibles qu’au Nord) de cet auteur. Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce texte?
MG – Je cherchais un texte qui abordait la question des mobilisations sociales et des luttes urbaines. J’ai été vraiment étonné par le travail de Marcelo Lopes de Souza, professeur de géographie à l’université fédérale de Rio de Janeiro. Un travail centré sur les pays qu’il nomme « semi-périphériques » comme le Brésil, l’Argentine, l’Afrique du Sud, et qui décortique sans concession à la fois les mécanismes de la planification urbaine, de la néo-libéralisation de la production urbaine, mais aussi des formes alternatives mais régulées de l’aménagement urbain, comme la participation. C’est surtout sa réflexion que je trouve très intelligente car extrêmement réflexive et tactique sur l’autonomie des mouvements sociaux à l’égard des institutions mais aussi de toute forme d’autoritarisme politique et idéologique qui m’a interpellé. Son texte illustre très bien ce que j’essaye d’exprimer plus haut. Faire « avec », « contre », « malgré » l’Etat, selon les circonstances et les visées stratégiques, tenter d’avoir un coup d’avance, ou du moins, d’anticiper les coups, en se réinventant en permanence… C’est ce qui manque, il me semble, le plus aux mouvements sociaux d’aujourd’hui, trop souvent sur la défensive, ou manipulés de l’extérieur comme de l’intérieur. Voici en tout cas quelques réflexions intéressantes pour penser les contre-pouvoirs et les formes alternatives de penser et de concevoir l’aménagement urbain…
Le premier texte présenté est celui de Jennifer Robinson, tiré de l’introduction de son ouvrage majeur Ordinary Cities (2006) qui dénonce la fausse opposition entre des villes occidentales qui seraient forcément modernes et développées, et des villes du Sud forcément archaïques et sous-développées. Elle appelle au contraire à appréhender ces dernières comme des villes ordinaires. Est-ce à dire que vous vouliez d’emblée vous poser plus du côté de la géographie critique, qui embrasse résolument la pluralité des démarches critiques, post-coloniales par exemple, mais aussi féministes ou écologistes, plutôt que du côté d’une géographie radicale classique qui théorise de manière marxiste ou marxisante la production urbaine comme le rappelle votre introduction générale?
MG- Ce livre ne contient pas de hiérarchie. L’ordre des textes est complètement aléatoire. Commencer par Robinson n’exprime rien de particulier pour nous. Comme on le précise dans l’introduction, nous n’avons pas voulu faire de regroupements thématiques, ou bien forcément démarrer avec les textes d’auteurs ayant une certaine notoriété dans le milieu. C’est à chaque lecteur de s’approprier cet ouvrage à sa manière.
CG – Oui, pas de hiérarchie entre les textes. Ce n’était peut-être pas tout à fait volontaire mais, a posteriori, je trouve que commencer par un texte qui montre comment les modèles forgés dans les pays du Nord conduisent à marginaliser plus encore les villes du Sud est une très bonne chose. En tous cas, nous ne cherchons pas à opposer les nouvelles géographies critiques à la géographie radicale. Jennifer Robinson me racontait, dans un entretien, combien David Harvey, qu’elle a lu quand elle était encore en Afrique du Sud, avait exercé une grande influence au début de sa carrière.
Votre livre présente des auteurs anglo-américains célébrissimes : David Harvey contre les villes entrepreneuriales faites d’inégalités sociales et d’une gouvernance urbaine plus obsédée par l’attraction de capitaux pour toujours plus de profits que par le bien-être des habitants, Don Mitchell qui articule droit à la ville et combat pour un espace réellement public, Neil Smith sur la gentrification comme pleinement inscrite dans la logique capitaliste de la production de l’urbain par développement inégal, ou encore Edward Soja sur le pourquoi de la justice spatiale. Mais votre livre donne aussi à lire le texte remarquable de Bernd Belina, géographe allemand, sur l’usage du droit pénal comme moyen de gouverner les disparités urbaines, les textes déjà évoqués de la Sud-Africaine Jennifer Robinson et du Brésilien Marcelo Lopes de Souza, ou encore le texte des Canadiens Roger Keil et Julie-Anne Boudreau sur l’étatisation des politiques écologiques à Toronto. Finalement la géographie critique de l’urbain n’est pas si anglo-américaine que cela?
CG- L’anglais est devenue la lingua franca de la recherche, preuve en est que la majorité des chercheurs du recueil publient régulièrement dans cette langue alors que leurs nationalités sont en réalité bien plus variées (américaine, britannique, sud-africaine, sri-lankaise mais aussi belge, espagnole, suisse, allemande, brésilienne). Cette internationalisation ne doit pas masquer pour autant la concentration spatiale des lieux de production et de publication de la connaissance. Plus de la moitié des textes que nous avons sélectionnés ont été d’abord publiés par des revues scientifiques qui se revendiquent de la géographie critique ou radicale (Antipode) ou plus généralement des critical urban studies (International Journal of Urban and Regional Research ou City). Elles sont, comme les autres publications académiques, diffusées par des grands groupes d’édition et publiées essentiellement en anglais. Si ces revues sont conscientes des déséquilibres que cela implique en terme de diffusion et d’accès à la publication, rares sont les journaux de géographie critique qui ont opté pour des éditions plurilingues (ACME An International E-Journal for Critical Geographies ou Justice Spatiale / Spatial Justice en France) et un accès entièrement gratuit (open access) qui relève en soi d’une forme de militantisme. Il y a en réalité des groupes de géographies critiques dans de nombreux pays du monde. J’ai récemment essayé de recenser les revues de géographie critique (http://aggiornamento.hypotheses.org/2352). Mais quand il n’existe pas de revue en ligne, il est parfois très difficile d’avoir accès à certains travaux. Je pense par exemple à un groupe de géographie urbaine critique et radicale de Sao Paulo, que j’étudie dans le cadre de ma thèse (http://gesp.fflch.usp.br), et qui publie en portugais.
MG – Et puis il y a aussi de nombreux travaux réalisés en France par des géographes, mais aussi par des politistes ou des sociologues…
Par rapport à cette géographie critique de l’urbain, comment analysez-vous la géographie française contemporaine? Il y a bien les courants de la géographie sociale et celui de la justice spatiale (le dernier texte d’Edward Soja est d’ailleurs tiré de la revue Justice Spatiale/Spatial Justice). Qu’est-ce qui les différencierait le plus de la géographie critique de l’urbain? Sont-elles plus englobantes parce que ne se limitant pas à l’urbain?
CG – La recherche anglophone est davantage structurée par objet que par discipline : critical urban studies, gender studies,… Mais ce n’est pas le cas au Brésil ou en Allemagne, où l’approche disciplinaire reste encore dominante. En France, les courants que vous évoquez se sont structurés davantage à partir d’une méthodologie voire d’une éthique partagées. Donc oui, c’est sans doute plus englobant. Cela dit, je crois qu’il faudrait relier ces approches à la géographie critique et à la géographie radicale dans leur ensemble, davantage qu’aux études urbaines. Un auteur comme Neil Smith a travaillé autant sur la gentrification que sur la production capitaliste de la nature. Il n’a pas limité son travail à la ville même si le recherche est structurée différemment aux Etats-Unis, où il a enseigné. Je ne suis donc pas certaine que l’entrée urbaine que nous avons choisie soit limitative ou qu’elle constitue la principale différence entre la recherche française et anglophone. Matthieu l’a dit, ce choix sous-tend une hypothèse : dans quelle mesure la ville est-elle le lieu privilégié des dynamiques capitalistes et de ses contradictions?
MG – La géographie française contemporaine est foisonnante, et elle l’est depuis pas mal d’années maintenant. Personnellement je ne milite pas pour un courant de géographie critique et/ou radicale, encore moins de l’urbain. Le jeu des courants, c’est aussi celui de l’institutionnalisation et de ses dérives. Et puis cela conduit aussi souvent à l’impasse intellectuelle, à l’enfermement de la pensée, à la défense vaine d’un pré-carré scientifique et politique. Un objet géographique n’appartient à personne. Penser en termes de courant, c’est aussi croire que ce qui a été fait avant ou ce qui est fait à côté n’est pas satisfaisant. C’est souvent se construire « contre »… Quelque part, on peut penser que la géographie critique et/ou radicale n’a jamais cessé d’exister en France depuis Elisée Reclus !! Les pensées anarchistes, libertaires, féministes, marxistes ont sans doute influencé plus de géographes qu’on ne le croit… Cette géographie a simplement pris des configurations différentes selon les époques et les événements, plus ou moins visibles, plus ou moins audibles, plus ou moins performatives. Et la constitution d’un courant comme a tenté de le faire Yves Lacoste dans les années 70 est une des configurations possibles… Aujourd’hui, plusieurs initiatives scientifiques et éditoriales portées par des géographes de différentes générations rendent peut être un peu plus visible cette bannière de la géographie critique et radicale. Elles proposent un début d’élan collectif autour de certains objets, de certaines influences théoriques ou de certaines approches. Personnellement, je m’en réjouis. Tout ceci ne vient pas de nulle part et de nombreux éléments de contexte peuvent être évoqués pour expliquer cette apparente cristallisation. Comment ne pas parler du rôle des personnes et des équipes qui ont formé ces géographes, de l’influence grandissante des théories anglophones critiques qui circulent plus aisément via le net ou les traductions, de l’expérience concrète de nombreux jeunes géographes de la précarisation des conditions de travail dans l’université française, mais aussi bien entendu du regard que nous nous faisons de la société contemporaine, de la mondialisation, de la financiarisation de l’économie, des inégalités et des mobilisations sociales… Villes contestées s’inscrit dans ce mouvement et contribue par là, de fait, à le consolider. Mais cet ouvrage n’a pas la prétention d’imposer et de figer quoi que ce soit. On est dans quelque chose qui reste dynamique. Et qui est bien évidemment intersécant avec les travaux de géographie sociale ou ceux de la justice spatiale, mais aussi avec ceux de géographie des migrations, de géographie politique, sans parler de l’influence d’autres disciplines comme la sociologie ou l’économie politique…
Dernière question, si vous envisagiez un volume 2, quelles seraient d’après vous les pistes qui restent à explorer?
MG – Ce sera à nos prochains collaborateurs de nous le dire ! Mais il reste bien entendu beaucoup de pistes à creuser et un second volume ne pourrait prétendre à lui seul faire le tour de tous les objets et problématiques méritant une petite tribune… Les questions autour des mobilisations sociales, des luttes dans et pour la ville sont sans doute trop rapidement survolées dans ce premier volume. Les villes étudiées sont aussi trop souvent des grandes métropoles mondiales. Les « second cities », les capitales régionales, les villes d’ancienne industrialisation, les espaces métropolitains « intermédiaires » restent trop peu représentées dans l’ouvrage. Enfin, il faudrait aussi davantage interroger les liens entre « l’ » urbain et « le » rural plus ou moins sous influence. Cette distinction n’a peut être plus vraiment lieu d’être dans une réflexion globale sur les mécanismes et les prédations du capitalisme contemporain.
CG – Pour être tout à fait honnête, l’idée même d’un volume 2 m’effraie un peu tant cet ouvrage a demandé d’énergie et d’efforts communs ! Nous sommes bien conscients qu’il manque des aspects importants de la réflexion sur la ville. Je pense notamment à la géographie du genre, qui ne se confond pas avec la géographie féministe. Il y a en effet la question de l’articulation entre le rural et l’urbain que Matthieu évoque. Les travaux de Neil Brenner, partant de l’hypothèse de l’urbanisation planétaire, sont à cet égard très pertinents. Il a aussi développé, avec Peter Marcuse, professeur d’urban planning, et la sociologue allemande Margit Mayer, une théorie critique de l’urbain, qui a fait l’objet d’un dossier dans la revue Métropolitiques (http://www.metropolitiques.eu/La-critique-urbaine-une-discipline.html) et qui a eu un impact important dans la recherche sur la ville. En réalité, il serait surtout très stimulant de penser à un recueil francophone !
Propos recueillis par Olivier Milhaud