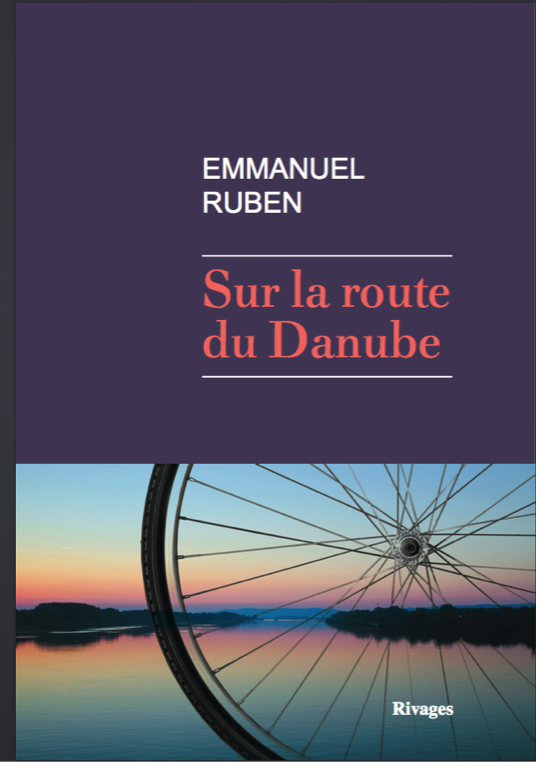
Emmanuel Ruben, Sur la route du Danube, Éditions Rivages, 2019
D’abord, il faut dire que c’est un excellent livre et que je l’ai, pour ma part, lu de bout en bout comme une nécessité, comme une urgence. Pour voir ce qui va se passer au chapitre suivant. Pour son style aussi, mélange de termes précis empruntés à la géographie physique et de l’argot tout-à-fait contemporain. Et aussi parce que je me retrouve dans cette Europe centrale et orientale où j’ai finalement passé beaucoup de temps.
Il y a plusieurs manières d’aborder cet ouvrage, parce qu’il y a plusieurs livres dans un.
Le premier livre est le carnet de voyage de deux cyclistes qui choisissent de partir du kilomètre zéro, à Sulina, sur la Mer Noire, de prendre le fleuve à contre-courant, pour remonter jusqu’à la source, en Bavière. Dès le chapitre introductif, on est dans le vif du sujet, je veux dire qu’on grimpe en danseuse les mains sur les cocottes de freins. Le rythme, vous dis-je. II faut mouliner mais ce n’est pas une affaire de quadriceps ou de mollets, seulement de rythme cardiaque et on vous assène dès le début l’histoire de ce malheureux, pas même cinquante ans, père de trois enfants qui, dans un col des Vosges, a perdu le rythme et la vie en même temps.

Carte extraite du livre d’Emmanuel Ruben (p 8-9)
De temps en temps ils croisent des congénères, rarissimes au début, puis de plus en plus nombreux vers l’amont, mais aucun ou presque qui suive le même itinéraire. Les autres descendent le Danube, ils ne le remontent pas.
Le premier livre est une histoire de roues voilées, de quelques crevaisons, mais surtout de l’obsession des rayons tordus. Car si les roues sont voilées, c’est qu’un choc a tordu les rayons. La chasse aux rayons n’est pas un sport facile : de moins en moins de réparateurs de vélos, et bien mal approvisionnés. Et puis on n’a pas pensé à emporter une de ces clés spéciales pour visser les rayons ; ça tient peu de place pourtant. Mon père m’avait légué la sienne, il y a longtemps. Je l‘ai toujours.
Que de détours et de retards imprévus à la recherche des précieux rayons !
Que de temps perdu du fait du tracé des nouvelles frontières : Odessa n’est pas loin du delta du Danube, sauf quand on a l’idée saugrenue de faire le trajet à vélo. En ce sens ce premier livre est un merveilleux apprentissage géopolitique, à coup de manivelle, comme disent les cyclistes.
Mais en même temps que d’occasions de rencontres ! Nos deux cyclistes parlent entre autres langues le russe et ce qu’on n’ose plus appeler le serbo-croate, depuis l’effondrement de la Yougoslavie : la Croatie et la Serbie font en effet de gros efforts pour que, dans une génération, on ne puisse plus se comprendre. Cependant me dit un ami, tous se retrouvent pour consulter la météo sur les chaînes de Belgrade. Ce qui nourrit la « Yougostalgie ».
Rencontres avec des logeurs, des tenancières de gargotes, des types qui conduisent les bacs, à grand renfort d’eau-de-vie de prune.
Que de temps pour trouver l’itinéraire le plus court ou du moins le plus proche du Danube, qui devient sentier puis s’épuise au milieu des ronces et il faut alors rebrousser chemin.
Le second livre dissimulé ici est une recherche de la Zyntarie, pays imaginaire inventé par le jeune Jérémie (l’auteur) alors qu’il n’avait pas encore dix ans, pays flottant en Europe de l’Est comme un vêtement trop grand. L’invention de la Zyntarie correspond à la chute du Mur de Berlin (le petit Jérémie a alors neuf ans) et à l’effondrement de la mythologie des démocraties populaires. La Zyntarie est bien utile à nos deux cyclistes, pour éviter l’émiettement territorial des nationalismes agressifs et se référer à une sorte de communauté de paysages, même s’ils sont faits de carcasses rouillées d’usines, de trous dans les routes où il y a eu autrefois de l’asphalte.
On passe enfin de la Zyntarie à une Europe de l’Est géographique où les souvenirs plus récents d’Emmanuel Ruben viennent prendre leur place. Et c’est là le troisième livre.
C’est le fruit d’une vaste culture, appuyée sur plusieurs années gyrovagues, dont témoignent au moins deux autres livres, un roman « La ligne des glaces » (Payot-Rivages 2014), située sur les rives orientales de la Baltique, et un essai « Le cœur de l’Europe » (La Contre-allée 2018).
C’est là dans cette Europe méconnue plus qu’oubliée, priée de se conformer au modèle de l’Ouest du continent, trainant des mémoires du XX° siècle pas toujours glorieuses, tentant d’essuyer les traces d’empires dont ses peuples furent les sujets longtemps soumis, c’est là qu’Emmanuel Ruben ressent « l’extase géographique ». En voilà un beau sujet et un noble sentiment !
Cette Europe des confins oubliés, ces peuples au destin contrarié, Emmanuel Ruben sait en lire les signes. Savoir qui provient de longs mois passés en Ukraine, et à Novi Sad en Serbie, sans compter les Pays Baltes. Mais aussi savoir acquis au cours de lectures très variées, aussi bien dans les diverses sciences sociales que dans une connaissance précise des ouvrages littéraires des pays concernés. Savoir appris dans la lecture des paysages, héritage des études de géographie. Il s’extasie devant une Europe qui dans ses secteurs ruraux lui paraît celle du « Moyen-Age » Et de décrire une scène de moisson avec des faux et des gerbes qu’on lie sur le champ au moyen une poignée de paille avant de les regrouper en grosses meules. En France, de multiples villages ont vécu dans ce Moyen Age jusqu’en 1950. Et c’est vrai que la vision d’un paysan assis sur un tabouret dans une prairie où rumine une vache, en train de traire son lait dans un seau a quelque chose de rafraichissant. Sauf pour le paysan en question qui voudrait bien être débarrassé de cette corvée.
Dans sa quête d’une Europe de ses vœux, il oppose les témoignages conservés des langues perdues au globish qui lui paraît la langue conquérante de l’Ouest. Cette quête révèle une profonde connaissance de ces confins orientaux, que le lecteur partage en apprenant tout des Gagaouzes ou des Lipovènes. Ce qui ne va pas sans quelque surprise. Tout ce qui est slave est vu d’un bon œil. Tout ce qui rappelle la Turquie également, pourvu qu’elle soit ottomane. L’extase géographique peut surgir à la vue d’un minaret. Tout ce qui rappelle les Habsbourg est à rejeter, car ils furent les oppresseurs de leurs minorités. On rejette aussi la Roumanie, qui s’est mal comportée avec la Bulgarie, et avec qui elle s’est disputée la Dobroudja du Sud : le « Quadrilatère ». Très profondément choqué par les cohortes de réfugiés qui se heurtent aux barbelés dressés à la frontière hongroise par Victor Orban, dans leur marche vers l’Union Européenne, l’auteur voit cette dernière comme un foyer d’égoïsme. Et de moquer dans un même mouvement la « suissisation » de cette Europe de l’Ouest, ses champs trop bien peignés et même ses pistes cyclables dépourvues de poésie. Pourtant les réfugiés qui se pressent sur les routes ne demandent rien d’autre que d’être « suissifiés ».
On regrette que dans cette détestation de Bruxelles on fréquente des gens peu recommandables dont la liste serait longue, dans et hors de l’Europe.
Mais soyons indulgents : tout ceci est le produit de l’« extase géographique ».
Michel Sivignon, 1er avril 2019
