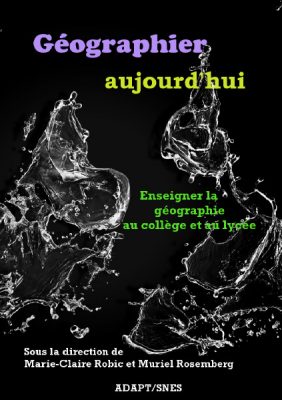« Géographier aujourd’hui au collège et au lycée », avec Bertrand Pleven, PRAG à l’ESPE de Paris, doctorant, UMR Géographie-Cités, EHGO, au Bar de la Poste (FIG – Saint-Dié-des-Vosges) le dimanche 2 octobre 2016.
Sous la direction de Marie-Claire Robic et Muriel Rosemberg avec les contributions de Bertrand Pleven, Arnaud Brennetot, Julien Champigny, Guilhem Labinal, Caroline Leininger-Frézal, Didier Mendibil, Marielle Wastable, 340 pages, 30 €
L’invité du dernier Café géographique de l’édition 2016 du Festival International de Géographie est Bertrand Pleven. Ses trois interventions de ce week-end ont fait apparaître ses multiples casquettes : celle d’un doctorant engagé dans la réalisation d’une thèse de géographie sur « les territoires urbains dans le cinéma contemporain », puis celle du professeur à l’ESPE de Paris, où il prépare les étudiants au CAPES de Géographie. C’est en tant que contributeur à l’ouvrage Géographier aujourd’hui : enseigner la géographie au collège et au lycée (dir. Marie-Claire Robic et Muriel Rosemberg), paru en 2016 aux éditions ADAPT/SNES, qu’il s’exprime lors de cette rencontre qui, bien qu’elle ait repris dans son intitulé le nom de l’ouvrage, se veut informelle, non publicitaire et ouverte à la construction d’une réflexion collective autour de trois questionnements que le conférencier propose comme lignes directrices du débat : il s’agira d’abord de se demander « où nous situent les programmes », pour réfléchir à « quelles balises utiliser » pour « géographier » et enfin interroger « la carte de la géographie scolaire aujourd’hui », qu’il faudrait connaître et comprendre pour savoir comment « l’habiter », « s’y mouvoir », bref, pour ne pas « subir » les programmes, mais « les transcender ». Bertrand Pleven ouvre ainsi une conversation dont la dimension réflexive est double : il s’adresse ici aux enseignants soucieux de réfléchir (à) leurs pratiques, leurs positionnements et leurs trajectoires, mais aussi aux géographes, enjoints à observer les géographies universitaire et scolaire comme des espaces différents entre lesquels l’enjeu reste de « faire des ponts ».
On voudrait, dans ce compte rendu, tenter de composer avec la complexité des trajectoires prises par la discussion enclenchée, dans l’optique de produire un discours cohérent et intelligible pour un lecteur non auditeur. On voudrait aussi y restituer une des originalités de ce Café Géographique, qui tient à la forte mobilisation du vocabulaire de l’espace pour désigner et décrire des ensembles dont on n’interroge que rarement la spatialité. C’est moins comme une métaphore que comme un levier de mise en lumière des enjeux et un moyen particulièrement stimulant de penser la géographie (on se réfère par ce terme à la discipline et, plus largement, au corps des savoirs produits afin de penser l’espace) qu’il est ici repris.
La géographie scolaire : un espace, en principe(s)
Bertrand Pleven, en réponse à une première question qu’il incorpore, comme les suivantes, à son discours, présente l’enseignement comme « une géographie appliquée », qui consisterait rien moins qu’en une opération « d’aménagement ». Tout comme certains choisissent d’appliquer la géographie en s’insérant en professionnel de l’aménagement du territoire, on peut très bien choisir, dit-il, « d’aménager l’intelligence géographique des élèves ». Les programmes d’enseignement devraient le permettre, en convoyant les savoirs de référence aux salles de classe, au terme d’un traitement censé favoriser leur accessibilité cognitive. Mais Bertrand Pleven ne tarde pas à montrer qu’il ne suffit pas de convoyer pour « faire pont » : alors que le « temps de pénétration des concepts » dans la géographie scolaire s’accélère, les enseignants sont aussi démunis que leurs formateurs, bien en peine de leur donner les clés de la didactique de théories non encore stabilisées dans la géographie universitaire qui, si elle produit les savoirs de référence, ne participe guère, faute, sans doute, de temps et de soin accordés à la question de la transmission, à ce processus de métabolisation des savoirs, alors que leur contribution est indispensable à ce que le discours conserve sa pertinence et sa cohérence scientifiques. Pour Bertrand Pleven, l’effort doit porter sur l’accompagnement des enseignants, et ce d’autant plus quand, comme les enseignants du premier degré, l’organisation de l’activité de production des savoirs dans l’espace de référence qu’est la géographie universitaire ne leur est guère familière. Pour ceux-ci en particulier, « habiter » la géographie scolaire reste un défi qui ne peut être relevé qu’avec le concours des acteurs d’espaces dans l’agencement desquels la géographie compte. « A qui la charge de faire pont ? », s’enquiert quelqu’un dans l’assistance : « à tous », répond le conférencier, dont la brève et ironique allusion à Michel Lussault, président actuel du Conseil Supérieur des Programmes, montre que l’action politique ne saurait résumer à elle seule l’ensemble des moyens disponibles pour penser et réviser les pratiques des différents acteurs des espaces… géographiques. Encore faut-il qu’ils se reconnaissent habitants des différents espaces dont l’organisation articule la géographie. Autant dire, alors que beaucoup d’universitaires continuent de considérer la géographie scolaire comme un boulet dont il est d’usage de se désolidariser et de faire la critique une fois que l’institution le permet, que ce n’est pas gagné.
La géographie scolaire : un espace, en pratique(s)
Quelqu’un d’autre intervient, rappelant le conférencier à l’intitulé du Café et aux attentes qu’il éveille. C’est une chose de parler de l’enseignement de la géographie – on ne compte plus les Cafés qui ont été consacrés à ce sujet et qui interrogent presque à chaque fois la distorsion manifeste entre les deux « mondes » universitaire et scolaire ; c’en est une autre de discuter du « géographier », qui pousse à quitter le confort de la posture critique pour s’adonner à une praxéologie de l’enseignement de la géographie, comme le promet le livre, et espérer, comme le propose le Café, concevoir une pragmatique. Il ne suffit pas de demander conseil aux universitaires : on n’habite pas la géographie universitaire comme on habite la géographie scolaire. Il y a notamment dans la deuxième une question structurante, celle de « l’incarnation » des savoirs, de sorte à ce qu’elle ne constitue pas un savoir à passer, objectivé et objectivable ; d’une certaine manière, cette question va à l’encontre d’un des principes organisateurs de l’espace de la géographie universitaire, fondé sur la maximisation des distances entre l’observateur et « l’observable », entre le détenteur de la capacité d’objectivation et l’objet. En géographie scolaire, justement, il ne s’agit pas d’objectiver, mais plutôt de « jeter un pont à un autre niveau » : entre l’individu et son environnement, dont il faudrait faire apparaître, en faisant appel à l’expérience commune et aux sensibilités des élèves, les imprégnations réciproques. Mais l’adaptation du « géographier », c’est-à-dire des pratiques de la géographie à l’exigence pédagogique cadre de la géographie scolaire, repose sur la capacité de ses acteurs à produire et à utiliser des dispositifs propres à soutenir et à nourrir leur(s) démarche(s). En parlant de « dispositifs », Bertrand Pleven entend moins faire l’inventaire des outils à disposition des enseignants. S’il recense rapidement les ressources disponibles en les classant en trois « pôles » de diffusion, didactique, institutionnel (les fiches Eduscol) et documentaire (revues de type La Documentation Géographique ou Géoconfluences), les exemples qu’il mobilise dans sa démonstration, d’une couverture de Paris Match aux résultats d’une recherche dans Google Images, montre bien que n’importe quel objet peut faire support ; preuve, comme l’a formulé le géographe Pascal Clerc présent dans la salle, que « le document géographique n’existe pas en soi ». Se pose plutôt la question de la capacité des enseignants à configurer les « éléments » dont il dispose (Bertrand Pleven projetait, au tout début de son intervention, une diapositive rappelant la distinction que faisait Lakanal entre « l’abrégé » et « l’élémentaire »…) au sein d’une séquence pédagogique qui constitue rien moins qu’un programme de construction et de déconstruction d’une ou de plusieurs « mises en ordre du monde ».
La géographie scolaire : un espace, sérieux
En réponse à la question d’un auditeur peu convaincu par un « géographier » qui n’accorderait qu’une place limitée, voire nulle, à l’expression de « l’espace vécu » des élèves, Bertrand Pleven déclarait, devant un auditoire hilare, qu’on « ne peut pas être dans la compétition de l’entertainment », non seulement parce que cela ne « marche pas », en dépit de l’énergie qu’y investissent spécialistes des séries télévisées et autres géographes gamers qui pensent, parce qu’ils en auraient fait leur sujet de prédilection, pouvoir tenir la cadence de l’évolution des préférences des élèves, mais aussi parce que le rôle de l’enseignant est peut-être justement « de ne pas aller dans leur sens ». « Il faut qu’on les déplace », affirme-t-il encore ; « leur montrer qu’un document peut être passionnant, parce qu’il soulève des enjeux, parce qu’il fait état d’une tension entre le visible et l’invisible ». « Géographier », ce serait donc aussi placer les élèves dans et face à des postures différentes – les faire changer de place, de « point de vue », comme l’exercice du « Pont de l’Île de Ré », qui consisterait à montrer aux élèves qu’en pratique comme en politique, un point de vue doit toujours être complété, ne serait-ce qu’en prêtant attention aux évolutions du sien au gré des rééchelonnements du rapport de distance avec le document étudié. La couverture de Paris Match est un support particulièrement « fertile » (car facile : aurions-nous les mêmes réflexes pour une photo non sourcée ?) pour se rendre compte de la multiplicité des pistes interprétatives et heuristiques qu’ouvre ce jeu avec la distance, qu’il revient à l’enseignant organisateur de l’exercice de conduire. Il pourra, dans un premier temps, accorder aux élèves un temps de « réalisme naïf », pour lier le document aux réalités qu’ils connaissent. Mais l’objectif sera de glisser vers une réflexion sur la mise en forme du monde qu’opère le document et sur la manière dont ce traitement médiatique nous place, en même temps que sur la manière dont, en le passant au crible d’une analyse et d’une interprétation qui nous appartient, nous le plaçons. Le même exercice pourrait être effectué avec un manuel pour appui, si les enseignants avaient suffisamment de recul pour proposer un regard critique sur « l’écriture géographique » que constitue le programme, sur le pavage de mots et d’images qui forme le manuel, trop rarement considéré comme un matériau. Une telle approche n’est pas sans rappeler la démarche scientifique ; c’est donc bien qu’entre les exigences d’un chercheur et celles d’un pédagogue, des passerelles sont possibles.
Sérieux, l’espace de la géographie scolaire que présente et auquel appelle Bertrand Pleven le paraît d’autant plus qu’il s’autonomise. Il s’autonomise, et il « s’autorise », pour reprendre les mots d’un principal de collège présent dans la salle, qu’il disait adresser à son équipe pédagogique dont il reconnaissait qu’elle manquait parfois d’audace dans son action organisatrice des ressources disponibles pour construire son cours à la fois comme leçon (ce qui est transmis) et comme situation (les conditions de la transmission), au grand dam des inspecteurs qui s’attacheraient de plus en plus à évaluer les manières dont l’enseignement rend acteurs ses élèves. Non seulement il s’autorise à assumer la différence structurelle de la géographie scolaire par rapport à la géographie universitaire, en faisant avec l’espace, c’est-à-dire en se situant au-delà des attitudes caricaturales d’inaction (refus de sa position d’acteur au sein du champ de la géographie scolaire, soumission aux programmes) et d’imitation (des logiques de la géographie universitaire dans le champ de la géographie scolaire, subversion critique des programmes), mais aussi en construisant cette différence en proposant des outils d’analyse pertinents. Bertrand Pleven utilisait comme premier exemple la fameuse publicité BMW dont le slogan, « Devenez nul en géographie », a fait des émules parmi les intéressés. L’exercice consiste, dans un premier temps, à « démythifier » la mise en forme du monde que promeut la publicité et qui remet explicitement en cause le principe, cher aux géographes, que l’espace compte. Placer les objets rassemblés dans cet espace urbain « de synthèse », utopique, sur une carte, peut être une première étape de la prise de conscience de la spatialité des phénomènes. A en croire la logique de l’exercice, il faudrait les en convaincre, en usant d’artifices rhétoriques importés des Etats-Unis (« montrer l’arrière-cuisine », c’est-à-dire expliciter les conditions et les choix qui ont présidé à l’élaboration du cours) qui permettraient, selon Bertrand Pleven, d’impliquer les élèves dans le processus de construction des savoirs et de leur donner envie d’y contribuer. Mais à l’origine de l’exercice, il y a une interrogation séminale, qui empêche de se livrer à une défense aveugle pour sa paroisse cognitive-objective : celle du « sens » même de « géographier aujourd’hui ». « Ce que dit BMW n’a-t-il pas aussi sa place dans les salles de classe ? », provoque Bertrand Pleven. « Nos élèves baignent là dedans », poursuit-il. En géographie scolaire, la posture critique systématique vis-à-vis de documents détracteurs de la spatialité des sociétés n’est pas viable, pas plus que ne l’est l’absence de distance critique vis-à-vis des concepts produits par la géographie universitaire, pour lesquels la géographie scolaire, tenue de se synchroniser avec le monde que vivent les élèves, constitue un véritable crash test : résisteront-ils à leur intégration dans une configuration qui n’est pas celle, adaptée à ce qu’ils prospèrent, de la géographie universitaire, bref, à l’épreuve de l’anachorisme ? « Géographier aujourd’hui au collège et au lycée », c’est peut-être oser dire et rappeler que, comme l’urbain, « dur à dire », ou la banlieue, qui n’est pas la suburb, l’espace ne va pas de soi.
Bertrand Pleven conclura son intervention, fortement rallongée par les débats qu’elle a suscité (la temporalité de l’intervention n’est décidément pas la même que celle de la discussion), par une courte réflexion sur les outils cartographiques que les enseignants donnaient effectivement aux élèves. S’y pose la question plus classique de l’exercice de la carte mentale, peu académique et parfois gênant pour des élèves réticents à représenter leur espace intime. La carte est abordée dans ses dimensions éthique et artistique ; on n’oublie pas pour autant qu’elle sert aussi à (s’)orienter. En se demandant « comment faire une carte sensée de l’enseignement de la géographie ? », et en proposant de le faire à l’aide d’un « fil conducteur » (une thématique, par exemple, qu’on aborderait avec une entrée différente à chaque niveau), Bertrand Pleven confirme la visée programmatique de son propos et montre qu’il y avait toujours une raison, et une raison non promotionnelle, à préférer le terme « géographier » utilisé dans le livre (dont il aura, en fin de compte et comme promis, à peine parlé) à celui de « géographie » : il était bien question d’action.
Compte rendu rédigé par Mélanie Le Guen