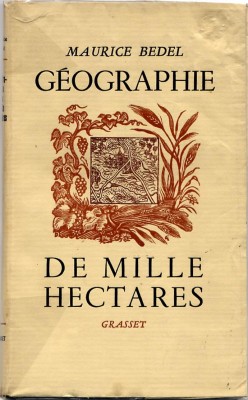Selon la définition de l’INSEE, « l’intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d’un établissement public soit pour assurer certaines prestations (ramassage des ordures ménagères, assainissement, transports urbains…), soit pour élaborer de véritables projets de développement économique, d’aménagement ou d’urbanisme ».
Si les premières formes de coopération intercommunale sont apparues voici plus de cent vingt ans (suite à la loi du 22 mars 1890 permettant la création d’un syndicat intercommunal à vocation unique), les groupements intercommunaux prennent une place croissante dans l’action publique locale au cours des années 1990, notamment grâce aux lois du 6 février 1992 et du 12 juillet 1999 qui les ont renforcés puis simplifiés, et à celle du 13 août 2004 visant à améliorer leur fonctionnement. Ils couvriront bientôt presque tout le territoire national. [1]
Récemment, la loi du loi du 16 décembre 2010 sur la réforme territoriale a bénéficié d’un écho médiatique important sur des aspects quelque peu controversés, tels que l’élection des conseillers territoriaux, mais les différents aspects du volet intercommunal ont finalement fait l’objet du plus grand consensus. Néanmoins, cette loi, dont l’un des objectifs est « l’adaptation des structures à la diversité des territoires » aura rapidement des conséquences importantes auxquelles ce Café Géo va s’intéresser.
Cécile JEBEILI, Maitre de Conférences en Droit Public à l’Université Toulouse II le Mirail, se propose de présenter les dispositions les plus innovantes de cette réforme en ce qui concerne les territoires, la gouvernance, les moyens de l’intercommunalité ainsi que les nouvelles formes de coopération (métropoles, pôles métropolitains, communes nouvelles) et d’en offrir une lecture critique.
Dans un second temps, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, vice-présidente de la Communauté d’agglomération de l’Albigeois (C2A), fera notamment le point sur les différents enjeux de l’intercommunalité pour le citoyen.
Déjà compétente en matière de transports urbains, d’habitat, de développement économique, des questions des espaces aquatiques, de la collecte et du traitement des déchets, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la C2A a récemment franchi de nouveaux caps, notamment avec les transferts de compétences concernant la voirie, l’assainissement dans son ensemble, l’éclairage public, les médiathèques, les déplacements doux et la propreté.
La C2A a été créée au 1er janvier 2003 en regroupant 16 communes (dont 13 étaient déjà réunies au sein de deux Communautés de communes), avant d’accueillir une 17ème commune l’année suivante. La C2A s’étend sur 281km² et comptait, d’après l’INSEE, 82.652 habitants au 1er janvier 2010.