Partout sur le globe, des villes, des pays, des montagnes, des fleuves, des déserts, des îles, ont été nommés par les Européens au gré des explorations et des colonisations, à partir du XVe siècle. Dans sa préface, Christian Grataloup souligne le fait que de très nombreux toponymes sont l’héritage du fait colonial, même s’ils reprennent des noms locaux, plus ou moins déformés et européanisés. Il invite à « picorer » l’ouvrage de Nicolas Perrot, qu’il qualifie de « buffet géographique ». Alors, picorons ensemble cette sorte de dictionnaire qui passe en revue une grande partie des lieux du monde découverts puis ayant appartenu à des Européens.
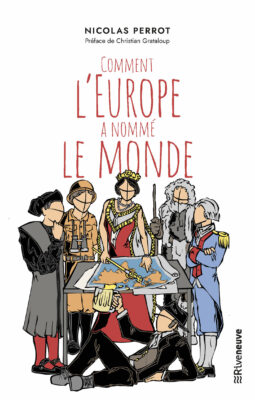
Nicolas Perrot, préf. de Christian Grataloup. Comment l’Europe a nommé le monde. Riveneuve, 2025
Face à des terres « découvertes », en effet, par des Européens, s’est posée la question de les nommer, ne serait-ce que pour en prendre possession. Comme on le dit souvent, nommer, c’est pouvoir contrôler.
C’est un mouvement toponymique qui prend ses racines dès les premières explorations européennes, faites par les Scandinaves qui utilisèrent, pour nommer les terres dévoilées, des caractéristiques géographiques : la présence de moutons (Féroé), de glace, ou de verdure.
C’est une manière de nommer les lieux qui a perduré dans le temps, et tout à fait naturelle. Ce sont ainsi des caractéristiques géographiques, voire botaniques, qui vont aider à remplir les cartes : l’Australie, la terre des Perroquets qui deviendra le Brésil en sont des exemples.
Mais le calendrier a aussi eu son importance. On pourrait ainsi suivre presque jour par jour la progression de Christophe Colomb dans les Antilles lors de ses voyages. On saura ainsi que Saint-Martin a été découverte en novembre 1493.
Rendre hommage à un explorateur (il y a, dans les faits, très peu de femmes à voir leur nom sur les cartes) est également fréquent, mais ces noms ont souvent été décidés a posteriori : le détroit de Magellan est un honneur posthume, et Charcot a rusé par modestie pour ne pas nommer en sa mémoire l’ile homonyme.
Mais on peut aussi vouloir honorer (plus ou moins sincèrement mais cela l’Histoire ne nous le dit pas) un chef ou un souverain. La reine Victoria est à la toponymie mondiale ce que le général de Gaulle est à l’odonymie française : son nom est partout, des îles arctiques au centre de l’Afrique, marque incontestable (et pourtant contestée) de l’hégémonie coloniale britannique à son zénith.
À un niveau moins élevé, des supérieurs hiérarchiques auront donné leur nom à des archipels, des Sandwich aux Seychelles sans pour autant avoir navigué. Ce peut être même être un moyen d’attirer des colons ou des investisseurs d’une nation bien précise, comme Bismarck, capitale du Dakota du Nord.
Enfin, les Européens ont souvent reconnu dans des terres lointaines des contrées qui leur rappelaient leur patrie et ont voulu en recréer, quelque part, un double. Si la Nouvelle France n’existe plus, on parle encore de la Nouvelle-Zélande, des Nouvelles Galles du Sud ou de la Nouvelle-Calédonie.
La toponymie est un indice important sur l’ancienne présence coloniale de peuples européens. La trace de la Louisiane est visible très au nord, et nombre de pays africains gardent encore un lien avec la France par le nom de certaines de leurs villes. Mais, et nous voyons cela en creux, comme tout cela est très politique, il est fort logique que les bouleversements du monde, notamment depuis le milieu du XXe siècle, aient aussi engendré de forts changements dans le domaine toponymique. Ainsi, plus de Haute-Volta ou de Rhodésie. Dans les deux cas, ces pays ont adopté des noms provenant de langues locales.
Nommer, c’est donc contrôler, c’est bien ce que montre cet ouvrage, à travers plus de 450 exemples répartis autant sur les océans que sur les continents.
Équitablement ? Non, car, et c’est aussi l’un des aspects importants qui est abordé, on ne peut véritablement nommer que ce qui n’a pas encore de nom local. Quand la région est occupée par d’autres êtres humains, leur propre toponymie peut être réutilisée, et elle le sera d’autant plus que les peuples en question auront pu résister à ce que l’on a souvent appelé le « premier contact ». C’est ainsi que des pays comme l’Inde ou la Chine, sièges, lors de ces premières rencontres, de puissantes civilisations ayant pu résister à la fois aux armes et aux maladies européennes, ne présentent que très peu d’exemples de toponymes allochtones.
C’est moins le cas en Afrique, colonisée de manière plus intense, surtout à partir du XIXe siècle. Mais l’Amérique, dont la population chuta drastiquement dans les décennies et siècles suivant la conquête, devint pour ainsi dire une terre presque « vierge » pour la toponymie européenne, à mesure que les colons également fondaient des villes et des villages. La même dynamique eut lieu en Antarctique qui, du fait de son isolement, ne fut abordée par les êtres humains (en l’occurrence des Européens) qu’au début du XIXe siècle.
Voici donc ce fameux « buffet géographique » qu’il nous est proposé de déguster, sans ordre précis, à notre bon vouloir.
Nicolas Perrot, janvier 2026
