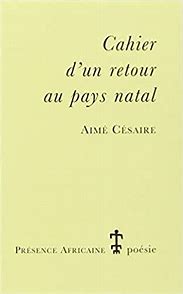
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Présence africaine, poésie, 1983
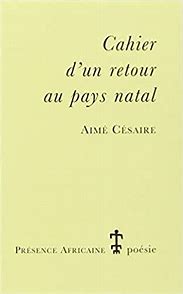
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Présence africaine, poésie, 1983
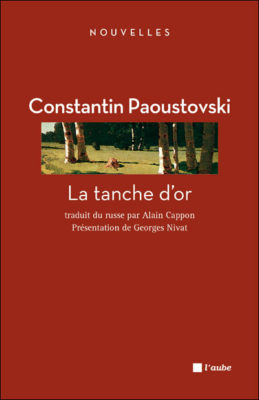
Constantin Paoutovski. La tanche d’or. Ed. de l’aube, 2018. https://editionsdelaube.fr/catalogue_de_livres/la-tanche-dor/
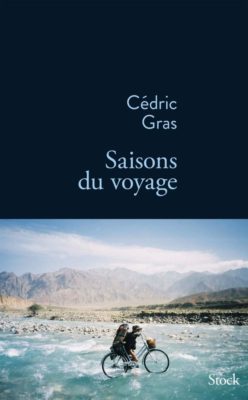 Cédric Gras a reçu une formation de géographe. Il figure dans la petite cohorte des géographes de sa génération qui se sont « évadés » vers la littérature, avec Sylvain Tesson et Emmanuel Ruben. « Évader » n’est pas le terme propre qui suppose une géographie ceinte de murs malaisés à franchir. A coup sûr, en tout cas, Cédric Gras s’est évadé du langage géographique et du ton académique, dès les premières phrases de son livre. Un des grands mérites de C. Gras réside dans la qualité de son écriture.
Cédric Gras a reçu une formation de géographe. Il figure dans la petite cohorte des géographes de sa génération qui se sont « évadés » vers la littérature, avec Sylvain Tesson et Emmanuel Ruben. « Évader » n’est pas le terme propre qui suppose une géographie ceinte de murs malaisés à franchir. A coup sûr, en tout cas, Cédric Gras s’est évadé du langage géographique et du ton académique, dès les premières phrases de son livre. Un des grands mérites de C. Gras réside dans la qualité de son écriture.
Ce livre est une réflexion sur l’expérience du dépaysement plutôt que du voyage. Il comporte des chapitres très autobiographiques, mais il dépasse sans cesse cette dimension personnelle.
Le texte qui suit résulte du rapprochement suscité par la lecture successive de deux ouvrages : Paris de ma jeunesse de P. Le-Tan, constitué de 28 textes courts (une à trois pages) chacun référé à un lieu parisien, écrit en 1988, réédité et complété en 2019 – très peu de temps avant la mort de l’auteur – préfacé par P. Modiano, et Memory Lane, court texte (une soixantaine de pages) écrit par celui-ci et illustré par celui-là en 1981 ; ce texte, quoique moins connu que d’autres romans de P. Modiano, cristallise les thèmes qui font sa singularité, sa tonalité. Si Patrick Modiano a accédé depuis longtemps a une grande notoriété littéraire et publique (Goncourt en 1978, Nobel en 2014), Pierre Le-Tan est moins connu, bien qu’illustrateur de nombreuses éditions littéraires, concepteur de publicités pour de grandes enseignes. Il est aussi un ami et complice précoce de P. Modiano, notamment dans le petit ouvrage dont il sera question ici, Memory Lane, dès 1981.
Les Cafés géographiques reçoivent ce samedi 18 janvier à l’Institut de géographie Jean-Paul Kauffmann, journaliste et écrivain, pour dialoguer sur la thématique de l’esprit géographique de son œuvre d’écrivain. Une matinée particulièrement réussie autour d’un invité exceptionnel par son histoire personnelle, sa riche personnalité et la qualité de sa production littéraire.
Cette rencontre se présente sous forme d’une conversation avec l’invité (JPK) animée par le trio Claudie Chantre (CC), Daniel Oster (DO), Michèle Vignaux (MV).
Tout le monde connaît les « polars historiques », de Jean-François Parrot (Nicolas Le Floch), Ellis Peters (Frère Cadfael), Van Gulik (le juge Ti) ou I.J. Parker (Sugawara Akitada), mais il existe aussi des polars géographiques. J’ai ainsi visité l’Ecosse en suivant les indications de Ian Rankin, découvert la face cachée de Venise grâce à Donna Leon, suivi à la trace Maigret dans Paris et la liste est loin d’être exhaustive.
Je viens de découvrir, sur le conseil du documentaliste de mon lycée, les trois ouvrages de Ian Manook (pseudo de Patrick Manoukian) qui ont pour cadre la Mongolie. Le talent de l’auteur est de nous plonger dès les premières pages dans une ambiance prenante, dans laquelle on s’immerge très vite malgré l’étrangeté des situations tant les descriptions sont précises et concrètes. Le premier opus met en vedette un inspecteur de police : Yeruldelgger, un vieux de la vieille dont on découvre vite la profondeur et la droiture.
La description de la Mongolie est saisissante. Aux immeubles soviétiques se juxtaposent de récentes constructions plutôt kitch, dans le sillage du boom économique lié à l’exploitation des ressources minérales, dans lequel le pays perd son âme. Si les campements de yourtes voisinent en ville avec des centres commerciaux ou des zones industrielles, continuant à abriter une population qui s’accroche à ses racines, beaucoup de démunis vivent dans les égouts de la ville, proie des trafiquants et des exploiteurs en tout genre. Le maintien de l’âme mongole et d’une culture millénaire n’est plus la préoccupation que d’une minorité, dans un pays balloté entre les ambitions russes, coréennes et chinoises où l’argent semble justifier toutes les abominations et où la corruption est de règle.

Olivier Truc, Le cartographe des Indes boréales, Paris, Métailié, 2019.
Olivier Truc est venu récemment à l’Institut de géographie pour nous parler des Sami aujourd’hui et de leur intégration dans les sociétés d’Europe du nord (voir le compte rendu de Claudie Chantre). Son dernier roman évoque le temps (XVIIème siècle) de leurs premiers contacts avec la Couronne suédoise.
D’abord un titre. Un titre poétique qui renvoie à l’imaginaire de ces hommes du début du XVIIème siècle qui voulaient découvrir le monde et en extraire les richesses symboliques et matérielles. Ne pouvant s’installer durablement ni dans les Indes orientales, ni dans les Indes occidentales, les Suédois ont choisi d’établir leur souveraineté sur les terres du Grand Nord, les terres boréales.
Sous le titre de couverture, une baleine s’acharne, telle Moby Dick, à renverser une chaloupe de marins accrochés à leur rame pour sauvegarder leur vie. C’est à ce monde de baleiniers qu’appartient le héros du roman, Izko.
Monde arctique, ambitions politiques suédoises, chasse à la baleine, société lapone, fanatisme religieux… tels sont quelques-uns des domaines où Izko, évolue avec courage et intelligence. Il nous emmène de Saint-Jean-de-Luz au sud du Portugal et de Stockholm à la mer de Barents, du palais royal aux tentes de Laponie.
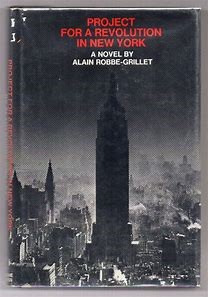 |
 |
Écrivain et cinéaste français, Alain Robbe-Grillet (1922-2008) est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, parus entre 1953 (Les Gommes) et 2007 (Un roman sentimental), et de dix films, sortis entre 1963 (L’immortelle) et 2007 (C’est Gradiva qui vous appelle).
Il demeure en partie connu pour avoir incarné, en compagnie des écrivain.e.s Michel Butor, Nathalie Sarraute et Claude Simon, l’un des chefs de file du mouvement littéraire appelé le « nouveau roman », apparu dans les années 1950[1].
Ce mouvement se caractérise par l’utilisation de règles en rupture avec celles du roman traditionnel, en cherchant notamment à détruire l’illusion du réel, avec par exemple la succession d’événements ne respectant aucune chronologie ou encore la présence de personnages non individualisés.
Si des travaux en littérature et études cinématographiques ont porté sur des thématiques récurrentes dans l’œuvre d’Alain Robbe-Grillet, telles l’érotisme (Colard, 2010 ; Demangeot, 2015), ou encore sur la structure narrative de ses livres et de ses films (Gardies, 1983 ; Allemand, 2010), plusieurs études littéraires se sont également intéressées à la place de l’espace dans certains de ses ouvrages. Ces dernières traitent tour à tour de la représentation et concrétisation sémiotiques de l’espace dans l’œuvre romanesque (Lissigui, 1996), de la subjectivité de l’espace sans cesse adapté à la vision et aux ressentis des personnages (Balighi, 2012), et du positionnement spatial comme moyen d’exister pour le narrateur, comme dans La Jalousie (Sarda, 2016).
Si cette utilisation que fait Alain Robbe-Grillet de l’espace m’a également marqué lors de mes premières lectures, elle m’a aussi conduit à me demander si l’espace et plus largement la géographie ne constituaient pas un moyen, pour l’auteur, de traduire le déroulement de certaines de ses intrigues et de donner davantage de sens à celles-ci.
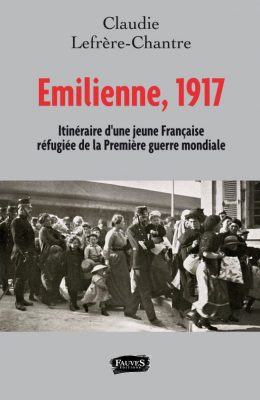
Claudie Lefrère-Chantre, Emilienne, 1917. Itinéraire d’une jeune Française réfugiée de la Première guerre mondiale, Editions Fauves, 2017, 255 pages, 20 €.
Les Français aiment les commémorations historiques. Depuis 2014, la Grande Guerre suscite un intérêt considérable qui se traduit par des manifestations de toutes sortes, des initiatives publiques et privées, des colloques, des publications, etc. Le battage médiatique autour de la commémoration du centenaire de la guerre de 14-18 est soutenu par une véritable déferlante de livres sur la première guerre mondiale, une guerre toujours présente dans la plupart des familles françaises. Dans la production considérable orchestrée par les éditeurs, les sujets « classiques » sont bien sûr abordés mais d’autres questions, bien moins connues, profitent de ce coup de projecteur conjoncturel. Parmi ces derniers sujets, celui des réfugiés français pendant la guerre vient d’être illustré par un livre instructif et passionnant, émouvant même lorsqu’il s’insinue dans la chair et l’esprit de son « héroïne », Emilienne Richard. En février 1917, cette jeune fille lorraine de quinze ans doit obéir à l’ordre de l’occupant allemand qui la contraint à quitter son village de la Woëvre pour un long périple à travers l’Allemagne et la Suisse la menant à Villars-du-Var, un autre village situé à l’autre bout de la France, où elle va vivre la fin de la guerre et quelques années de plus jusqu’en 1923.
L’esprit géographique d’un livre d’histoire
L’auteur – petite-fille d’Emilienne – a bénéficié du journal tenu par la jeune fille sur un cahier d’école entre février 1917 et juillet 1922, seize pages au total dont six seulement consacrées à la période de la guerre. Deux photos de classe d’Emilienne ont déclenché le projet d’écriture, accompagné par des déplacements et des recherches sur les lieux même de l’odyssée, et finalement mené à bien au titre de la mémoire et de la transmission.
Un écrivain, Sylvain Tesson, vient de fouler ce qu’il baptise la France des chemins noirs. Sur les chemins d’une France en berne, il promène sa nostalgie d’un monde perdu, idéal, fait de ruines et de ronces, de parenthèses et d’interstices, perpétuellement défait par des générations d’hommes pressés. Du Mercantour au Cotentin, en passant par le Perche et l’Aubrac, la Margeride et le Bas-Vivarais, il arpente une France intérieure propice à cette « géographie de l’instant » dont il a, mieux que l’intuition, la vocation. Il est tombé, il a mûri, sa prose est devenue mature, plaisante, facile, trop facile peut-être, se révélant sommaire.
Une existence en surchauffe
Cet homme infatigable, dont on ne sait s’il voyage pour écrire ou s’il écrit pour voyager, est certainement aujourd’hui l’écrivain-voyageur français contemporain le plus en vue, et l’un des plus connus du lectorat. Pareille fortune mérite attention, parce qu’au-delà de ce qu’elle nous apprend de l’auteur lui-même, cette popularité est le miroir d’une demande sociale, d’une aspiration croissante vers un je ne sais quoi d’extravagant – au sens premier du mot : menant hors de la voie normale – qu’il faudra interroger. Elle nous renseigne sur une personne, mais surtout, elle nous enseigne sur une époque : arrêtons-nous sur le renseignement, qui peut-être nous dira un peu de l’enseignement.
Partout, on le sait, S. Tesson a roulé sa bosse. À peine sorti de l’adolescence, on le voit pédaler en Islande (1991), non sans une grande part d’improvisation, à une époque où le tourisme y est à la veille d’entamer son grand essor. Trois ans plus tard, il entreprend un tour du monde au long cours, à bicyclette, avec son camarade Alexandre Poussin (1994) : première d’une longue série de cavalcades amicales. Bientôt, il s’enhardit : c’est à l’Himalaya qu’il s’attaque (1997). En surchauffe constante, courant de pics en cols, de cimes en défilés, de parois montagneuses en façades urbaines, cet Homo viator, tour à tour alpiniste, acrobate, cavalier et escaladeur, surfeur et parachutiste, a fait choix de vivre dangereusement, de mener, selon le joli mot de L. Febvre, une existence « de plein vent ».