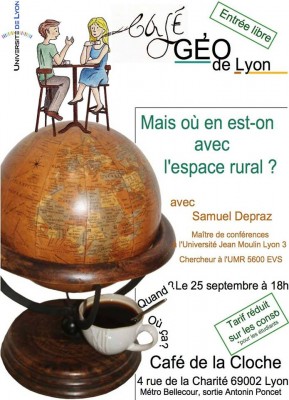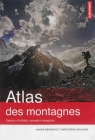Café géographique, Strasbourg,
Mercredi 23 octobre 2013
Curieuse question ! Peut-on parler d’une possible faillite des États africains, comme dans les années 1990 ? « Négrologie : pourquoi l’Afrique meurt », avait écrit Stephen Smith en 2003. C’était le comble de l’afro pessimisme. Un débat avait eu lieu, Boubacar Boris Diop, Odile Tobner et François-Xavier Verschave répondant « Négrophobie » (2005) aux « négrologues ».
Aujourd’hui, on n’est plus dans l’afro pessimisme. Bien au contraire : Courrier international titre en 2013 « Afrique 3.0 » (c’est-à-dire l’Afrique d’aujourd’hui), sous-entendu après « Afrique 2.0 » (les Indépendances) et Afrique 1.0 (la colonisation). Aujourd’hui, les publications vantent l’Afrique, sa croissance, ses changements. Jean-Michel Sévérino, avec « Le temps de l’Afrique » (2010), a été l’exemple type de l’afro optimisme ; sa parole a eu d’autant plus de retentissement qu’il avait été le patron de l’Agence Française de Développement. Les organismes internationaux tiennent tous le même discours. On parle des « lions » africains, on vante la croissance à 5 % par an, on fonde l’optimisme sur la jeunesse du continent. Il y a très peu de voix discordantes : Axelle Kabou (« Et si l’Afrique refusait le développement », 1991) parle d’une révolution chromatique : on est passé du noir au rose.
En fait, répondre à la question posée dépend de la perspective selon laquelle on se place. Il ne faut pas confondre les flux (la croissance, qui est forte) et les stocks (le point de départ, qui est très bas). Ainsi, en termes d’IDH, parmi les trente derniers pays classés, 27 sont africains ; les « intrus » sont l’Afghanistan, Haïti et le Yémen… Le PIB moyen par habitant est sur la planète de 12 000 dollars ; en Afrique, il est de 3 000.
Mais, avec ses 57 États, le continent est très divers. Il y a des États « faillis », comme disent les politologues : la Somalie, le Mali ; des États fantômes, comme la République centrafricaine, le sentiment de délaissement expliquant d’ailleurs la rébellion. Des narco-Etats, comme la Guinée-Bissau, fondant leur quête de ressources sur des trafics juteux. Les conflits de l’est de la République Démocratique du Congo sont récurrents. Sans compter la Libye, dont on ne parlera pas, afin de réserver la réflexion aux pays sud-sahariens. Partout, les États sont fragiles. Mais les situations sont aussi très changeantes. Après des années de guerre, la Côte d’Ivoire retrouve le chemin de la croissance, mais aussi de la sécurité. De même, Libéria et Sierre Leone ont bien redémarré. Il n’y a pas d’Afrique condamnée ; il n’y a pas non plus de bons élèves qui aient réussi définitivement. Certes, peu États ont échappé à la guerre. Le Congo versa dans le conflit civil dans la semaine qui suivit l’Indépendance ; puis il y eut le Biafra, le Tchad à plusieurs reprises, la Somalie, l’Érythrée, etc. Le conflit du Sahara occidental n’est pas réglé. Le Somaliland reste un État qui n’est reconnu par personne, ce qui est quand même étonnant, alors que l’Érythrée et le sud-Soudan, également nés d’un démembrement d’États issus de la décolonisation, l’ont été. Depuis 1960, année de la majorité des indépendances, il y aurait eu en Afrique autant de morts que durant la seconde guerre mondiale. Pourtant, beaucoup de problèmes ont été réglés.
(suite…)