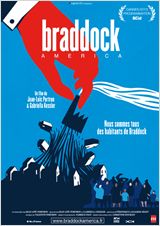Entretien avec Jean-Loïc Portron, co-réalisateur de Braddock America (sortie le 12 mars 2014)
France – 1h43 min
Scénario : Jean-Loïc Portron
Image : Jean-Loïc Portron
Son : Gabriella Kessler
Montage : Véronique Lagoarde-Ségot
Musique : Valentin Portron
« No dirt, no job »
Au Nord-Est des Etats-Unis, la ville de Braddock, ancien bastion sidérurgique, a aujourd’hui perdu de sa superbe. Pourtant, une communauté ébauche au quotidien une action solidaire pour dessiner l’avenir. Dans cette Small town de la « Rust belt », ville « rétrécissante », Jean-Loic Portron filme à travers ce documentaire, co-réalisé avec la new-yorkaise Gabriella Kessler, ce qui sépare Braddock d’une Dead city (Mike Davis).
Entretien avec un historien passionné de géographie, lecteur de Pierre Deffontaines, d’Yves Luginbühl ou encore de Philippe Gervais-Lambony. Il partage avec ce dernier le terrain sud-africain sur lequel il va revenir dans son prochain projet. On retrouve aujourd’hui l’auteur des séries Paysages et Foyers de Création pour Arte, pour la sortie de son long métrage, au cinéma.
Les géographes vous connaissent pour la série Paysages réalisée pour Arte et pour laquelle vous avez reçu le prix Ptolémée en 1997. En quoi Braddock América, votre premier long métrage s’inscrit-il dans la lignée ouverte par cette série?
Jean-Loïc Portron La filiation est évidente pour moi. Braddock s’inscrit dans ma fascination pour les paysages et la volonté de voir le monde évoluer dans les mots et dans les observations de ceux qui le peuplent. Dès l’écriture du scénario, j’évoquais l’image d’un paysage blessé, marqué par des cicatrices. Sur moins de 10 km2, on trouvait sur les deux rives de la Monongahela cinq aciéries, dont quatre pouvaient être embrassées d’un seul regard. Quatre d’entre elles ont été fermées brutalement au début des années 1980. L’effondrement du paysage passe par des absences : celle des fumées ou celle de la neige noire de suie qu’on découvrait au matin. Les couleurs ont changé. Le noir a disparu. Or comme le dit dans le film un policier : « No dirt, no job ». Dirt, c’est plus que les émanations ou la pollution, ce sont les débris, la saleté. Le paysage est redevenu propre. A la fin du film, un ouvrier métallurgiste parle du paysage. Il évoque ses cicatrices. Il parle de paysage blessé… Gabriela Kessler, la co-réalisatrice, en plaisantant, m’a alors demandé si on s’était concerté avant, s’il avait lu le scénario… Cette phrase est sortie spontanément. Ce n‘est pas un hasard : nos histoires sont inscrites dans le paysage. On retrouve naturellement les mêmes mots pour les décrire. Les paysages se retrouvent constamment dans les propos, comme dans ceux du poète sidérurgiste qui ouvre le film. Il explique alors que les gens n’ont pris conscience de la révolution de leur monde qu’à partir du moment où la neige s’est maintenue sur les usines. Auparavant, elle laissait toujours à découvert ces énormes constructions puisque la chaleur des fours ou des hauts-fourneaux la faisait fondre immédiatement. L’enneigement des aciéries (il neige beaucoup dans la région !) inscrivait dans le paysage la fin d’un monde. Mais, si le film parle de destruction, de désindustrialisation, nous refusé de voir ce lieu avec un regard misérabiliste, car le paysage de ces deux villes (Braddock et North Braddock), celui de la vallée de la Monongahela est aussi un beau paysage.
Situé à proximité de Pittsburg, Braddock et les communes environnantes appartiennent au monde des Small towns ?
Jean-Loïc Portron : Braddock se situe à une dizaine de kilomètres de Pittsburg. L’espace est découpé en un grand nombre de petites villes, autrefois des company towns pour la plupart. A partir des années 80, Carnegie, puis US Steel ont pris en main ces villes organisées autour des aciéries. Les compagnies maîtrisaient la ville en dominant le conseil municipal, en ayant la main sur la police ; elles assuraient également le mécénat. Carnegie dotait chacune de « ses » villes sidérurgiques d’une bibliothèque où l’ouvrier était invité à s’instruire pour s ‘élever… Après 12, parfois 16 heures de travail quotidien, sept jours sur sept, cette noble invitation était quasi surhumaine! Ces villes ont brutalement gonflé avec l’arrivée de migrants slovaques, ukrainiens, polonais, hongrois, italiens, alsaciens parfois, qui débarquaient avec leurs religions catholiques ou orthodoxes mais aussi avec leurs idées politiques, souvent révolutionnaires. On en trouve encore aujourd’hui les traces : toutes les gauches sont représentées à Braddock et dans les environs, jusqu’au Parti communiste. La gauche américaine existe ! Et je voulais que l’on l’entende, dans sa pluralité, dans le film. Ces paroles engagées s’inscrivent dans un passé encore très présent dans les mémoires. Les pères et les grands-pères des intervenants du film ont participé à des grèves d’une violence stupéfiante, où ils risquaient leur vie. Le sang coulait à flot. Le film y fait allusion sous formes d’archives. Les paroles font aussi référence à ce « sang des ouvriers » qui recouvraient les rues de Braddock après les heurts. On se trouvait dans un non-lieu de la démocratie. Les intérêts de la puissance industrielle états-unienne passaient avant tout : les syndicats étaient interdits dans les aciéries, la police montée rentrait dans les maisons, détruisait, frappait et tuait s’il le fallait. Il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour que ces « hunkies » (terme extrêmement péjoratif) soient considérés comme des Américains à part entière. Cette violence, les intervenants du film la porte en eux, mais ils ne vivent pas dans la nostalgie : le souvenir des luttes passées est projeté dans le présent ; ils craignent de voir disparaître les droits conquis par leurs pères. Ce passé de lutte est le ciment de leur solidarité actuelle. Les ouvriers ne sont pourtant pas dupes des réalités : 6000 travailleurs qui sortaient des aciéries toutes les huit heures et qui vivaient autour de l’usine, dans la même communauté, cela créait un sentiment de puissance : on faisait bloc et cette solidarité d’alors leur semble aujourd’hui distendue. En bons géographes, ils constatent que la dispersion de l’emploi (les usines, éloignées les unes des autres, concentrent aujourd’hui une centaine emplois en moyenne) limite d’autant leur pouvoir de masse. Leurs analyses sont remarquablement pertinentes : Ces personnes qui semblent tout droit sortis de films ou de séries-télévisées s’exprimer avec une éloquence, une puissance d’expression, qui nous a beaucoup frappés. Dès qu’ils ouvraient la bouche, les archétypes, les clichés disparaissaient. C’est quand même un film où des policiers américains nous parlent de la lutte des classes…
Pourquoi être allé filmer à Braddock et pas ailleurs ?
Jean-Loïc Portron : Je suis avant tout historien. Et ce choix est lié à mon goût pour l’Histoire. Tout part d’un souvenir scolaire, j’avais un professeur d’Histoire-Géographie qui lors d’un cours sur la Guerre de Sept ans opposant Britanniques et Français avait fait allusion à un meurtre commis par le jeune Washington, le futur président des Etats-Unis. Il n’avait pas eu le temps de nous raconter cette histoire très intrigante: comment ce saint laïc avait-il pu commettre un meurtre ? Cet incident intervient en fait lors d’une bataille qui visait à empêcher les Français de relier leurs positions du Canada à celles de la Louisiane ; bataille qui fut un désastre pour les Britanniques, puisqu’ils furent massacrés par les Français et leurs alliés indiens. Ce combat a déclenché la Guerre de sept ans mais elle a aussi permis au jeune Washington de constater que les Anglais n’étaient pas invincibles. Cette date compte donc dans l’Histoire des Etats-Unis et fut intégrée au récit national. La bataille eut lieu là, à Braddock. En voulant voir le champ de bataille sur Google earth, je suis tombé sur une énorme aciérie ; en fait, la première aciérie moderne des Etats-Unis, construite par Carnegie quelques 120 ans après… Braddock était donc le lieu de deux évènements majeurs : le point de départ de l’indépendance et le point de départ de l’empire industriel, le tout concentré dans un lieu très petit. Il y avait là matière à raconter.
Sans oublier la désindustrialisation, le passage à une autre civilisation et sa marque dans le paysage… J’aurai pu filmer cela à Longwy, ou encore à Florange et dans la vallée de la Fensch. Mais de beaux films avaient déjà été faits sur l’acier en France. Plus encore, je cherchais, à faire un pas de côté pour aborder cette question avec un regard neuf, sans repères, comme un explorateur, en partant de l’observation des lieux et l’écoute des gens. Bien sûr, je me suis préparé par des lectures. Et naturellement, mon association avec Gabriela Kessler, qui est américaine, a été essentielle.
Comment rend-on compte d’une expérience habitante en outsider ? Comment avez-vous envisagé le « terrain » Braddock et quelle forme a pris son « exploration » ?
Nous sommes restés trois mois sur place. Nous avons d’abord marché pour nous imprégner des lieux. Nous avons participé à la vie de la communauté, en filmant tous les événements qui la constituaient. Nous avons commencé avec les paysages, puis les habitants de Braddock sont naturellement entrés dans le champ de la caméra. Nous avions préalablement rencontré toutes les institutions, les associations qui font la vie de Braddock pour leur soumettre l’idée du film : la mairie, la police, les associations de sidérurgistes ou encore le « Slovak Social Club », le dernier représentant de ces clubs formés par les immigrants pour s’entraider et résister à la violence de ce nouveau monde. Aujourd’hui, on s’y réunit pour boire une bière entre amis et chanter. Très vite, s’est créée une complicité avec les habitants de Braddock qui se sont approprié le film. Ils en avaient immédiatement compris le sens, ils savaient ce qui devait être filmé : les policiers nous entraînaient dans leur recensement des maisons abandonnées, qui sont un fléau en raison notamment des incendies ; les pasteurs, dans les églises, prononçaient des sermons qui renvoyaient à Braddock, à son passé et à la violence sociale qui l’avait marqué. Quand nous avons filmé dans une église baptiste le jour de Pâques, le sermon portait sur la rédemption du Christ qui avait été humilié et supplicié, et les paroles du prédicateur évoquaient métaphoriquement la situation de Braddock et de sa population noire : « On nous avait condamnés, et nous avons survécu ».
Plus formellement, comment avez-vous construit l’articulation entre ces paroles habitantes et l’environnement spatial ?
Il y a plusieurs types de séquences dans le film. Quatre intervenants font figure d’ « oracles ». Ils sont la voix de la ville. L’idée était de les inscrire dans leur décor, dans leur espace domestique, à la manière de Walker Evans, en leur laissant la possibilité de se déplacer, de sortir du cadre s’ils le souhaitaient. Le dispositif donne à leur parole à la fois de l’intimité et de la gravité. D’autres séquences relèvent plus de situations dans lesquelles on observe les habitants dans l’action, dans un combat quotidien qui passe, par exemple, par le nettoyage collectif des rues, où la survie du terrain de baseball. Ces séquences sont importantes car elles montrent bien qu’il n’y a pas rupture entre les habitants et les lieux. Et puis il y a les paysages. Certains sont filmés par des travellings qui mènent vers la dernière aciérie encore en activité. Le mouvement évoque l’attraction inquiétante de ce Moloch industriel, auquel même les grandes productions d’Hollywood n’ont pas accès pour tourner. Les paysages, on l’a compris, jouent un rôle important dans le film. Ils cherchent à rendre compte de la véritable beauté des lieux et se refusent à toute esthétique de la destruction et de la déréliction. Il y a une forme de beauté à Braddock, parce que ses habitants le veulent ainsi : ils s’acharnent à maintenir leur ville, à la rendre agréable. Filmer la ville comme elle est, lui rendre justice, était donc une forme de respect.
Braddock, lieu peu connu en France est pourtant un lieu assez important de l’imaginaire cinématographique états-unien. Comment vous êtes-vous notamment situés par rapport à l’épique du désenchantement porté par la publicité Levi’s (tournée juste avant votre arrivée sur place) et la vision apocalyptique projetée par le film John Hillcoat, La Route (2009) ?
D’ailleurs, un film hollywoodien se tournait en même temps que le notre: Les brasiers de la colère sortit début 2014 en France. On se croisait, on tournait dans des lieux communs… mais pas avec les mêmes moyens : ils étaient une armée, nous étions deux. Sinon, LE film de cette vallée, c’est Voyage au bout de l’enfer (The Deer Hunter) de Michael Cimino sortit en 1978 ! Cimino a construit une ville imaginaire en empruntant aux différentes villes sidérurgiques de la vallée de la Monongahela. Il la nomme Clairton, d’un nom d’une ville située à une vingtaine de kilomètres en amont de Braddock. En réalité, on produit à Clairon le coke nécessaire aux aciéries. La population qu’il met en scène est essentiellement russe ou ukrainienne, comme à Homestead, la ville qui fait face à Braddock, alors que cette dernière était plutôt slovaque, polonaise et italienne. En revanche, la publicité pour Levi’s que nous avons intégrée dans le film a blessé les habitants de Braddock: elle dit que les gens sont partis, elle évoque un nouveau départ… Les gens disaient : nous, on est resté ! Nous avons une histoire, et quelle histoire ! C’est ici que la puissance des Etats-Unis a été créée. Par l’acier ! Ce n’est pas un territoire vide, à conquérir, comme le dit Levi’s, qui réduit notre histoire à néant.
Braddock vu par Levi’s: une “nouvelle frontière”, campagne Go forth to work 2010
Visible sur
http://www.youtube.com/watch?v=2YyvOGKu6ds
Quant au film La Route, adaptation du roman éponyme de Cormac McCarthy, il situait Braddock et son humanité cannibale hors civilisation. Y avait-il, de votre part, une volonté de ramener un peu de réel, de vous situer en contrepoint de ces représentations ?
Oui, le film montre que Braddock n’est pas une terre vierge. C’est un lieu d’histoire, de fierté. Ses habitants n’oublient pas le passé. Il fonde leur engagement actuel. Le dispositif visait à leur rendre la parole et à écouter leur savoir sur l’histoire et la géographie des lieux.
Votre film a été projeté fin 2013 au Three Rivers Festival de Pittsburg, quelles ont été les réactions ?
C’est un grand souvenir, tout comme la projection organisée le jour suivant à Braddock même. A Pittsburg, la séance était sold out depuis deux jours, et pourtant, le jour de la projection, il y avait une queue contenant trois fois plus de personnes que la salle ne pouvait contenir. A l’issue de la projection, les spectateurs expliquaient : on a tous un lien avec Braddock ou avec une ville voisine. On est tous concerné. Ils nous questionnaient : « Comment les Français comprennent-ils le film ? ». Nous leur avons répondu que c’était notre histoire aussi. L’histoire de Braddock, aussi particulière qu’elle soit, est universelle. Au-delà des détails, de quelques singularités, les destins sont communs.
Braddock est-il un film politique ?
Oui. Ce n’est pas un film militant, mais c’est un film politique.
Entretien réalisé le 6 mars 2014 par Bertrand Pleven.
Pour aller plus loin :
Le site officiel du film, avec notamment le dossier pédagogique réalisé par Emilie et Joseph Viney http://www.braddockamerica.blogspot.fr/>
La filmographie de Jean-Loïc Portron : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-ethnologique/Audiovisuel/Regards-sur-des-realisateurs-de-la-Mission-du-Patrimoine-Ethnologique/Jean-Loic-PORTRON