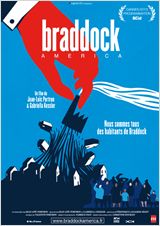Le massif des Huangshan (montagnes jaunes) se situe au sud de la province de l’Anhui, en Chine, à l’ouest et à environ 480 km de la métropole de Shanghai.
Célèbres pour leurs pics étranges, leurs pins tortueux et leur mer de nuage, ces montagnes ont depuis fort longtemps attiré les voyageurs les plus illustres et les peintres les plus renommés.
Aujourd’hui, le Parc des Huangshan est envahi par des nuées de touristes… et ce n’est qu’un début !
Des montagnes vénérées et idéalisées
La chaîne des Huangshan, longue de 257 km, se compose de 72 sommets dont le plus élevé (1864 mètres) porte le nom suave de Pic de la Fleur de Lotus (Lianhua Feng).
Le site n’a reçu cette appellation de Montagne jaune qu’après la visite en 747 de Shi Huangdi, l’Empereur jaune. Il en avait gravi les pentes escarpées pour y cueillir les simples nécessaires à la fabrication de l’élixir d’immortalité. Il est considéré comme le créateur de la médecine et de l’acupuncture chinoises.
Les maîtres taoïstes et les moines adeptes du bouddhisme chan (zen) vinrent aussi y trouver refuge et s’y adonnèrent à la contemplation et à la méditation.
Depuis la dynastie des Tang (618-907), peintres et poètes, géographes et moines ermites ont aussi célébré ces étranges lieux.
Le géographe Xu Xiake (1586-1641) visita deux fois les Huangshan et il fit cette réflexion : « Qui a vu les Cinq montagnes sacrées n’a nulle envie de connaître d’autres cimes ; mais qui a vu les Huangshan, n’éprouve plus aucun plaisir à regarder les Montagnes sacrées ».