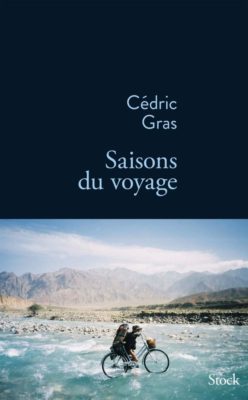 Cédric Gras a reçu une formation de géographe. Il figure dans la petite cohorte des géographes de sa génération qui se sont « évadés » vers la littérature, avec Sylvain Tesson et Emmanuel Ruben. « Évader » n’est pas le terme propre qui suppose une géographie ceinte de murs malaisés à franchir. A coup sûr, en tout cas, Cédric Gras s’est évadé du langage géographique et du ton académique, dès les premières phrases de son livre. Un des grands mérites de C. Gras réside dans la qualité de son écriture.
Cédric Gras a reçu une formation de géographe. Il figure dans la petite cohorte des géographes de sa génération qui se sont « évadés » vers la littérature, avec Sylvain Tesson et Emmanuel Ruben. « Évader » n’est pas le terme propre qui suppose une géographie ceinte de murs malaisés à franchir. A coup sûr, en tout cas, Cédric Gras s’est évadé du langage géographique et du ton académique, dès les premières phrases de son livre. Un des grands mérites de C. Gras réside dans la qualité de son écriture.
Ce livre est une réflexion sur l’expérience du dépaysement plutôt que du voyage. Il comporte des chapitres très autobiographiques, mais il dépasse sans cesse cette dimension personnelle.
Le chapitre initial s’intitule « Anthropologie ». L’auteur ne peut se défaire de regrets que partagent ceux qui mettent dans une perspective historique le développement des voyages dans le monde occidental.
Le premier thème traité dans ce livre peut se placer sous l’égide de Musset : « Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux » (Rolla, 1833). Cédric Gras est habité par le sentiment très vif qu’il n’est plus possible de découvrir du nouveau par le voyage et il n’est pas le premier à insister sur ce point. Il y a là un thème bien connu. « Nous sommes toujours arrivés après les réjouissances, dans les débris de bouteilles et de gueules de bois, sur les décombres des fêtes. Nos pères ont brûlé la chandelle par tous les bouts de la Terre ».
C. Gras ne se contente pas de de constat désabusé. Il s’efforce de définir le voyage des jeunes d’aujourd’hui par un biais anthropologique : « Qu’est ce alors que cette grande affaire qu’on appelle le voyage ? Rien de plus sans doute que le grand cérémonial initiatique des jeunesses d’Occident ». « J’ai obéi aveuglement à une coutume qui n’est inscrite nulle part : chacun valide ses semestres à l’école du voyage, jusque dans les curriculum vitae normalisés : les séjours altruistes au Mali, les travaux des champs en Australie, la Panaméricaine le pouce levé ».
Cédric Gras ajoute : « Un anthropologue de l’Occident aurait ri aux éclats ».
On trouvera dans ce livre de belles formules qui témoignent de cette insatisfaction : désormais, on ne peut parcourir le monde que « sur les traces de… ». Un monde où tout est répertorié, où le moindre lieu-dit a un nom reconnu, inscrit sur une carte officielle : « Découvrir ne signifie plus que dépoussiérer la vieille malle d’un héros oublié ».
Alexandra David-Néel a été la première femme à rejoindre Lhassa, déguisée en homme, et les suivants ont le sentiment de ne trouver qu’un pâle reflet de ce voyage initial. Heureusement, Cédric Gras ne sacrifie pas trop à l’obligation de différencier le voyageur du touriste. Il ne s’en tient pas à une ironie facile sur le tourisme de masse.
On pourrait ici remonter plus loin dans le temps, pour se situer dans une histoire vieille d‘environ deux siècles. En somme substituer le souci historique à la nostalgie, ce qui, je le précise, n’est pas dans la démarche de C. Gras.
Rappelons dans cette perspective historique la définition du touriste dans le dictionnaire Littré du XIXe siècle « Se dit des voyageurs qui ne parcourent les pays étrangers que par curiosité ou désœuvrement ». On a alors qualifié le touriste avant le tourisme, ce dernier terme ne figurant pas dans le même dictionnaire. Il y a eu des touristes étiquetés comme tels avant que le tourisme ne soit reconnu comme une forme spécifique du voyage. Ce tourisme qui nous paraît aller de soi, le voyageur des temps plus anciens avait du mal à l’expliquer à ceux qu’il rencontrait sur son lieu de destination. D’où incompréhension et quiproquos. Ce qui amène à une interrogation : comment les sociétés locales d’aujourd’hui voient-elles ces jeunes occidentaux qui parcourent le monde dans des conditions si peu confortables ? Comment expliquer leurs motifs ?
Passons à un chapitre beaucoup moins pessimiste que son chapitre introductif : un vrai récit de voyage à l’ancienne intitulé « Derniers instants d’éternité ». On y découvre que les émotions fortes sont encore possibles.
Cédric Gras avait alors 19 ans et il part avec une camarade en Mongolie dans le but de pénétrer au Tibet. Voyage difficile dans des conditions aventureuses : ils achètent des chevaux qu’ils se font ensuite voler. Ils doivent continuer à pied. Bon exemple de l’intérêt et des limites de ce qu’on apprend au jour le jour, sur ces plateaux glacés, sans jamais savoir où l’on dormira. On y trouve des signes d’une rare lucidité : « nous avions ramassé…les miettes du grand festin de l’exploration. Une exploration d’apothicaire, les lambeaux d’aventure qui échoyaient à notre génération ».
Il y a quelque coquetterie dans ces lignes : beaucoup d’entre nous se contenteraient de ces miettes. Il ne faut pas toujours croire C. Gras sur parole et son récit ne manque pas de contradictions où chacun peut trouver son profit : « Je n’oublierai jamais ces nuits-là où les hommes se serraient dans l’obscurité étoilée. Le vent ne hurlait plus que derrière des murs. Enfin un toit qui soit plus bas que le ciel, enfin un monde plus intime que l’univers ! »
Ou encore : « le monde était sauvage et la vie somptueuse. »
Et puis voici un hommage inattendu : « C’est la géographie qui m’a sauvé, la description de la terre, comme le susurre l’étymologie grecque. Il faut lire son époque dans les lignes du monde, en ravalant ses envies d’hier. Au chant du cygne il faut opposer la saveur, amère parfois, des métamorphoses… C’est la géographie qui m’a obligé à regarder les choses bien en face, pour faire parler les paysages les moins romantiques dans des clichés sans art… bannir l’abstraction, ne pas abuser ses pupilles. C’est la géographie qui m’a appris à prendre acte de la réalité et non à la fantasmer dans un anachronisme ambulant. C’est elle aussi qui m’a donné des raisons d’aller partout, vers des destinations élues comme les territoires qu’on suppose les plus fades. »
Ce qui nous introduit à une question que C. Gras se pose et qui n’est pas la moins intéressante. Pourquoi laisser de côté les plages à cocotiers et passer des jours dans des trains bondés qui traversent la Sibérie, contraint de dormir dans le filet à bagages ? Comment peut-on apprécier la poésie de ces reliefs monotones, où le train se traîne dans des paysages jamais renouvelés et s’arrête quelques instants dans des gares quasi désertes ? Comment se contenter de conversations insignifiantes avec des commensaux qui tuent leur ennui grâce à la vodka et vous repoussent dans un coin du compartiment ? « Combien j’ai aimé ces endroits, sans pouvoir vraiment m’expliquer l’effrayant pourquoi. Peut-être ne me suis-je jamais lassé de la monotonie et de l’ordinaire, de contempler la fadeur de ces existences, au-delà du pittoresque. Dans des villes pauvres de toute curiosité dite touristique, j’ai fait sécher mon linge avec langueur. Façon de parler car je portais mes habits jusqu’à ce qu’ils deviennent loques. » Quelque part on voit poindre le philosophe du voyage.
Et puis, C. Gras, dans des développements qui me ravissent, parce que je m’y retrouve, chante le dépaysement par la langue : « Posséder une langue fait sauter toutes les barrières. On passe de l’autre côté du miroir des apparences… L’essentiel devient banalement campé par n’importe quel passant, les altercations, la moindre relation que l’on tisse, non plus par les monuments ou les paysages. Langue, odyssée majeure où l’endroit le plus anodin se fait conteur.
Avec le verbe, on déboussole ses points cardinaux. On appréhende des points de vue tranchant violemment avec ses évidences… La langue russe et non pas seulement la Russie, a été mon initiation à un monde absent de nos écrans, de nos ondes radios, du creux de nos assiettes. »
Finalement, C. Gras, enraciné dans la langue russe, ne veut plus bouger : « Il faut un jour concentrer ses allées et venues sur une terre d’élection. Voyage ô combien plus profond que celui de la sédentarité dans l’altérité. L’immobilité studieuse, les relations qu’on noue dans des rencontres répétées, débarrassées du vernis de l’instant. Ce soudain piétinement géographique qui introduit avec le temps derrière les portes closes au passant, qui ancre dans une société. »
L’ouvrage de C. Gras peut être ouvert à n’importe quelle page. Chacun y trouve son miel.
Michel Sivignon, le 5 mars 2021
