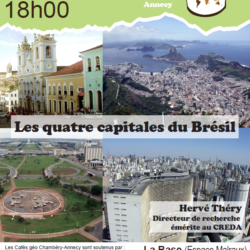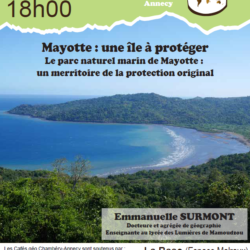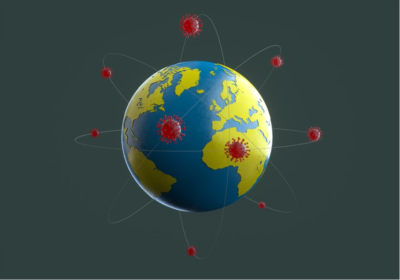Ce lundi matin vous serez en vacances et je ne serai pas face à vous pour vous poser la question, devenue rituelle : « Quel élément d’actualité de la semaine écoulée vous a marqué ? Quelle analyse pouvez-vous en proposer à vos camarades ? ». Ce lundi matin un de mes collègues d’Histoire-Géographie ne sera pas penché sur ses copies ou ses livres pour préparer ses cours, il manquera à l’appel. Pour vous et pour lui, en son absence et en son honneur, je poursuivrai l’exercice de la revue de presse, comme toujours, en deux temps.
Les faits, pour commencer.
Situons les faits : Conflans Sainte Honorine est une commune proche, peut-être à 25 kilomètres de notre lycée, dans notre département. Cependant, ici, la distance géographique n’a que peu d’importance, nous pourrions être à 1 000 km que nous ne serions pas moins stupéfaits. Conflans est la ville du confluent de la Seine et de l’Oise, c’était, ce vendredi 16 octobre, le confluent de la haine et de la barbarie. En sortant du collège, un de mes collègues professeur d’Histoire-Géographie, dont je ne connais que le nom, Samuel Paty, a été assassiné. Son bourreau lui a tranché la tête.
Quelques jours plus tôt, Monsieur Paty faisait un cours sur la laïcité et la liberté d’expression, comme des milliers d’autres enseignants et comme nous l’avons fait les semaines passées ; Monsieur Paty faisait son métier. Pour illustrer son cours, il a utilisé, entre autres, quelques caricatures du prophète de l’islam, Mahomet, publiées par l’hebdomadaire Charlie Hebdo dont les journalistes ont été sauvagement assassinés en 2015 par des terroristes islamistes.
Les élèves sont rentrés chez eux, ils ont raconté et résumé leur journée à leurs parents. Un d’eux a considéré que l’utilisation de ces caricatures n’était pas à son goût. Une vidéo de ce parent d’élève critiquant vivement l’enseignant a circulé très vite sur les réseaux sociaux, il était explicite : « vous avez l’adresse et le nom du professeur pour dire STOP ». Il a été entendu par un jeune homme de 18 ans, Russe d’origine tchétchène et bénéficiant, en France, du statut de réfugié. Ce dernier a revendiqué l’assassinat au nom d’Allah.
L’analyse, pour expliquer et tenter de donner du sens est, dans l’immédiat, presque impossible.
Il faudra du temps et de multiples éclairages pour comprendre cet acte. Je ne peux pas fournir d’explication sur le geste de l’assassin. A défaut d’analyse, la seule chose que je puisse tenter c’est un travail introspectif. Je peux vous inviter dans la coulisse et vous dévoiler un peu le travail d’un enseignant car nous nous ressemblons, nous autres professeurs d’Histoire et de Géographie. Aujourd’hui, je suis Samuel Paty et Samuel Paty est votre professeur. Titre de la leçon : Éducation Morale et Civique, Liberté d’expression et laïcité.
Esquissant le portrait de l’impertinent Triboulet face à François Ier puis le tableau tragique des guerres de religion, le professeur mêle l’anecdote et la grande Histoire pour éveiller la curiosité et introduire son sujet sur la liberté d’expression. La classe est saisie, l’enseignant tient son public. Il progresse chronologiquement et s’arrête sur les temps de grâce : les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, liberté d’opinion et liberté d’expression, et les temps de disgrâce : 1852, Victor Hugo condamné à l’exil pour sa défense de la République. Pour garder l’attention de la classe, le professeur varie le rythme et le ton de sa voix, il se déplace et pose son regard sur tel ou tel élève. Solennel, il rappelle la grande loi de 1881 qui consacre la liberté d’expression sous toutes ses formes. Il explique néanmoins que la Liberté, si belle soit-elle, ne peut être absolue et que le législateur républicain interdit la diffamation, l’insulte, l’appel à la violence et les outrages.
Le premier temps, celui de la didactique, a permis de dresser le cadre. Il faut maintenant susciter, chez l’élève et dans la classe, un questionnement : qu’en est-il de cette liberté d’expression aujourd’hui ? En République, régime dans lequel la politique est une « chose publique », comment s’articulent libertés individuelles et libertés collectives, aspirations spirituelles et loi commune ? Les élèves ne peuvent pas rester passifs et l’enseignant mobilise ses archives et des trésors d’imagination pour faire émerger une réflexion critique. Inévitablement il sera question des atteintes à la liberté d’expression dans les régimes politiques dictatoriaux mais également des atteintes à la liberté du fait de la religion. Il faut construire un débat avec les élèves et, pour cela, déranger les certitudes. Le professeur a choisi les documents, les questions, pesé les mots. Puis, il a lâché sa feuille pour réagir aux propos d’un élève, pour recadrer un comportement ou pour sourire à une intervention facétieuse. Au fond, un élève fronce un sourcil, si le professeur le voit, celui-ci pourra l’aider à formuler une question, c’est déjà un enjeu pédagogique considérable car il peut être difficile de faire réagir un élève qui ne dispose que quelques centaines de mots de vocabulaire. S’il y arrive, il tentera de se mettre à sa portée pour expliquer, sans jamais céder à la facilité de la simplification.
Il reprend ses notes et revient sur ce cadre structurant qu’est la loi de 1905 sur la laïcité. Il sait qu’il devra affronter l’appréhension de quelques élèves sur le sujet. Il prend le temps d’en dégager la force : non, il n’y a pas d’un côté le politique et de l’autre le religieux mais une République qui garantit la liberté de conscience et encadre l’exercice des cultes, il en rappelle la grandeur : la garantie d’une liberté pour ceux qui croient au ciel et pour ceux qui n’y croient pas, il en explique la fragilité : la tentation permanente de débordement du religieux sur le politique et de l’annexion du religieux par le politique.
Le débat reprend, il s’agit de battre en brèche les idées reçues, faire comprendre et, autant que possible, faire aimer les valeurs de la France Républicaine car ce qui est au cœur du sujet c’est que les élèves puissent saisir l’équilibre fragile entre la liberté d’expression et le respect des convictions. Les documents sont de solides ancrages, le professeur s’appuie sur les questions des élèves et ouvre la voie, face Nord, sur une ligne de crête : de chaque côté des pentes excessives. Il sait que le vertige guette : depuis qu’il enseigne, l’intolérance, sous le manteau de l’islam radical, frappe et tue. Face à lui, ses élèves viennent des quatre coins du monde, leurs repères culturels sont parfois très éloignés des idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité. Mais il est là, Monsieur Paty, pour leur transmettre cet héritage grandiose aujourd’hui vacillant.
La cloche sonne et les élèves rangent déjà leurs affaires. Sur le tableau noir il efface les mots République, laïcité, loi, religion, sacré, satirique, humour, respect… Dans la tête d’un enseignant les questions se bousculent après un cours : ai-je réussi à transmettre les grandes idées ? Et cet élève qui n’a pas parlé aurais-je dû aller le chercher ou ai-je eu raison de le laisser suivre en silence ? Aurais-je le temps de faire mon évaluation, corriger les copies, lire cette nouvelle publication sur le sujet ? Aurais-je encore assez d’énergie pour terminer ma journée ? Il aime ses élèves et veut leur donner le meilleur.
Bientôt, les élèves seront en vacances, cela lui donnera du temps pour lire et réfléchir aux prochaines séances. Monsieur Paty a pris son cartable, il a éteint la lumière, il est parti.
Pierre Méheust, Professeur d’Histoire-Géographie dans les Yvelines, 18 octobre 2020.
La classe dépasse toujours ses quatre murs
Ce titre m’a été soufflé par un ami universitaire pour ajouter une accroche géographique au beau texte de Pierre Méheust reproduit ci-dessus. Il renvoie à différentes échelles spatiales qui permettent d’enrichir la réflexion quand on cherche à comprendre ce qui se joue en classe, en particulier dans l’échange entre le professeur et les élèves qui ont grandi dans des contextes différents. Evoquons tout d’abord l’échelle locale avec le lieu d’implantation du collège et les lieux de résidence du professeur et des élèves. Avec l’échelle régionale, nationale et même supranationale, on peut penser aux parcours géographiques des uns et des autres depuis leur naissance, à leurs représentations et à leurs connaissances nourries par les différentes formes de savoir, par les familles, les amis, les médias, les réseaux sociaux, etc. Tous ces espaces interviennent d’une façon ou d’une autre dans les consciences en action entre les quatre murs de la classe…
Daniel Oster, 25 octobre 2020
 Nous nous réjouissions de recevoir, le 8 mars prochain au Flore, Cédric Gras, géographe, grand voyageur (1), et excellent écrivain. De nombreuses questions suscitaient notre curiosité : rapport entre voyage et écriture, nécessité du temps long pour appréhender un lieu, goût des confins et des frontières, dilection particulière pour le monde russe de Mourmansk à Vladivostok. Il y a vécu plusieurs années dont cinq en Ukraine où il dirige l’Alliance française de Donetsk en 2014 lorsqu’intervient la révolution de Maïdan. Son expérience des déchirements qui affectent alors le Donbass sécessionniste est transposée dans un roman, Anthracite (2). Très affecté par la situation actuelle de l’Ukraine, Cédric Gras a décidé de s’y rendre. Nous le retrouverons à son retour pour un café consacré à ce pays.
Nous nous réjouissions de recevoir, le 8 mars prochain au Flore, Cédric Gras, géographe, grand voyageur (1), et excellent écrivain. De nombreuses questions suscitaient notre curiosité : rapport entre voyage et écriture, nécessité du temps long pour appréhender un lieu, goût des confins et des frontières, dilection particulière pour le monde russe de Mourmansk à Vladivostok. Il y a vécu plusieurs années dont cinq en Ukraine où il dirige l’Alliance française de Donetsk en 2014 lorsqu’intervient la révolution de Maïdan. Son expérience des déchirements qui affectent alors le Donbass sécessionniste est transposée dans un roman, Anthracite (2). Très affecté par la situation actuelle de l’Ukraine, Cédric Gras a décidé de s’y rendre. Nous le retrouverons à son retour pour un café consacré à ce pays.