L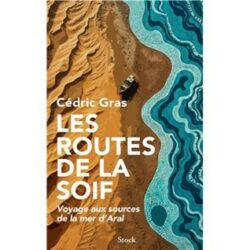 e titre est un jeu de mots (« soif » / « soie ») qui donne deux clés essentielles de l’ouvrage, la localisation (l’Asie centrale parcourue par les antiques routes commerciales chinoises) et le thème majeur (le stress hydrique dont souffre cette région).
e titre est un jeu de mots (« soif » / « soie ») qui donne deux clés essentielles de l’ouvrage, la localisation (l’Asie centrale parcourue par les antiques routes commerciales chinoises) et le thème majeur (le stress hydrique dont souffre cette région).
En seize petits chapitres, son auteur, Cédric Gras, écrivain/géographe/voyageur, nous conduit des rives kazakhes de la mer d’Aral (de ce qu’il en reste) aux hautes terres du Pamir en remontant l’Amou-Daria. En fait, la mer d’Aral n’a jamais été qu’un grand lac fermé dans lequel se jetaient deux fleuves, Amou-Daria et Syr-Daria (phénomène d’endoréisme) (1). Mais au milieu du XXème siècle elle accueillait une flotte hauturière importante dont la production était vendue sur tout le territoire soviétique. Aujourd’hui elle n’est plus constituée que de quelques flaques, son ex-fond est planté de saxaouls (2) et l’Amou-Daria se perd dans les sables. C’est pour comprendre ce phénomène que Cédric Gras et son comparse, le cinéaste Christophe Raylat, ont entrepris ce périple.
L’ouvrage est un récit de voyage avec ses descriptions de paysages, ses rencontres avec la population et les autorités, ses fatigues et ses bonnes surprises. Les deux compagnons ont du mérite car ils sont amoureux de la haute montagne mais peu amateurs de déserts (« J’ignore comment l’on peut passer sa vie dans ces steppes pelées ») qui constituent une grande partie des 2000 km parcourus. Il a fallu aussi se plonger dans les archives pour comprendre l’assèchement progressif de la mer d’Aral. Mais un des grands intérêts de ce livre est d’ordre géopolitique. L’Amou-Daria est un fleuve commun à quatre Etats, trois républiques ex-soviétiques et l’Afghanistan. Même s’il n’est pas question de poser un pied sur ce dernier Etat, les frontières entre les trois autres se révèlent difficiles à franchir. Cette situation est une des raisons de l’assèchement progressif de la mer (l’auteur rappelle opportunément l’étymologie commune aux mots « riverain » et « rival » : rivalis).
Le premier pays traversé est l’Ouzbékistan. C’est le plus agricole et c’est celui qui dépend le plus de l’Amou-Daria pour irriguer ses récoltes. Certes on trouve des traces d’irrigation dès l’Antiquité dans la région de Khiva mais les grands travaux datent de l’époque soviétique lorsque Khrouchtchev voulut faire de cette partie de l’Asie centrale un « grenier à coton » (3). L’eau du fleuve et le travail obligatoire des enfants et étudiants lors de la récolte devaient permettre de remplir facilement les objectifs du Plan. Les terres sèches furent quadrillées d’un réseau de canaux alimentés par l’Amou-Daria. La prospérité agricole entraîna une forte croissance démographique. Ces choix n’ont pas été remis en cause après l’indépendance du pays en 1991.
Abaissement du niveau des eaux du fleuve, division du cours entre des bancs de sable de plus en plus larges, infiltration des eaux dans le sous-sol et prélèvements en amont… Plus aucune goutte n’arrive dans la mer d’Aral. Pour les Ouzbeks, les responsables sont « les autres », c’est-à-dire les pays qui se trouvent en amont.
Le premier « autre » est le Turkménistan traversé par l’Amou-Daria dans sa partie orientale. Pierrailles et dunes occupaient ce territoire où la température pouvait excéder 52° à l’ombre en été, jusqu’à ce qu’en 1948 Staline ne décide du creusement d’un canal traversant le désert du Karakoum, de l’Amou-Daria à la Caspienne (1375 km) pour irriguer des terres agricoles. Les travaux se terminèrent dans les années 1980. Le grand « Plan de Transformation de la Nature » soviétique était réalisé mais l’évaporation et les infiltrations provoquent de lourdes pertes en eau.
Le deuxième pays d’amont est l’Afghanistan séparé de l’Ouzbékistan par une frontière de 137 km marquée par l’Amou-Daria. A Termez, ville-frontière, le fleuve a un cours ample et puissant. Il est alimenté par la Sukhandarya (premier affluent rencontré depuis la mer d’Aral), au régime nivo-glaciaire, coulant d’une petite chaîne frontalière du Tadjikistan. Le débit du fleuve susciterait l’optimisme si une récente annonce des talibans n’inquiétait fortement Ouzbeks et Turkmènes : la réalisation d’un canal de 285 km à partir de l’Amou-Daria (le canal de Qosh Tepa) pour irriguer 550 000 ha de terres. C’est un projet ancien, qui avait même été repris par les Américains après le 11 septembre et qui devrait voir sa mise en œuvre en 2028. Est-ce la fin annoncée du fleuve dans toute sa partie aval ?
La dernière étape conduit Cédric Gras et Christophe Raylat au Tadjikistan, dans le massif du Pamir où naissent les deux principales sources de l’Amou-Daria, le Piandj et le Vakhch qui assurent 90% du débit final. Les deux amis se trouvent enfin dans le milieu montagnard qu’ils affectionnent et vont pouvoir explorer le Fedchenko, plus long glacier de montagne du monde (77 km) aux ressources en eau considérables. Peu de temps avant la chute de l’URSS, les Soviétiques avaient conçu un projet de résurrection de la mer d’Aral par l’accélération de la fonte des neiges du Pamir. Le projet est resté sans suite et le Fedchenko continue de reculer. Les Tadjiks ne cherchent pas dans les cours d’eau de quoi irriguer leurs cultures mais de quoi produire de l’électricité. La vallée encaissée du Vakhch est barrée par le barrage en remblai de Nourek qui alimente une centrale électrique développant une puissance de 3 gigawatts utilisés en grande partie pour produire de l’aluminium. En 2028 devrait être achevé un second barrage en amont sur le Vakhch, celui de Rogoun qui pourra se prévaloir d’être le plus haut barrage du monde (335 m). Les deux barrages fourniront alors 93% des besoins en électricité du pays. Mais certaines vannes sont fermées en été, ce qui affaiblit le débit de l’Amou-Daria en Ouzbékistan et au Turkménistan…
Que les raisons en soient climatiques et/ou économiques, l’assèchement de la mer d’Aral devrait provoquer une réaction coordonnée entre tous les pays riverains pour être efficace. Or même s’il existe une Commission interétatique pour la coordination de l’eau en Asie Centrale, les relations entre les Etats sont difficiles ou inexistantes. Comme réponses aux questions que Cédric Gras a posées aux experts, c’est la langue de bois qui a prévalu niant les problèmes.
Avec l’Afghanistan la frontière est fermée. Le fleuve, entouré de barbelés, surveillé par de nombreux militaires, est franchi par un pont, toujours vide, construit au moment de l’invasion soviétique, dont le nom pourrait faire sourire s’il n’avait été témoin de nombreux drames, le « Pont de l’Amitié ». Aux Ouzbeks inquiets du creusement du canal de Qosh Tapa et voulant négocier avec les Afghans, il a été opposé une fin de non-recevoir.
Entre les trois Etats qui ont eu une histoire commune au sein de l’URSS, les relations sont à peine meilleures. Ils connaissent des régimes autoritaires à des degrés variés. L’Ouzbékistan est le plus démocratique (recul du nombre des prisonniers politiques et de la corruption) et ouvert sur le monde extérieur grâce au tourisme. Le Turkménistan et le Tadjikistan sont des dictatures.
Nos deux voyageurs ont dû interrompre leur remontée de l’Amou-Daria lorsque celui-ci a franchi la frontière ouzbéko-turkmène. Pas de visa. Le pays est fermé aux journalistes et aux curieux d’une manière générale, surtout lorsqu’ils sont munis de caméra ou d’appareils photo. Christophe a dû rester en Ouzbékistan et Cédric est passé par Istanbul pour atterrir à Achgabat, officiellement « invité par l’ambassadeur de France » pour faire des conférences sur la culture française ! il lui est interdit de prendre des photos, est contrôlé en permanence et n’a pu suivre le canal du Karakoum jusqu’à l’Amou-Daria. C’est en avion qu’il regagne l’Ouzbékistan. La population turkmène est entièrement coupée du monde extérieur par la censure et ignore tout des problèmes hydriques du pays. Peu traité dans la presse internationale, le régime politique turkmène est un des pires au monde et des plus extravagants. En témoignent les actes de son premier dirigeant après l’indépendance, Saparmourat Niazov Turkmenbachy (« le père des Turkmènes »), qui a conçu une nouvelle capitale tout en marbre blanc et décors dorés. Seules les voitures de couleur blanche sont autorisées à y circuler !
Le Tadjikistan, pays très pauvre, n’offre pas plus de signe d’ouverture démocratique. Tout le parcours de nos voyageurs était rythmé par des panneaux de propagande politique. Les contrôles militaires sont réguliers d’autant plus que dans le Haut-Badakhchag la population a des relations tendues avec la capitale. Il faut savoir ruser. C’est ainsi que les drones de Christophe Raylat ont été démantelés et les pièces détachées cachées au milieu du matériel.
Les problèmes de l’Amou-Daria sont mal connus de ses riverains. Toute tentative d’accord rationnel semble exclue dans la situation géopolitique actuelle. Le Fedchenko qui offre jusqu’à un km d’épaisseur de glace offre encore des réserves. Mais le réchauffement climatique et l’inconscience politique laisseront-ils encore longtemps les fleurs du cotonnier s’épanouir en Asie centrale ?
Notes :
(1) Endoréisme : mode d’écoulement des eaux superficielles aboutissant à une dépression fermée, sans exutoire vers la mer.
(2) Saxaoul : gros arbuste endémique des déserts et des steppes d’Asie centrale.
(3) « Grenier à coton » : Expression utilisée en URSS pour désigner l’Ouzbékistan devenu dans les années 1970-1980 une importante région productrice approvisionnant en coton toute l’industrie de l’Union.
Michèle Vignaux, avril 2025
