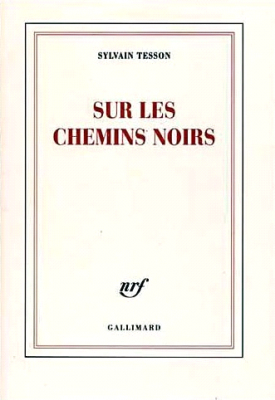Un écrivain, Sylvain Tesson, vient de fouler ce qu’il baptise la France des chemins noirs. Sur les chemins d’une France en berne, il promène sa nostalgie d’un monde perdu, idéal, fait de ruines et de ronces, de parenthèses et d’interstices, perpétuellement défait par des générations d’hommes pressés. Du Mercantour au Cotentin, en passant par le Perche et l’Aubrac, la Margeride et le Bas-Vivarais, il arpente une France intérieure propice à cette « géographie de l’instant » dont il a, mieux que l’intuition, la vocation. Il est tombé, il a mûri, sa prose est devenue mature, plaisante, facile, trop facile peut-être, se révélant sommaire.
Une existence en surchauffe
Cet homme infatigable, dont on ne sait s’il voyage pour écrire ou s’il écrit pour voyager, est certainement aujourd’hui l’écrivain-voyageur français contemporain le plus en vue, et l’un des plus connus du lectorat. Pareille fortune mérite attention, parce qu’au-delà de ce qu’elle nous apprend de l’auteur lui-même, cette popularité est le miroir d’une demande sociale, d’une aspiration croissante vers un je ne sais quoi d’extravagant – au sens premier du mot : menant hors de la voie normale – qu’il faudra interroger. Elle nous renseigne sur une personne, mais surtout, elle nous enseigne sur une époque : arrêtons-nous sur le renseignement, qui peut-être nous dira un peu de l’enseignement.
Partout, on le sait, S. Tesson a roulé sa bosse. À peine sorti de l’adolescence, on le voit pédaler en Islande (1991), non sans une grande part d’improvisation, à une époque où le tourisme y est à la veille d’entamer son grand essor. Trois ans plus tard, il entreprend un tour du monde au long cours, à bicyclette, avec son camarade Alexandre Poussin (1994) : première d’une longue série de cavalcades amicales. Bientôt, il s’enhardit : c’est à l’Himalaya qu’il s’attaque (1997). En surchauffe constante, courant de pics en cols, de cimes en défilés, de parois montagneuses en façades urbaines, cet Homo viator, tour à tour alpiniste, acrobate, cavalier et escaladeur, surfeur et parachutiste, a fait choix de vivre dangereusement, de mener, selon le joli mot de L. Febvre, une existence « de plein vent ».
L’absurdité du Voyage
Seulement, notre homme, aujourd’hui âgé de 44 ans, vit en un temps où forcément le mot et l’idée d’aventure interpellent et questionnent. Qu’en reste-t-il, de la grande idée d’aventure ? La cartographie universelle s’est enrichie, les cartes, banales, sont devenues précises après avoir été précieuses, et pendant plusieurs siècles, plusieurs générations d’explorateurs se sont mis résolument en tâche d’en chasser le moindre blanc, même infime. Alors, nos illusions se sont dissipées. Les confins parurent soudainement proches et les antipodes familiers. Avec l’invention du Nouveau Monde, une finis terra, la Bretagne, devient le centre de la « méditerranée » atlantique…
De plus, le voyage a rompu avec la mort. Partir, longtemps ce fut presque mourir : une folle aventure. Partir, c’est prendre risque. Un risque inconsidéré. L’homme croit prendre la mer, il trouve la mort ; partout, elle guette. Sur terre, où rôdent mauvais génies et brigands, prompts à détrousser et tuer passants et pèlerins, sur mer, surtout, où les vagues ballottent des millénaires durant des navires soumis aux saisons, aux vents et aux dieux. Toute embarcation, en puissance, est un radeau de la Méduse, quand elle n’est pas la proie des pirates : César lui-même est capturé en Méditerranée, quelques années avant que Pompée ne débarrasse la nostrum mare de cette antique menace. La mer mire la fragilité de l’existence. Elle est un mouroir flottant. Proverbiale est sa voracité, pour Jonas et pour tant d’autres. Elle engloutit les hommes, leur nom, et jusqu’à mémoire. Que le vent se lève trop, l’esquif ou la nef seront abîmés, ils prendront les eaux. Qu’il ne se lève pas assez, et ce sera alors le « calme blanc », désespérant, angoissant, mortifère, l’attente sans fin de regagner le rivage, de se ravitailler : s’il se poursuit encore, pointeront la maladie et la démence, la nef des fous… Un voyageur d’al-Andalus du XIIe siècle, Ibn Jubayr, faisant le pèlerinage de La Mecque, le sait bien qui, cent fois, recommande son âme à Dieu, et, nonobstant toute cette piété, doit subir sur les mers les pires mésaventures. Quelque deux mois ne lui sont pas de trop pour relier, en 1184, le Levant à la Sicile, le bassin oriental au bassin occidental de la Méditerranée. Et que d’épreuves durant ces pénibles semaines ! Ce ne sont que vents défavorables et tempêtes, mers immobiles ou vagues immenses, puis la disette, puis le naufrage au détroit de Messine :
« Le lendemain matin, les vagues brisèrent le navire et rejetèrent les débris sur le rivage ; ce fut une leçon à méditer pour ceux qui voyaient ce spectacle et un signe pour ceux qui en étaient témoins. Nous étions tout étonnés d’être rescapés. Nous redîmes notre reconnaissance à Dieu, puissant et majestueux, de la grâce qu’Il nous avait accordée, de l’arrêt heureux qu’Il avait décrété pour nous et de nous avoir fait échapper au sort d’échouer sur ce continent ou sur une des îles habitées de Romanie, car même si nous avions été sains et saufs, nous serions tombés en esclavage pour le reste de notre vie. »
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage : Ulysse est une anomalie, l’exception qui confirme la règle, d’après laquelle le voyageur est un défunt potentiel et le voyage un périple mortel.
Le voyage a rompu avec la mort et les fées. Rien de merveilleux ne transpire chez Ibn Jubayr ; le récit est froid, sobre, rationnel : nul djinn là-dedans, mais Dieu seul, partout, début et fin de toutes choses. À cet enfouissement progressif, mais à bâtons rompus, à cette occultation massive, mais discontinue des fées, lutins et sirènes des terres, airs et mers répondra la réaction romantique.
Dans ces conditions, faire profession d’aventurier au temps du désenchantement du monde, à l’heure de la sécurisation, de la massification et de la banalisation du voyage, en un temps de « disneylandisation » de la planète (S. Brunel), et plus d’un siècle après Scott, Peary et Amundsen, moins de deux siècles après Mungo Park, René Caillié et David Livingstone, peu ou prou trois ou quatre ou cinq siècles après Zheng He et Colomb, après les Cook, Davis, Tasman, Hudson, Baffin, Béring et Barents, après ceux qui nommèrent et d’après lesquels on nomma – au mépris souvent de toute géographie vernaculaire –, c’est une folie, et, en soi, c’est une aventure. Tesson n’en appartient pas moins à l’étrange Société des explorateurs : une bizarrerie du XXIe siècle ?
En fait, l’épuisement du monde est une antique ritournelle, un vieux motif sur lequel on brode indéfiniment depuis près de deux siècles. Il est de bon ton de se lamenter sur l’extinction du voyage. En 1851 déjà, Baudelaire décrétait solennellement la fin du Voyage : ou plutôt, il le rejetait métaphoriquement à l’article de la mort, pour lui le grand passage, l’ultime et unique aventure. Les Grecs ont inventé avec Charon la figure immortelle du passeur des deux mondes. D’autres, à la même époque que le poète, croiront la trouver ou dans la drogue ou dans l’ivresse, ou dans les rêves et les rêveries, mais dans l’ailleurs, mais sur Terre, dans les nouveaux ou bien les anciens mondes, c’eût été fiction pure que d’y prétendre désormais : puisque les limites de l’œkoumène et de la conscience ont été repoussées, puisqu’ont été scientifiquement explorés l’intérieur et l’extérieur, l’Autre et le Soi, macrocosme terrestre et microcosme humain. Et, sur tout cela, l’ethnographie, la psychanalyse, tant d’autres sciences ou savoirs nouveaux ont créé une littérature des plus abondantes et fécondes. On a mis l’homme et la Terre, leurs plis et replis, leurs coins et recoins en mots et en images, en cartes et en schémas, en graphiques et statistiques, en planches, gravures et dessins. Triomphe de l’emprise, faillite de la surprise ? Les représentations du monde ont vacillé.
L’heure, ainsi, ne serait plus à l’inventaire du monde. Une crise morale va éclater. L’avertissement de Claude Lévi-Strauss, ouvrant Tristes tropiques (1955), retentit sur tout son siècle : l’aventure serait une imposture, l’aventurier l’idiot du voyage. Telle est la grande idée qui a cours chez les lettrés et les savants ; idée obsédante, certainement, qui hante jusqu’à nos jours la conscience de l’aventurier ; idée sévère, du reste, qui trop ignore combien nous entretenons un rapport complexe à l’aventure, combien l’homme n’y trouve pas seulement un dépassement de soi, mais une élévation morale, mais le dépassement de son humaine condition : elle est sa cathédrale intérieure. Trop individuelle, trop égoïste, l’aventure n’aurait plus de sens, du moment qu’elle nous semble dépourvue de toute utilité sociale : le point de vue utilitariste invalide toute aventure personnelle, seul comptant le bonheur commun. Que peut apporter à cela le vainqueur du cap Horn, des pôles ou de l’Eiger ? Un nombre grandissant de skippers annonce ainsi agir pour la bonne cause. Leur engagement est tantôt écologique, tantôt social. Peu importe : ils sont utiles.
Quant à l’aventurier, conquérant de l’inutile, voyageur dominateur mû par l’illusion du nombre, qui chez lui a valeur quasi magique – voyez les premiers livres de S. Tesson, où le kilométrage légitime à lui seul le voyage – sa figure paraît à notre temps singulièrement détestable. Prouesse est faiblesse. On en veut faire un principe, une devise. L’alpinisme est moqué, disqualifié : on gagnerait en hauteur ce qu’on perdrait en profondeur. De même est la quête : noble, autant qu’est ignoble la conquête. Qu’importe le motif de la première, qu’il s’agisse de satisfaire le besoin impérieux de voir, de savoir, de vivre ou survivre, qu’il s’agisse d’une expérience physique ou mystique, de dépassement ou de communion, qu’il s’agisse de faire, d’être fait, sinon défait par le voyage, celui-ci est acceptable, celui-ci n’est socialement valorisé que dans la mesure seule où il n’ambitionne rien, où il ne prétend, sauf à procurer du plaisir à celui même qui l’entreprend. De ce point de vue, le voyageur doit rester fondamentalement soumis à la route, à laquelle littéralement il se confie et s’abandonne :
« On ne voyage pas pour se garnir d’exotisme et d’anecdotes comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu’on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels. » (Nicolas Bouvier, Le poisson-scorpion)
Quoi qu’il en soit, l’aventurier, mis en demeure de se justifier, se trouve dans une position inconfortable, dans un entre-deux délicat et douloureux entre le savant, qui le tourne en dérision, et le touriste, qui le singe. La menace est double. Il doit faire valoir sa contribution au bien commun. Sans compter le sempiternel grief du bougisme bourgeois, dont le grand voyageur serait l’acteur, pire le complice, et qui en ferait un déraciné, un nomade, le petit privilégié d’une société qui, elle, ne choisit pas toujours la mobilité, mais la subit. C’est pourquoi, de plus en plus précautionneux, il va devoir faire de la prudence et de la retenue ses qualités premières : « plus le discours médiatique glorifie les marins, les alpinistes et les aventuriers et plus ceux-ci développent un penchant pour la modestie. Chez les héros des mers et des cimes, c’en est fini des rodomontades et des tartarinades. »
Continuer l’aventure
Néanmoins, S. Tesson, très jeune, veut croire que loin d’avoir disparu avec la fin des grandes expéditions de découverte, l’aventure peut, et mieux, doit continuer. Il veut ne s’inscrire ni dans le sillage de l’illustre Cook ni dans celui du modeste guide qui mène à la baguette la cohorte présentement milliardaire des « Cooks et Cookesses » (P. Loti). Tout bien considéré, si la grande aventure maritime initiée aux XIVe et XVe siècles par les Italiens et les Portugais dans l’Atlantique puis l’océan Indien, poursuivie par les Espagnols, les Hollandais, les Anglais et les Français sur toutes les mers du monde, si la défloration des ultimes terres vierges, si l’exploration anthropologique des contrées nouvelles, si l’aventure polaire ont bel et bien pris fin, tel n’est pas le cas, tant s’en faut, de tous les types d’aventures : ni la conquête spatiale, ni l’aventure sous-marine n’ont encore tari notre inépuisable curiosité. Chaque jour, ne nous annonce-t-on pas la découverte de plusieurs espèces marines ? Ceci, non plus seulement dans les couches superficielles de l’Océan, mais en ses abysses et jusque sous les mers – voyez les profondeurs de la mer de Ross – en apparence les moins propices à la vie : à défaut de Hurons, de Pygmées et de Tupinambas, on nous tapisse le fond des mers d’une foule insoupçonnée d’êtres vivants, là méduses tentaculaires et éponges carnivores, ici pieuvres et limaces des mers ! Oui, l’inventaire du monde se poursuit et s’accélère. L’humanité peut être tranquille : elle explore de nouvelles frontières, qui lui serviront demain de projection à sa puissance dont on ne sait plus trop si elle est géniale ou tragique, grande ou misérable, ou les deux tout ensemble.
Conscient de tout cela, vif, impétueux, le jeune voyageur s’empresse. Pendant des années, on peine à le suivre. Il veut aller partout. Son rythme est effréné. Il se fraye des chemins toujours nouveaux. Sa géographie personnelle se décloisonne, ses cartes mentales sont mondiales. Tout l’attire vers la vie sauvage, vers les déserts humains, vers la démesure – d’où l’insaisissable Russie –, bref, tout ce temps, tout conspire à le détourner de la France. Plus il part, plus il veut découvrir, plus sa curiosité s’exacerbe et ses voyages s’enchaînent. Débute alors la fascinante et fastidieuse litanie des lieux et milieux où il passe, ou seulement séjourne : là le désert de Gobi, d’Atacama, là l’Afghanistan, le Wadi Rum, le désert du Baloutchistan, Haïti, Gibraltar, la Sibérie, où, russophile, il a plaisir à retourner souvent, Delhi, Dakar, Lhassa et Valparaiso, Singapour et Téhéran, là l’uniformité désolante de la steppe russe – il a fait en 1991 la rencontre décisive de cette seconde patrie –, là celle de la Pampa argentine, tous espaces monotones ou grandioses qui nous disent à la fois beaucoup et si peu de l’homme. Ce monde, inlassablement recensé, il veut de bonne heure en éprouver le pouls, en détailler le visage, et, puisqu’il vit par nature fiévreusement, il va voyager à bride abattue. Sa physionomie est fluette, mais il est fort, leste, puissant, en pleine possession de ses moyens physiques : il n’y a donc pas jusqu’aux immensités verticales de l’Himalaya, jusqu’aux vertigineux horizons des steppes asiatiques que cet athlète n’a soif de connaître. Une aventure n’est pas sitôt achevée qu’il en rumine à la belle étoile dix autres, sans souci, pour le dire avec du Bellay, de ces « mille dangers » qui parfois font du voyage un enfer (Les regrets, XXVII).
Ses premiers récits sont jubilatoires. Ils sont une ode à la vie, au bivouac, à la camaraderie. Il savoure l’ivresse de l’asphalte, l’inspiration des aubes enchantées, la mélodie des aubades animales, les rumeurs de la nuit close, les crépuscules écarlates des pays du soleil, et, d’autre part, il connaît la peur, l’anxiété, l’effroi, le désarroi. Avant l’accomplissement physique, l’évasion imaginaire s’élabore à la faveur du livre, de la carte, de la musique. Ces trois baumes puissants peuvent beaucoup. Il ne sait cependant quel prétexte inventer pour s’adonner à de nouvelles tribulations : tantôt, il prétend suivre la trace d’un évadé du Goulag de la Sibérie à l’Inde, tantôt celle de l’armée napoléonienne durant la retraite de Russie, et demain ?
Pour ce forçat, si tout est motif de mise en route, c’est qu’en fait il n’a nul motif de voyager. Pour lui comme pour tant d’autres, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. On pourrait en chercher les racines profondes dans l’univers familial, trop sûr, trop lisse, trop étriqué, mais on prendrait le risque d’appliquer à un homme des schémas psychologiques ou psychanalytiques trop attendus sur la construction du moi par contraste et confrontation au non-moi. Il est toujours vain et difficile de comprendre l’aimantation des chemins. C’est le propre de toute mystique, et de la mystique viagère en tout premier lieu. Il part pour partir, rien de plus. Il en voit qui courent après les heures, il en sait qui courent après le monde : il sera l’un d’eux. Et le lapidaire « parce que » de Blaise Cendrars sera le fin mot de toute sa vie.
Ou bien seul, ou bien en compagnie, il court donc tout ce moment après le monde, après le temps. Puis du temps, puis du monde, il va, peu à peu, ressentir le désir tout naturel d’en ralentir le pas, d’en suspendre le vol : six mois durant, de février à juillet 2010, on le trouve sur les rivages englacés du Baïkal où il élit demeure en une pittoresque cabane, après en avoir fait cinq ans auparavant le tour en side-car. Pour nous, peu nous importe qu’il coure ou fasse halte. D’un mot dur, injuste, infondé et plein d’amertume, l’abbé Régnier-Desmarais en 1680 avait cru trancher : « Rarement à courir le monde, on devient plus homme de bien. » (Voyage à Munich). Mettons qu’on y prête foi : ne devient-on pas néanmoins tout autre ? D’abord, on s’instruit : « Il y a un livre qu’il est inutile d’emporter : c’est un livre de géographie. Tout le jour, nous pédalons devant des cas d’école qui feraient pâlir les illustrations des manuels. Devant l’oasis de Daora, nous voyons des dépressions, dont le fond est recouvert de sel et que l’on nomme sebkhas. » S. Tesson est souvent présenté comme un géographe de formation. Ses études le confirment. Mais sa dilection, en géographie, va primordialement à la géomorphologie. Son bréviaire ? Le Précis de géomorphologie de Max Derruau. Sans tomber dans le déterminisme géographique, Tesson soutient que parmi d’autres facteurs, le sol entre en jeu. Le sol n’est pas l’homme même, mais il est quand même pour l’homme quelque chose. Aussi n’est-il pas indifférent qu’un homme habite un sol argileux, limoneux ou calcaire. Ses idées néanmoins ne s’arrêtent pas là.
À force de marcher, il se convainc d’une part que la condition féminine et que le sort animal sont le plus sûr baromètre des sociétés humaines, l’instrument de mesure de leur invérifiable degré de civilisation, et, d’autre part, il se persuade que tous les grands problèmes du monde, actuels et à venir, seront démographiques ou ne seront pas. Le nombre ferait tout à l’affaire. De l’homme viendrait le désert : point de vue pessimiste, on en conviendra. S’il y a bien une métaphore animale que ce disciple lointain de Walt Whitman et de Jean-Henri Fabre, que cet observateur émerveillé des insectes et des mondes minuscules utilise comme un incessant repoussoir, c’est celle de la termitière humaine. L’entomologiste amateur n’a pas placé pour rien, sur sa table de travail, les deux portraits croisés, voisins de Lévi-Strauss et Dumézil. Le progrès, la technique, le bitume, le plagiste et l’exploitant agricole, le transat et le silo à grain ; tout se tient, il l’écrit, le dit, le répète. Tels sont les agents du drame. Avec cela, l’explosion démographique, le silence de la biodiversité, l’étalement urbain, l’automobilité triomphante, l’écran-roi, la dématérialisation des rapports sociaux, le dogme de la modération, c’est-à-dire la décoloration de nos vies.
Changer de peau
Mais petit à petit, c’est l’essentiel, l’aventurier Tesson opère sa mue, cède le pas au vagabond, et le voyageur intrépide s’efface devant le Wanderer. Deux logiques, la dévoration ou la contemplation de l’espace. Sans renoncer formellement à la première, il se voue passionnément à la seconde. On le voit maintenant sacrifier à d’étonnants rituels, avant, pendant, après le temps du voyage ; sans cesse, il rend grâces et hommage à la nature. Ses gestes sont simples, recueillis. Ils sont ceux d’un pieux desservant. Sa religiosité se renforce. Sur la route, après la prière, un ou deux lézards ; il les salue ; pour cause : ils sont « les héritiers des lointains maîtres du monde ». Sa sympathie pour l’infiniment petit s’accroît à mesure qu’il explore l’infiniment grand. On dirait d’un François d’Assise, se liant gaiement d’amitié avec l’ensemble de la Création, d’un John Muir, se plaignant de l’indifférence des hommes pour les insectes, quand il ne ressuscite pas Thoreau, qui aimait à étreindre les arbres.
Au fond, Tesson fait depuis toujours du voyage une école : « Le voyage est la plus efficace technique de métamorphose de l’homme. » Non seulement il l’instruit, mais l’éduque. Il est une occasion maintes fois renouvelée de faire retour sur soi-même. Tout voyage doit être une façon de petite révolution : il est vain du moment qu’il n’égare, et, qu’il valide celui qu’on était en le débutant. D’après les Romantiques, le crime bourgeois par excellence sous le rapport du voyage a toujours tenu tout entier en un mot : c’était l’invention du « confort », le détestable comfort des touristes anglais, là où, au contraire, pensaient-ils, le voyage devait perturber la quotidienneté, contrarier les habitudes. Inconfortable, il désoriente, déboussole, ou ne sert à rien. Ils reprenaient ainsi à leur compte l’ancienne étymologie de l’aventure comme ce qui, forcément, advient au voyageur. Si rien ne lui advient ou si rien en lui n’advient, l’homme a bougé, il s’est déplacé, mais il n’a point voyagé.
Possédant un sens très aigu de la mise en scène, S. Tesson a déguisé toutes ses mues, de prime abord peu visibles. Il s’est construit un personnage haut en couleur, un peu fantasque, fier-à-bras sans limite, reconnaissable entre tous par ses différents attributs : la flûte, la pipe, le béret, les carnets de poésie. Tout ceci vous pose un homme. Selon le mot d’Hippolyte Taine, l’habit fait presque le moine, et le vêtement, avant tout, est une « conception de soi que l’on porte sur soi ». Nous avons affaire à un caméléon à l’accoutrement bizarre. Peut-on alors au moins l’identifier par sa parenté ? De quelle tradition du voyage hérite-t-il ? Continuons pour cela d’en suivre l’itinéraire.
S. Tesson, je l’ai dit, a d’abord cédé au mirage de l’horizontalité et à la tentation de la verticalité, puis après avoir beaucoup bourlingué, il a imaginé de ne plus bouger. Après tout, il imite Xavier de Maistre, déambulant en pensée autour de sa chambre, ou Des Esseintes, le génial personnage de Huysmans, se demandant curieusement dans À rebours, « à quoi bon bouger, quand on peut voyager si magnifiquement sur une chaise ? »: la relation de voyage incite à l’oisiveté, elle permet de voyager par procuration – sublime loisir !
Sauver sa peau
Enfin, quittant sa cabane, dans une dernière métamorphose intérieure, il s’est proposé à nouveau d’avancer. Cependant, il le fera dorénavant à petites journées : quelque chose a changé. Son corps, cabossé, lui est devenu un fardeau. À Chamonix en août 2014, quelques mois après le décès de sa mère, passablement éméché, il escalade le chalet d’un ami ; il perd prise, chute, s’abîme et manque de mourir. En 1991, son meilleur ami était mort d’une manière semblable. La figure enlaidie, amochée, la personne émiettée, le corps en lambeaux, il est contraint de mettre le bâtiment à la cape.
Mais la convalescence lui a été un nouveau moyen de se projeter, et Tesson a fait le serment, de son lit d’hôpital, de prendre la clé des champs en manière de diète piétonne et de thérapie intérieure. Il veut croire que la route aura sur son corps débilité une réelle influence positive, qu’elle lui insufflera son énergie propre : aussi traversera-t-il la France à pied, du col de Tende au cap de la Hague, de l’été à l’arrière-automne (24 août-8 novembre 2015). Il suivra un itinéraire débutant au sud-est, à la frontière italienne, le menant ensuite graduellement vers le nord-ouest par les Préalpes du Sud, le Comtat Venaissin, puis, une fois franchi le Rhône, par les Cévennes, le Limousin et la Marche, la Touraine, et, au nord de la Loire, il ira enfin du Gâtinais à la côte occidentale du Cotentin.
Le pied : on connaît les louanges que Jacques Lacarrière lui adresse, auxquelles Tesson souscrit sans rechigner, depuis qu’il considère la marche comme un acte discret, mais symbolique de résistance à l’emballement généralisé. Elle est une manière commode d’être en mouvement, sans pour autant être dans le mouvement. Pour jouer encore sur les mots, – mais la langue française, inépuisable, autorise ces contorsions –, le pied ne peut-il pas prendre contre-pied ? Être un pied de nez aux insignifiances contemporaines ? Dans ce cas, on croira opposer la cadence millionnaire du premier pas humain à la marche folle du monde. Mais de ses draps d’hôpital, Tesson se le promet, ce cheminement pédestre sera d’un genre pour lui tout nouveau. Il ne ressortira plus seulement de l’exploit physique, mais d’une nouvelle expérience viatique, plus douce, plus lente, moins heurtée, cherchant, à la faveur de la marche, une certaine plénitude. Il a troqué les traversées éthyliques arrosées de vodka pour s’enivrer de terre, de boue et de poussière : « Être en route, c’est se sentir vivant », écrit-il quelque part.
L’automne en France, une France en automne
Traverser la France – La France ? Elle est un résidu, ce qu’il reste quand on a tout vu, essayé, quand on a tout parcouru. « Il y a ainsi des villes, comme des personnes, écrit Gabriel Fauré, que nous évitons pendant des années sans en savoir au juste la raison et que nous regrettons ensuite d’avoir si longtemps ignorées, lorsqu’une circonstance fortuite les met sur notre chemin. » Telle est la France de Tesson, telle était celle de Jacques Lacarrière : la dernière station. « On court le monde pour chercher ce qu’on avait sous les yeux, hic et nunc. »
Disons-le cependant, la France est un sphinx, à l’identité certaine, mais flottante, discontinue, irréductible, insaisissable en dernière analyse. Humaine, trop humaine, partant complexe, trop complexe, voici l’enseignement de ceux qui l’éclatent et la regardent en poètes, à l’instar, pour ne citer que lui, de Jean-Christophe Bailly. Tout juste peut-on en signaler la mosaïque paysagère, et, tout de suite, il nous faut nous prémunir contre l’image toute faite, héritée de Michelet et de Vidal de La Blache, d’une unité territoriale harmonieusement agencée par-delà son infinie diversité : l’Hexagone est un miroir aux alouettes. Donc, laissons la France de côté. N’en faisons pas l’automate de nos rêves, et considérons plutôt la silhouette plus lisible de ceux, toujours plus nombreux, qui l’arpentent et la racontent. Car sur les sentiers de France se dessine en creux le portrait du voyageur.
Le nôtre nous aide : il les a baptisés. Les siens sont noirs. Qu’est-ce à dire ? La France aurait-elle une couleur ? Comment devons-nous comprendre ce titre ? Que sont les chemins noirs ? Où les trouver ? Il s’agirait de chemins réfractaires, pour ainsi dire entrés en dissidence, tels les angles morts des relevés topographiques, tels ces rebelles de la planification, tels ces rares chemins non balisés, ou dont le balisage s’est estompé sous la patine du temps. Veinures invisibles, ce sont, par exemple, les anciens sentiers muletiers, ceux qui ne résonnent plus d’aucun bruit, sauf du silence, parce qu’ils ont été laissés ou se sont voulus à l’arrière-train de l’histoire, parce qu’ils sont le symbole d’une France dévitalisée, endormie, anémiée, un peu désuète, un peu rétrograde, de cette France ridée et bridée, déprimée au point que d’après l’auteur s’affairent à son chevet ses bourreaux : « Pour eux, la ruralité n’était pas une grâce mais une malédiction : le rapport [celui du sénateur de la Lozère, Alain Bertrand, daté de 2014, sur l’hyper-ruralité] déplorait l’arriération de ces territoires qui échappaient au numérique, qui n’étaient pas assez desservis par le réseau routier, pas assez urbanisés ou qui se trouvaient privés de grands commerces et d’accès aux administrations. Ce que nous autres, pauvres cloches romantiques, tenions pour une clé du paradis sur terre – l’ensauvagement, la préservation, l’isolement – était considéré dans ces pages comme des catégories du sous-développement. »
Triste ironie du sort. Les géographes lui ont tour à tour donné le nom de « diagonale aride », de « diagonale du vide », quoique la « France du vide » (R. Béteille) ne se réduise pas à cette diagonale des échecs, s’étirant des Landes aux Ardennes, qui paraît condamnée « à une sorte d’automne perpétuel de la vitalité » (J.-C. Bailly). Dans tous les cas, théoriser le chemin noir au pays de la surabondance toponymique, dans une France pénétrée, mieux, saturée d’histoire relève incontestablement de l’exercice de style. Au degré même le plus inférieur de la nomenclature, n’y a-t-il pas toujours un lieu-dit ? L’innommé est un luxe de la démesure : le wilderness est une réalité étrangère au petit pays de France.
Anatomie du chemin noir
Le chemin noir est un îlot au sein de l’archipel mégalopolitain mondial, une trouée dans la forêt. À peine affleure-t-il à la surface. Voyez, tantôt il apparaît, tantôt il disparaît. S’il émerge, à fleur d’eau, n’est-ce point un mirage ? Et combien pourtant il recèle de possibles ! Puissance de cette géographie onirique. Les chemins noirs, ce sont aussi les impasses, les clairières, les étroites sentes forestières, les pistes des sous-bois ; tant qu’il y aura des arbres, l’homme pourra y exercer un droit de retrait, s’enfoncer dans le bois pour fuir une civilisation aux abois.
Ce sont enfin tous les chemins qui, ayant un jour bifurqué de l’Histoire, devraient, en brouillant les pistes, ne mener nulle part. Ils pourraient servir de cache, de repli, de refuge. En définitive, Tesson désigne par chemins noirs des espaces rêvés, pour lui idéaux, car négligés, un peu comme s’il leur appliquait pour les définir cette franche confidence de Julien Gracq sur lui-même : « laissez-moi tranquille dans mon coin et passez au large », noli me tangere. On y avancerait à reculons de l’époque, à rebours du flux, marchant contre ses normes, ses injonctions. Et puis, on y cheminerait secrètement, y vivant à discrétion, en marge du monde, de ses bruits, de son tapage, inaudible, invisible, délibérément hors du coup. Ce pourrait être un caravansérail imaginaire, bordé de petits murets de pierre moussus et percé de mille fenêtres ouvertes sur le ciel, une forteresse inexpugnable, hermétiquement close à toutes les tyrannies en vogue. En somme, ce sont des chemins de l’exil intérieur, des chemins hors-circuit, des chemins qui auraient passé leur chemin… Ce bourlingueur s’en veut faire le chantre et le barde : « Ils ouvraient sur l’échappée, ils étaient oubliés, le silence y régnait, on n’y croisait personne et parfois la broussaille se refermait aussitôt après le passage. Certains hommes espéraient entrer dans l’Histoire. Nous étions quelques-uns à préférer disparaître dans la géographie. »
Il y a une beauté infinie, d’après ce voyageur-esthète, dans les chemins qui dissimulent et égarent. La noblesse forcément murmure, taiseuse ; se dérobe ; rase les murs. Il y a de même, d’après ce voyageur-justicier, une profonde injustice, une suprême laideur dans le morne maillage routier, numérique et technocratique – le « dispositif » – qui enserrerait aujourd’hui la France. Bref, l’épouvante, c’est la réticularisation du territoire national. Il en veut faire rendre gorge à ses auteurs, la caste des administrateurs, dont la langue – à laquelle il faut tout rapporter –, vide, vague et vilaine, signale la faillite : où commence l’acronyme finit la pensée, du moins la beauté. Mais de quelle beauté parle-t-on ? « La beauté est le genre de laideur, écrit J.-P. Kauffmann, que chaque génération met à la mode » : Tesson, lui, dont les vues sont plus courtes, choisit délibérément d’exalter une France paysanne, bergère, millénaire, dépeuplée, faite de mas et de chaumières. Mais finalement, qui de la France grimaçante ou du grincheux voyageur a la face la plus endommagée ? Improbable rencontre de deux gueules cassées. « À partir de la mort, la Terre, comme Être repris sur le néant, s’illumine dans toute sa gloire terrestre. » (É. Dardel, L’homme et la terre) Tesson invalide cette belle formule du géographe : son monde n’est pas transfiguré, il est défiguré. La nostalgie l’abuse. Autrefois gai et truculent, le voyageur s’est tout à coup essoufflé. L’univers enfumé de ses précédents ouvrages nous plaisait parce qu’il tranchait sur la désodorisation croissante de l’espace public et l’hygiénisme contemporain. Une certaine âpreté s’en dégageait. L’ennuyeux, c’est combien l’abandon de l’alcool paraît l’avoir dégrisé. Il était plus inspiré, quand il écrivait en 2009 ces quelques lignes, sonnant bizarrement par contraste :
« C’est vrai qu’ils commencent à nous fatiguer drôlement, les nostalgiques de tout poil, les sectateurs de l’âge d’or et autres tristes sires qui ne jurent que par le monde passé. Comme ils sont prompts à déplorer la « fin de l’histoire », la « fin de la géographie », la « fin des voyages ». Et prompts aussi à expliquer que la Terre a rendu gorge de ses dernières beautés, que toutes les routes sont goudronnées, toutes les populations globalisées, tous les paysages aménagés et que le monde ne vaut plus qu’on le sillonne ! »
Même remis de sa chute, même rétabli par l’effort, fortifié par la marche, il n’en avance pas moins constamment muni d’œillères, s’enlise, et ne se rassérène plus, sauf, peut-être, à l’approche de la mer. Alors seulement il s’apaise. Les dernières pages du livre sont les mieux réussies.
Tout sujet, tout objet s’identifie dans la confrontation avec l’autre. Toute merveille a besoin d’un épouvantail. À quoi va-t-il alors opposer ses chemins noirs ? À la France goudronnée, d’abord. Le goudron fait écran à la vie. Avec lui, l’humanus divorce de l’humus, l’homme se dissocie de la terre. On en pressent de fâcheuses conséquences. La nature est devenue environnement, l’homme le centre de tout et l’exception parmi le Vivant : dès lors, tout lui serait permis, à commencer par l’appropriation terrestre et des déprédations sans nombre. Or, Tesson veut tout égaliser, pour tout préserver. Il veut détrôner l’homme, démythifier l’anthropocène, décentrer le regard sur la biodiversité terrestre, déconstruire l’étiquette biblique selon laquelle toute espèce devrait par nature tirer sa révérence à l’homme (Gen, I, 26). En somme, aucune prévalence d’honneur ne devrait pouvoir lui être reconnue. Il faut, dit-il, émanciper la nature de l’emprise humaine et replacer l’homme dans la double épaisseur du Temps et du Vivant. Il est une pièce parmi cet intrigant puzzle, apparue tout en bas de la toute dernière page du livre terrestre, lui-même le dernier tome de l’encyclopédie universelle…
À la France périurbaine, ensuite. Il prend un soin infini à la contourner, et, quand il ne le peut pas, on l’entend sans fin conspuer cette « géographie du non-lieu », empruntant au passage à l’anthropologue Marc Augé ce concept controversé. Comme souvent dans ce récit, le voyageur, qui pourtant nous avait habitués à bien plus de subtilité et de talent, manque de finesse. Adoptant une vision unitaire, il généralise à tort ce « tiers-espace » (M. Vanier), ni vraiment rural, ni seulement urbain. Il le crayonne trop vite comme pour mieux le croquer. Or, tous les travaux récents de géographie mettent en évidence la diversité réelle et la complexification nouvelle des formes du périurbain qu’on ne peut plus associer, sauf à se le représenter statique et à en réduire l’originalité croissante, au refoulement urbain, au repli identitaire, bref au territoire subi qu’il n’est pas ou qu’il n’est plus.
On peut cependant reconnaître avec l’auteur un fait de première importance, un signe indubitable, la preuve évidente et symbolique d’une mutation historique : la sécularisation des sociétés européennes, qui a entraîné symboliquement le primat urbanistique de l’argent. À l’évidence, la ville, son centre et sa périphérie ont ôté leur parure religieuse, aussi bien matérielle qu’immatérielle. En lieu et place des temples, des églises et des cathédrales, des petites et grandes mosquées, qui hier trônaient fièrement au cœur des cités, les banques, sièges sociaux et autres gratte-ciel, et, pour remplacer la ceinture du pomerium, qui délimitait à Rome et dans les autres cités du monde romain le territoire sacré, des temples tout neufs ont été dédiés aux nouveaux dieux : ceux de la consommation et de l’hyperconsommation, supermarchés et hypermarchés. Avec un décalage d’une trentaine d’années sur les États-Unis, la rupture s’enracine, en France, lors des Trente Glorieuses. La verticalité a changé de nature. Son ancien régime était céleste. Il était un pont vers la cité de Dieu, au lieu que le nouveau régime est une vitrine de la cité de verre, une vitrine terrestre. Les dieux se retirent.
De la broussaille à l’impensé
Soit, il n’y a plus d’isolat ou d’espace naturel. L’espace géographique est pleinement un espace construit. Mais le grand deuil contemporain, c’est qu’il est devenu un enjeu, une ressource, un espace pensé, quadrillé, mis en valeur, en tourisme, en réseau ; Tesson voudrait, même un peu, qu’il demeurât encore impensé. Or, cette France qu’il prise, qu’on aimerait arpenter après lui, loin d’être impensée, est investie de toutes les absurdités du moment : c’est l’homme malade des métropoles, le pays des faibles densités, cette France, hyperrurale, qu’on regarde de loin au mieux comme un blessé, au pire comme un moribond, et toujours, comme un assisté. On nous la présente pour l’ordinaire en crise et déprise, mais également, de plus en plus, en renaissance et métamorphose. Jean-Paul Kauffmann, qui a récemment remonté avec bonheur la Marne, a bien mis en lumière la vitalité de la vie associative, la part des solidarités et des initiatives, y voyant une preuve certaine de la résilience des territoires qu’elle draine. Au fond, tout est affaire d’échelles : les étudiants qui préparent en ce moment la question des concours de recrutement de l’enseignement sur la « France des marges » en savent quelque chose. Ils ont d’ailleurs tout intérêt à lire ou consulter cette relation de voyage. Mais ils doivent être renseignés, pour finir, sur le lignage de S. Tesson et sur ceux de ses devanciers les plus illustres, après lesquels il marche et avec lesquels il est nécessaire de le mettre en regard. D’où parle-t-il ?
Ce lignage est celui de ces voyageurs en fuite pour qui l’espace est un prétexte au temps, un motif d’ensevelissement personnel et dont, sans doute, Loti serait l’indépassable modèle. On parlera de « syndrome Loti » pour caractériser un appel de la route, subit, violent, irrépressible, qui conduit à vouloir abolir l’espace pour surmonter le temps, en conjurer la fuite quitte à s’inventer un asile : « Le voyage piège le temps ». D’après Bainville, cette tradition, selon lui neurasthénique du voyage, est l’une des pires qui soit, parce qu’elle promène avec langueur sur les chemins sa mélancolie. Si l’on ne peut dire ceux-ci blancs, les cosmographes les ayant partout griffonnés, s’ils pourraient à la rigueur être gris, grisâtres, en prenant l’auteur au mot, en le croyant sur parole, nous les trouvons noirs, bien noirs : noirs d’abandon, noirs d’inconnu, noirs enfin des idées que S. Tesson roule incessamment sur eux. L’image est bien sombre. Nous cheminons à notre tour la gorge serrée, le cœur triste, les poumons encombrés.
Les idées que ce saltimbanque ambulant, que ce promeneur intranquille traîne sur les hommes, sur le monde, la France, depuis plusieurs années en germe dans son œuvre, ces idées accusent son inconsolable noirceur intérieure. Du reste, en fait-il vraiment mystère ? « Mais les derniers mois m’avaient changé et cette courte marche dans le décor du pays avait accéléré la réforme. Je n’aurais plus honte désormais de m’avouer nostalgique de ce que je n’avais pas connu. […] Était-il malséant d’établir une hiérarchie entre les choses ? De préférer la France de Roupnel – fût-elle fantasmée – aux alignements des maisons mortes ? » S’ensuit une enfilade d’observations désabusées, face auxquelles on émettra pour finir quelques nouvelles réserves.
D’une géographie héroïque à une géographie mythique
Ainsi, la France et le monde se seraient enlaidis par suite de plusieurs dérives, celle-ci démographique, celle-là écologique. À leur tour, les hommes se seraient ensauvagés, par suite d’une frénésie d’existence. Et le territoire, aménagé, aurait définitivement rompu avec le merveilleux. Le constat est sans appel ; c’est le réquisitoire esthétique et moral d’un homme amer, désabusé, antimoderne, un peu figé dans la posture de l’ermite des forêts, qui nous invite à cette géographie dissidente dont la friche tiendrait lieu de manifeste et le genêt d’emblème. Ce livre, plus séduisant que stimulant, veut moins donner à voir un territoire à aménager, qu’un espace à ménager, à sanctuariser, à mettre sous cloche.
Faut-il finalement trancher sur cet ouvrage ? Que conclure de cette géographie inquiète de la broussaille, de cette géographie désappliquée à laquelle l’auteur nous convie ? Doit-on voir en elle une saine résistance face au pragmatisme, il est vrai déconcertant des « décideurs », ou bien, reprocher à son auteur son martèlement, insuffisamment nuancé pour être pertinent ? Dans tous les cas, son plaidoyer, excessif, simpliste sans nul doute, mérite d’être entendu, ne serait-ce que par la visibilité éditoriale et médiatique de celui qui s’y livre. S’il faut en toutes circonstances renouer avec cette « géographie mythique », naïve et sensible, dont Dardel a retracé à gros traits magnifiques l’histoire, s’il est un impératif de chaque instant de remettre du cœur où a déserté la vie et l’esprit, s’il faut, d’un mot, poétiser l’espace à l’encontre de tous les marchands du vulgaire, il faut tout autant, exerçant ses devoirs de lecteur, mettre à distance le voyageur de l’objet du voyage sans qu’il soit permis de confondre et l’un et l’autre. Or, les chemins noirs, s’ils nous renseignent utilement sur le premier, obscurcissent ce dernier. Et la France, avec cela, demeure une étrange personne.
Antoine Vermauwt, février 2017