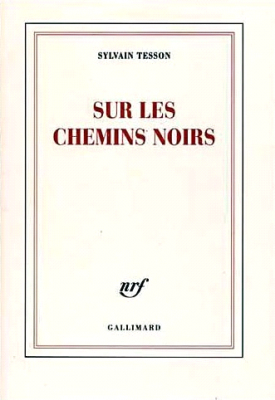Un écrivain, Sylvain Tesson, vient de fouler ce qu’il baptise la France des chemins noirs. Sur les chemins d’une France en berne, il promène sa nostalgie d’un monde perdu, idéal, fait de ruines et de ronces, de parenthèses et d’interstices, perpétuellement défait par des générations d’hommes pressés. Du Mercantour au Cotentin, en passant par le Perche et l’Aubrac, la Margeride et le Bas-Vivarais, il arpente une France intérieure propice à cette « géographie de l’instant » dont il a, mieux que l’intuition, la vocation. Il est tombé, il a mûri, sa prose est devenue mature, plaisante, facile, trop facile peut-être, se révélant sommaire.
Une existence en surchauffe
Cet homme infatigable, dont on ne sait s’il voyage pour écrire ou s’il écrit pour voyager, est certainement aujourd’hui l’écrivain-voyageur français contemporain le plus en vue, et l’un des plus connus du lectorat. Pareille fortune mérite attention, parce qu’au-delà de ce qu’elle nous apprend de l’auteur lui-même, cette popularité est le miroir d’une demande sociale, d’une aspiration croissante vers un je ne sais quoi d’extravagant – au sens premier du mot : menant hors de la voie normale – qu’il faudra interroger. Elle nous renseigne sur une personne, mais surtout, elle nous enseigne sur une époque : arrêtons-nous sur le renseignement, qui peut-être nous dira un peu de l’enseignement.
Partout, on le sait, S. Tesson a roulé sa bosse. À peine sorti de l’adolescence, on le voit pédaler en Islande (1991), non sans une grande part d’improvisation, à une époque où le tourisme y est à la veille d’entamer son grand essor. Trois ans plus tard, il entreprend un tour du monde au long cours, à bicyclette, avec son camarade Alexandre Poussin (1994) : première d’une longue série de cavalcades amicales. Bientôt, il s’enhardit : c’est à l’Himalaya qu’il s’attaque (1997). En surchauffe constante, courant de pics en cols, de cimes en défilés, de parois montagneuses en façades urbaines, cet Homo viator, tour à tour alpiniste, acrobate, cavalier et escaladeur, surfeur et parachutiste, a fait choix de vivre dangereusement, de mener, selon le joli mot de L. Febvre, une existence « de plein vent ».