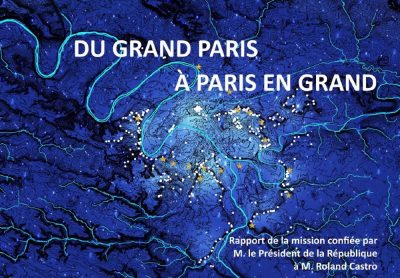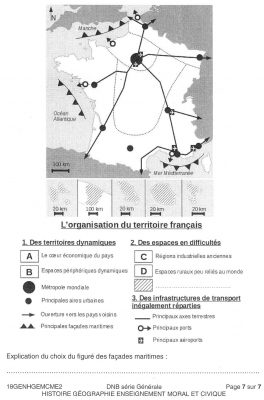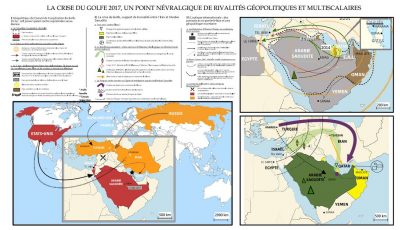© Studio NAB. Le projet imaginé par le studio d’architecture NAB. (Studio d’architecture NAB)
Il ne fallait pas attendre bien longtemps pour voir les grandes signatures de l’architecture se manifester pour la reconstruction de Notre-Dame. C’est un peu comme Le Corbusier sous les bombes de la débâcle en 1940 qui rêvait du réaménagement de la France.
Au-delà des Anciens et des Modernes, je note l’intérêt évident de « touristifier » la toiture du bâtiment en en faisant un point d’attraction, alors que la charpente avait surtout l’objectif de porter la très lourde toiture en plomb. Là où seuls les artisans et ceux qui ont entretenu « la forêt » étaient présents sous l’œil de Dieu, on va convoquer les foules.
La transparence s’impose dans notre modernité, comme pour la coupole du Reichstag, à un moment où le Ciel lui-même est devenu bien transparent. Pourquoi alors ne pas faire monter la Terre au Ciel ? diront certains, avec l’engazonnement des toitures, ou faire pousser une forêt, cette fois au sens propre dans les combles de l’édifice. A mon avis, un peu déplacé. Pourquoi ne pas imaginer une biblique arche de Noé ? Sans doute un peu étroit pour accueillir toutes les espèces menacées de disparition.
Dans les symboles, le choix collectif ou présidentiel de la reconstruction va être intéressant : va-t-on déifier l’Histoire, la Technique, l’Environnement … le Touriste ? Quelle place alors pour le Religieux, même si c’est bien l’Etat laïc qui est aux commandes et qui risque de faire peu de cas de la théologie, sinon la sienne ?
La transparence est bien la clé de ce XXIème siècle débutant, pas étonnant qu’il s’invite dans les hauts lieux de notre patrimoine : un plaisir scopique et un programme politique, voire technologique avec l’ouverture des données publiques et personnelles.
Mais peut-on opposer transparence et consistance ? Ce serait trop simple. Le débat qui s’ouvre après les porte-monnaie va s’avérer passionnant et révélateur.
Antoine Beyer, avril 2019