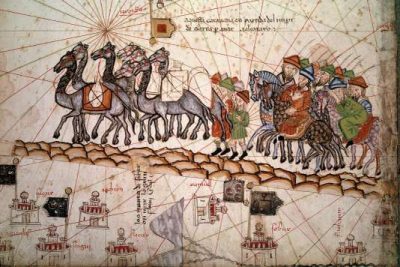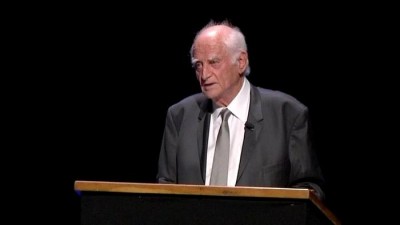Jean-Pierre RAISON nous a quittés. Il nous avait rejoints une dernière fois aux Cafés-géo, lors d’un repas en décembre 2014, dans un de nos « restau-géo », malgache en l’occurrence, qu’avait animé Françoise, son épouse, spécialiste de l’histoire contemporaine de Madagascar. Tous deux avaient vécu plus de huit ans à Madagascar et sa thèse « Les hautes terres de Madagascar et leurs confins occidentaux. Enracinement et mobilité des sociétés rurales », publiée en 1984 a constitué un des travaux majeurs de la géographie tropicale de langue française, dans la lignée de Paul Pélissier qui fut son maître et inspirateur, et de Gilles Sautter. Depuis 1989 il avait été mon collègue au Département de Géographie de Nanterre, dont aux Cafés-géo nous avons accueilli bien des géographes qui étaient tous ses élèves : Alain Dubresson, Philippe Gervais-Lambony, Frédéric Landy, Emmanuel Lézy, Sophie Moreau.
Jean-Pierre RAISON avait acquis de la société malgache une connaissance intime dont je peux témoigner moi qui ai eu la chance de le suivre dans le dédale des sentiers qui relient les villages de Hautes Terres. « Le géographe est forcément un sensuel » disait Jean-Pierre dont la curiosité était sans limites.
Au-delà de ce terrain, Jean-Pierre Raison avait été un acteur très important des débats et remises en cause qui ont animé la géographie tropicale de langue française à partir de 1960.
Un livre d’évocations, d’hommages, de souvenirs, dont le ton inattendu, est celui d’une « autre géographie » est fortement recommandé à tous : « Les raisons de la géographie, itinéraires au Sud avec Jean-Pierre Raison » Karthal, 2007
Michel Sivignon Le 21/07/2016
Alain Dubresson, son continuateur à Nanterre, nous a autorisés à reproduire le texte qui suit.
Jean-Pierre Raison, professeur émérite de Géographie, nous a quittés dans la nuit du 16 au 17 juillet 2016. Il s’est éteint sur le sol du Livradois auquel le liait une profonde passion, partagée avec les hautes terres malgaches et les campagnes africaines. Né le 8 août 1937, ce « sédentaire contrarié », comme il s’est défini lui-même, n’a cessé de pratiquer d’incessants va-et-vient entre les institutions d’une part et ses terrains de prédilection d’autre part.
Ancien élève de l’École Normale Supérieure (Ulm) de 1957 à 1962, reçu premier à l’agrégation de Géographie en 1961, il débute sa carrière d’enseignant au Lycée Eugène Fromentin à La Rochelle. En 1964, détaché à l’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer (ORSTOM, aujourd’hui Institut de Recherche pour le Développement, IRD), il est affecté à Tananarive et y devient chef de la Section de Géographie. Nommé en 1977 Directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), il prend en charge la chaire de géographie des petits espaces ruraux. Mis à la disposition du ministère des Relations extérieures après 1981, Jean-Pierre Raison devient sous-directeur de la Recherche et de l’Information scientifique, puis il est élu professeur à l’université de Paris X-Nanterre (chaire de géographie tropicale) en 1989. Il y exerce les fonctions de Directeur adjoint de l’UFR SSA et de responsable pédagogique du premier cycle et dirige le laboratoire Géotropiques (EA 375) de 1997 à 2001.
(suite…)