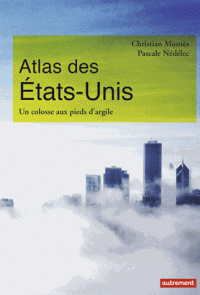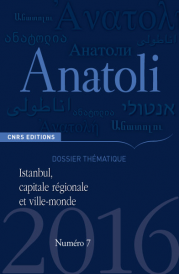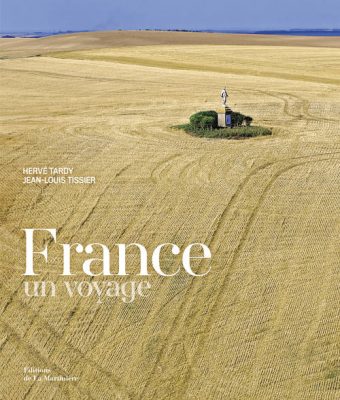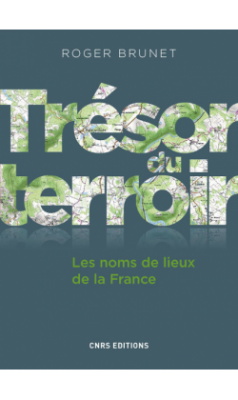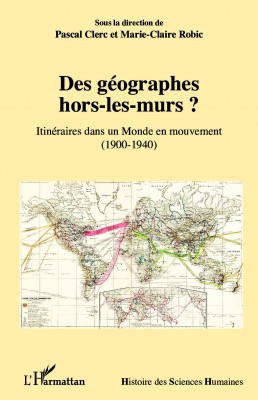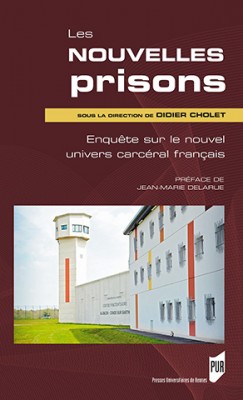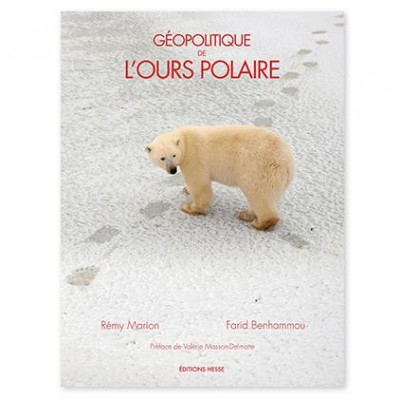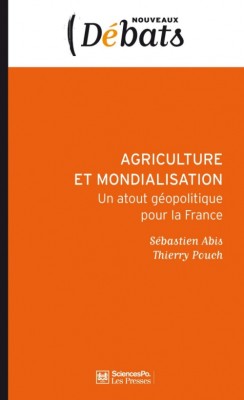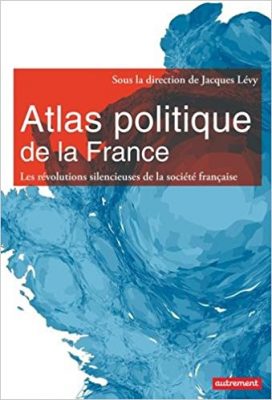
Jacques Lévy, Atlas politique de la France. Les révolutions silencieuses de la société française, Editions Autrement, 2017, 95 p.
L’atlas politique de Jacques Lévy vient à son heure. Il fait montre d’une curiosité très large et suggère que tout peut faire géographie. Son mérite principal est de rassembler des données que les géographes ne sollicitent ordinairement pas, de les synthétiser et de rechercher dans les scrutins qui viennent de se dérouler des signes de l’émergence de phénomènes nouveaux qui affectent la société française.
Après plusieurs mois de fièvre électorale, marquée par la publication de nombreuses cartes dans les quotidiens et périodiques, rendant compte de la distribution géographique des scrutins et aussi par les nombreuses analyses accompagnant ces cartes, Jacques Lévy propose de faire le point.
Cet atlas s’inscrit dans une collection très fournie d’atlas publiés chez le même éditeur, collection qui témoigne d’un intérêt soutenu pour l’expression cartographique appliquée à des thèmes extrêmement variés. Les géographes ne peuvent que se réjouir de cet intérêt et de ces efforts pour le combler.
Le souci cartographique, l’ambition de communiquer par la carte est un besoin ancien, mais qui s’est répandu depuis la dernière décennie dans la presse et l’ensemble des médias. Comment ne pas être surpris de l’extrême abondance des cartes offertes au lecteur après chaque épisode de la session électorale que nous venons de vivre.
Les médias demandent à des spécialistes de science politique d’en faire le commentaire, mais de nombreux géographes sont également sollicités, ce qui contribue heureusement à mettre la géographie sur le devant de la scène
Le propos de Jacques Lévy n’est pas de participer à cette diffusion de l’image cartographique, mais de montrer que les résultats des scrutins qui viennent de se dérouler reflètent ce qu’il appelle « les révolutions silencieuses » de la société française. Il s’agit de tirer de la carte électorale un diagnostic.
Ce travail appelle d’abord quelques remarques techniques. La quasi-totalité des cartes est produite par anamorphose ou si l’on préfère ces cartes sont des cartogrammes. La plus grande partie de ces cartes prend comme base spatiale le département et applique la règle qui consiste à substituer à la surface de l’entité spatiale choisie une valeur qui peut être la population ou les résultats d’un scrutin, soit en valeur absolue soit en valeur relative. Cette méthode suppose que les surfaces attribuées à chaque entité soient déformées considérablement par rapport à la surface réelle et donc que les entités soient difficilement reconnaissables. Survient donc un problème de lecture des cartes : les grandes villes sont reconnaissables, mais les entités de petite taille le sont beaucoup moins.
Le plan de l’ouvrage est parfaitement démonstratif de la voie choisie.
La première partie s’intitule « Portrait de la France mutante ». Je ne suis pas sûr que mutant signifie autre chose que changeant : la mutation a remplacé le changement depuis quelques lustres dans la littérature des sciences sociales. Modification du vocabulaire plutôt que nouveau concept.
Le premier chapitre décrit « Le périurbain et l’ascension du Front National. » C’est le fondement de l’interrogation majeure : à quelles particularités sociales correspond la répartition spatiale du vote en faveur du FN. Dans ses développements, l’auteur emploie un grand nombre de dénominations où le lecteur a du mal à se retrouver entre le périurbain, les zones hypo-urbaines et l’infra-urbain. Pour une part il s’agit de catégories de l’INSEE et pour une autre part, (le périurbain) de catégories propres à l’auteur.
L’auteur est tout-à-fait fondé à lier le vote FN aux scrutins reliés à la question de l’Europe : en particulier au référendum de 2005 sur la Constitution européenne.
Les cartes donnant les résultats des élections en Grande-Bretagne, Autriche, Finlande sont très éclairantes et Jacques Lévy a eu la bonne idée d’y joindre les votations suisses. Résultat : nous pouvons ainsi déprovincialiser notre réflexion et trouver des correspondances au-delà de nos frontières. La carte du vote américain aux présidentielles (Trump contre Clinton) vient à l’appui mais demanderait bien sûr de plus amples développements.
A cette réserve près les cartes européennes sont parmi les plus intéressantes du volume.
Le dernier ensemble de ce premier chapitre, au titre énigmatique « L’espace change de place » est à mon sens moins convaincant.
Vient ensuite un chapitre intitulé « Manières d’habiter » où le lecteur quitte les résultats électoraux pour se mettre en quête d’explications dans le domaine sociologique et dans le domaine économique.
L’auteur abandonne à juste titre la technique des anamorphoses pour cartographier le prix du sol habitable en 2017. C’est une des cartes les plus importantes, car elle témoigne d’inégalités fondamentales de notre société, inégalité des patrimoines plus encore que des revenus. Inégalité qui détermine en partie les choix de résidence. Une bonne réflexion nourrit cette question des choix de résidence. Choisit-on vraiment ?
Il convient de la rapprocher d’une carte de la capacité financière d’accès au sol (p.44)
Il y a à mon sens moins d’explications claires dans la taille moyenne des ménages et moins encore dans les naissances hors mariage. Même remarque avec la possession d’une ou plusieurs voitures.
Le mode de garde des enfants est éclairant, mais nécessiterait d’être affiné. Il me semble ici que les cartes à l’échelle nationale n’apportent pas de réponse convaincante.
A ce stade de la lecture, voici quelques exemples parmi les plus caractéristiques.
La carte de la répartition des ouvriers est difficile à analyser sans prendre en compte les évolutions des autres secteurs de la population active : oui, les ouvriers l’emportent dans beaucoup de campagnes, parce que l’emploi agricole est devenu marginal et parce que dans ces campagnes, les services du secteur tertiaire sont limités. Des cartes bien venues viennent nous en persuader.
Plus inattendue est la carte de l’économie créative (p.54), notion que Lévy lui-même qualifie de critiquée, mais stimulante.
A partir du chapitre « Développement et justice », l’atlas part dans des directions inattendues et il n’est pas toujours sûr que la carte fournie soit une source d’information suffisante. Que tirer par exemple des cartes des « flux paradoxaux » ou l’on voit la localisation des hypermarchés, des restaurants, des pharmacies, des salons de coiffure ? Même remarque pour ce qui est intitulé « L’enjeu écologique ». Certaines cartes posent un problème de fiabilité. Telle la carte de la page 63 intitulée « les liens entre espaces locaux dans le Centre-Est ». Sans doute s’agit-il d’une carte fondée sur des données de la DATAR. Mais comment expliquer l’absence de liens entre Mâcon et Lyon? Est-ce simplement parce qu’on ne considère que les liens intérieurs à chaque région et que Lyon et Mâcon appartiennent à deux régions différentes?
La réponse est peut-être donnée par Jacques Lévy lui-même qui souligne que « produire des typologies est toujours destructeur de singularités » (p.54). On ne saurait mieux dire.
Au-delà du livre de Jacques Lévy, dont les mérites sont grands, apparaissent ici les fondements d’un débat qui se poursuit depuis quelques années, à la suite de divers travaux dont ceux de Christophe Guilluy : Fractures françaises en 2010, puis Le crépuscule de la France d’en haut en 2016)
Ce débat est réapparu à la faveur des élections de 2017. Dans le même organe de presse, « Le Monde », sont publiés le 27 avril sous le titre « Deux France face à face» des papiers de Hervé Le Bras, Jacques Lévy, Christophe Guilluy, Béatrice Giblin, puis le lendemain, le 28-04-2017 un autre article, signé de Frédéric Gilli, qui en prend le contrepied : « Non, il n’y a pas deux France qui s’opposent».
Ce débat confronte la légitimité de la généralisation en sciences sociales, position qui est celle aussi bien de Jacques Lévy que de Christophe Guilluy au souci de coller au plus près au terrain qui est celui des universitaires ou chercheurs qui reprocheraient volontiers aux premiers une certaine désinvolture par rapport à la complexité des situations locales. Dans ce débat, l’Atlas politique de la France apporte sa très utile contribution, mais il est loin de le clore. Gageons que les « révolutions silencieuses » vont encore faire couler beaucoup d’encre.
Michel Sivignon 13 juillet 2017