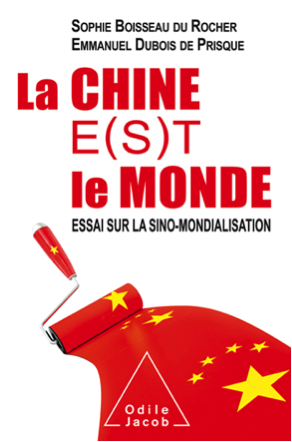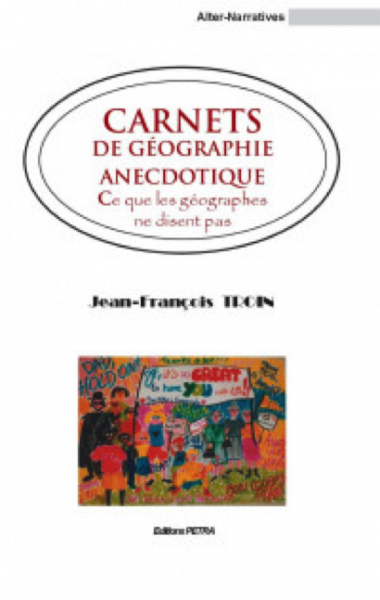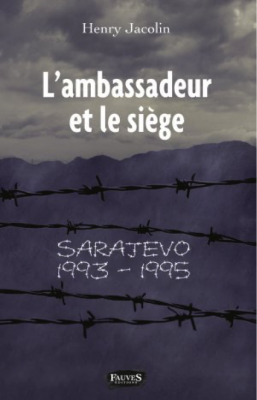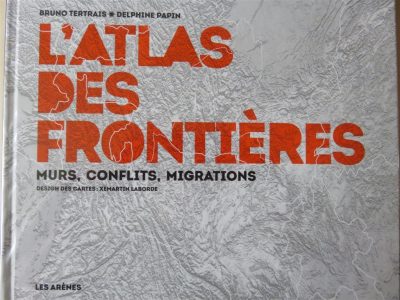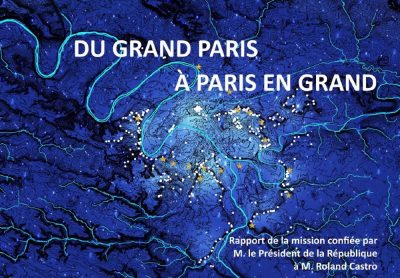Armand Frémont lors d’une conférence à la médiathèque de Coutances (Source: Ouest France, 6 octobre 2015)
Armand Frémont, qui vient de nous quitter aura marqué la géographie contemporaine de langue française.
Il fut d’abord et très profondément attaché à sa Normandie natale. Attaché en particulier à la ville du Havre et à ce village de l’Eure, Francheville, où avec Monique, sa femme, ils ont passé beaucoup de temps, ces dernières années.
Sans doute beaucoup de géographes ont-ils eu un parcours similaire qui consiste à suivre une veine régionale : pourquoi ne pas exploiter une connaissance intime d’une société inscrite dans votre terre d’origine et en faire un objet d’étude ? Cette démarche était encouragée par l’orientation de la géographie vers les études régionales, depuis les premiers développements de la géographie scientifique, au XXe siècle.