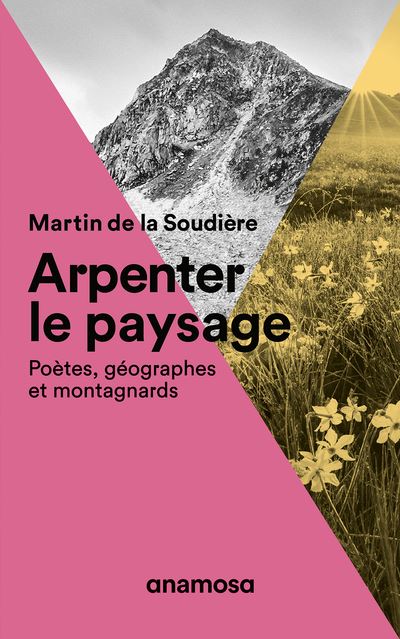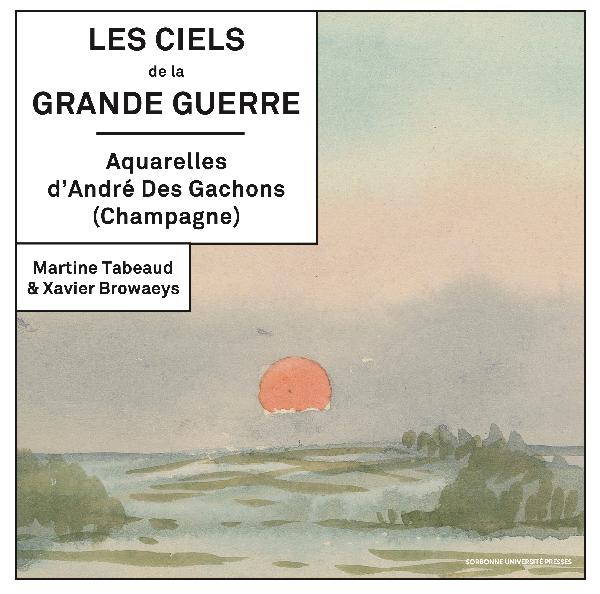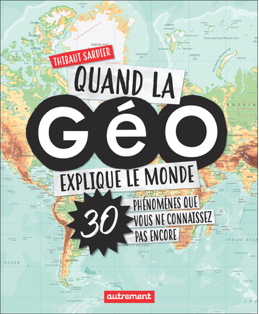De droite à gauche, Marie-Claire Robic, Nicolas Ginsburger et Denis Wolff.
Le 18 octobre 2022, Nicolas Ginsburger (historien), Marie-Claire Robic et Jean-Louis Tissier (géographes) furent les invités des Cafés géo au Flore afin d’évoquer le travail, l’action et la vie des géographes français pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dirigé en 2021 un volumineux ouvrage composé de vingt chapitres rédigés par quinze auteurs. Ce livre, accessible en Open edition, a donné lieu à de nombreux comptes rendus (dans les Annales de géographie, Cybergeo, GéoCarrefour, Confins, The AAG, les Cahiers de géographie du Québec… ). (suite…)