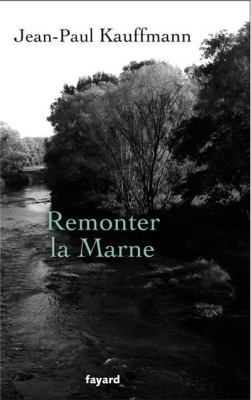Un géographe qui voyage cherche assez vite à « prendre de la hauteur », non par un quelconque complexe de supériorité mais plutôt pour embrasser le paysage qu’il découvre. Cette position lui permet d’exercer ses capacités d’analyse spatiale liées à sa formation géographique. Julien Gracq appartient à cette catégorie d’écrivains pour qui un paysage révèle plus facilement ses secrets depuis un promontoire ou un belvédère, ce qui lui fait préférer les vues panoramiques, les vastes espaces et les horizons vertigineux. Dans Un balcon en forêt (1958), dès les premières pages du livre, le personnage principal s’arrête un instant sur un point haut aménagé au bord de la route en lacets pour regarder le paysage de la vallée en contrebas :
Un géographe qui voyage cherche assez vite à « prendre de la hauteur », non par un quelconque complexe de supériorité mais plutôt pour embrasser le paysage qu’il découvre. Cette position lui permet d’exercer ses capacités d’analyse spatiale liées à sa formation géographique. Julien Gracq appartient à cette catégorie d’écrivains pour qui un paysage révèle plus facilement ses secrets depuis un promontoire ou un belvédère, ce qui lui fait préférer les vues panoramiques, les vastes espaces et les horizons vertigineux. Dans Un balcon en forêt (1958), dès les premières pages du livre, le personnage principal s’arrête un instant sur un point haut aménagé au bord de la route en lacets pour regarder le paysage de la vallée en contrebas :
« De là le regard effleurait le sommet du versant d’en face, un peu moins élevé ; on voyait les bois courir jusqu’à l’horizon, rêches et hersés comme une peau de loup, vastes comme un ciel d’orage. A ses pieds, on avait la Meuse étroite et molle, engluée sur ses fonds par la distance, et Moriarmé terrée au creux de l’énorme conque de forêts comme le fourmilion au fond de son entonnoir. La ville était faite de trois rues convexes qui suivaient le cintre du méandre et couraient étagées au-dessus de la Meuse à la manière des courbes de niveau ; entre la rue la plus basse et la rivière, un pâté de maisons avait sauté, laissant un carré vide que rayait sous le soleil oblique un stylet sec de cadran solaire : la place de l’église. Le paysage tout entier lisible, avec ses amples masses d’ombre et sa coulée de prairies nues, avait une clarté sèche et militaire, une beauté presque géodésique (…) »
(suite…)