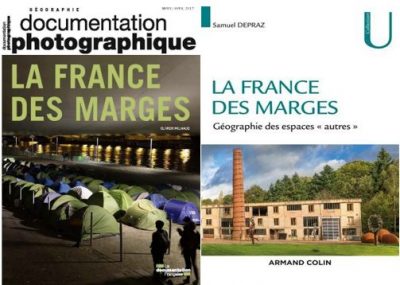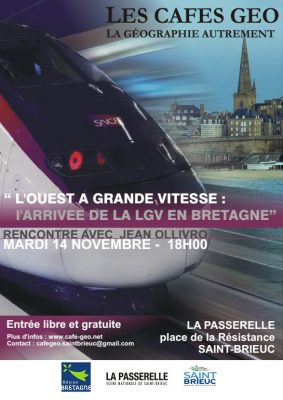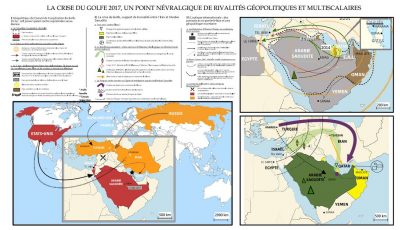La construction européenne est aujourd’hui vieille de près de huit décennies. Depuis plus de dix ans sa dynamique semble s’être enrayée au point d’apparaître en péril pour n’avoir pu lever les ambiguïtés qui ont présidé à sa naissance et à son développement. D’autant plus qu’une part importante des sociétés européennes la rend responsable des difficultés liées à la mondialisation croissante et à la nouvelle donne géopolitique, économique et technologique. Crise, rebond possible, désir, nécessité, tout se mêle aux yeux des opinions publiques comme des dirigeants politiques.
1.Une crise profonde : le projet européen dans l’impasse ?
Depuis le plan Schuman de 1950 (à l’origine de la Communauté européenne du charbon et de l’acier), une histoire cyclique a marqué les avancées et les reculs du projet d’unification européenne qui a néanmoins avancé vers l’approfondissement et l’élargissement. Des étapes majeures ont été franchies : le traité de Rome (1957), l’accord de Schengen (1985), le traité de Maastricht (1992), la création de l’euro (2002). Mais depuis 2005 la construction européenne piétine, une succession de crises révèle que ses fondements même sont menacés. Trois crises majeures ont ébranlé le projet européen : la crise financière mondiale de 2008, la crise migratoire à partir de 2013, le Brexit en 2016.
La crise financière mondiale de 2008 a mis à rude épreuve l’Union économique et monétaire (UEM) avec le risque d’un éclatement de la zone euro. Une série de réponses européennes a permis de surmonter cette crise de l’euro mais la divergence des trajectoires économiques en Europe s’est poursuivie, creusant toujours plus le fossé entre le nord et le sud de l’Europe.