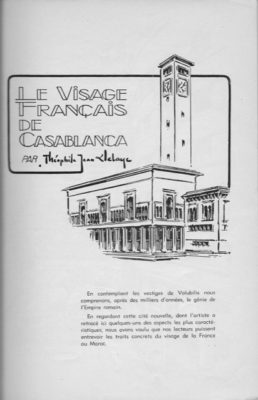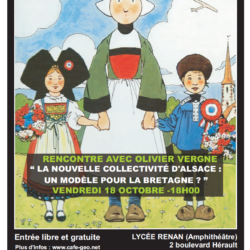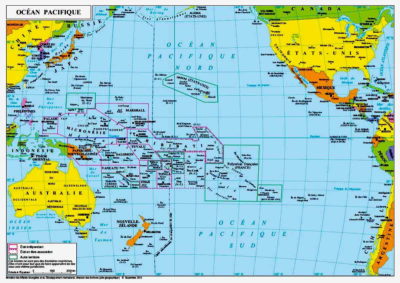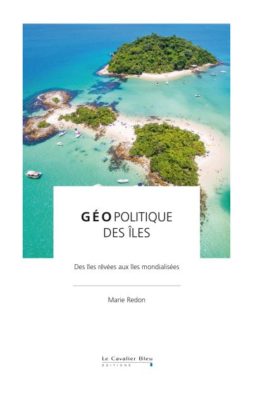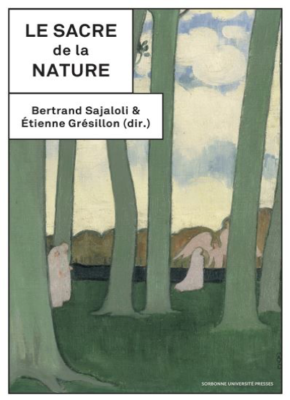Le 9 octobre 2019 les Cafés Géo de Chambéry-Annecy ont accueilli au Café Le Beaujolais de Chambéry trois étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc venus présenter leur sujet de mémoire réalisé durant leur Master de géographie. Par ce Café Géo singulier, les travaux de recherche d’étudiants en géographie ont été mis en lumière, en suscitant le grand intérêt voire l’inspiration d’un public en grande partie étudiant.
Les trois sujets présentés ont été développés par Fabien Pouillon, Thomas Matheret et Axelle Egon qui ont respectivement traité du grindadráp aux îles Féroé, du geocaching, et des conflits liés à la ZAD de Roybon et à son projet de Center Parcs.
Le grindadráp aux îles Féroé : spatialités d’une controverse environnementale
Situées dans l’océan Atlantique Nord à égale distance de l’Islande et de l’Écosse, les dix-huit îles composant l’archipel féroïen sont depuis les années 1980 régulièrement soumises à la critique internationale pour la pratique de chasse aux petits cétacés s’y déroulant (le grindadráp). Opposant ONG environnementalistes et certains Féroïens, la controverse autour du grindadráp intéresse le géographe à plusieurs titres : pratique de chasse locale mobilisant des organisations internationales, elle implique des échelles différentes et soulève des débats sociaux majeurs.
En dépassant l’image très désordonnée diffusée par les vidéos exposant l’abattage et visant à susciter le dégoût, les logiques spatiales de la chasse sont présentées au travers de ses différentes étapes. Du repérage du banc de cétacés à la distribution du produit de la chasse, l’organisation du grindadráp au sein de la société féroïenne est particulièrement expliquée et dévoile une pratique réglementée, socialement codifiée et hiérarchisée.
Dans un second temps, les modalités de la controverse sont développées. Les positions des opposants et des partisans sont tout d’abord commentées au travers de diagrammes représentant les principaux champs d’argumentation mobilisés dans la controverse. Des pétitions aux campagnes de sabotage et d’interposition menées par l’ONG Sea Shepherd sur l’archipel, les différentes formes de la controverse sont ensuite situées dans leur chronologie et hiérarchisées selon le niveau de violence employé.
Enfin, l’efficacité des méthodes employées par les ONG environnementalistes et de la médiatisation de la controverse est remise en question. Si les mobilisations internationales ont conduit à une amélioration des conditions de prélèvement des animaux, elles participent aussi à la pérennisation de la chasse par son adaptation et par la valeur identitaire – à défendre – qu’elles induisent.
Fabien Pouillon, Master 2 Géographie et Aménagement, Université Savoie Mont Blanc
Le geocaching : entre processus de territorialisation et (re)connaissance patrimoniale
En tant que pratique ludique relativement peu populaire, le geocaching est d’abord remis dans son contexte avec une première approche localisée (un lieu du geocaching dans le centre de Chambéry). Le geocaching est défini comme une pratique ludique et gratuite, permettant de faire connaître des histoires, des lieux, des modes de vie, des monuments relativement peu institutionnalisés du point de vue patrimonial ou touristique. Cette pratique, née aux États-Unis au début des années 2000, a été ensuite rapidement mondialisée, se heurtant tout de même aux aléas géopolitiques et restant surtout une pratique ludique occidentale.
Cette pratique est permise par la mise en place d’une application, puis par la recherche de géocaches grâce au GPS et à des indices. C’est là que l’on voit l’approche patrimoniale qui peut être faite de la pratique, par la description des lieux, le placeur de la géocache participe de sa mise en mot, de sa valorisation et du changement de regard envers ce lieu. En revanche, l’absence de critères patrimoniaux et l’absence de protection limite le processus de patrimonialisation. Mais la dimension sensible qui en résulte se retrouve également dans l’approche territoriale du geocaching. En effet, il est rapidement visible que des territoires de géocaches apparaissent avec les différents placeurs. À une échelle plus fine, la création toponymique participe de la création de lieux (exemple de « L’église désertique de la Combe »).
Si les territoires paraissent à première vue cloisonnés, une véritable communauté se met en place avec des « Events » (évènements) et avec certains objets « de valeur » comme les objets voyageurs, allant de géocache en géocache. Cette communauté est de plus en plus instrumentalisée par les différentes affiches éditées par l’entreprise Groundspeak Corporation. On voit sur celles-ci la logique de front pionnier telle que valorisée par les pratiquants (itinéraires dessinés par ceux-ci), et entrant dans la logique des fronts pionniers de certaines élites occidentales comme le montre André Suchet en 2010. Cette logique n’étant pas visible que dans le « geocaching vert » visible sur les affiches, mais également dans les villes comme à Chambéry. C’est ainsi que de plus en plus, certaines communautés de communes et certains offices du tourisme récupèrent de plus en plus des géocaches (ainsi que leurs placeurs) afin de valoriser leur territoire de travail. Ceci devenant alors un problème pour certains pratiquants car voulant justement se défaire des logiques institutionnelles. Des conflits d’acteurs commencent ainsi à apparaître et à questionner l’avenir de la pratique du geocaching.
Thomas Matheret, agrégé de Géographie, Université Savoie Mont Blanc
ZAD en état de résistance et jeux d’acteurs, dans le Center Parcs de Roybon
Lancé en 2007, le projet du Center Parcs situé à Roybon (Isère) fait face depuis dix ans à une bataille juridique sans fin. Le projet consiste en un aménagement d’un nouveau pôle touristique au cœur de 200 hectares de forêt et 76 hectares de zones humides. En s’implantant dans la commune rurale de Roybon faisant face à une désertification des services de proximité et des difficultés économiques, le groupe promet la création de nombreux emplois ainsi que de développer le tourisme dans la partie ouest du département de l’Isère.
Si ce projet est soutenu par l’ensemble des collectivités locales et une partie de la population roybonnaise, il est cependant intensément contesté par des opposants locaux ainsi que des associations de défense de l’environnement. En effet, dans un contexte territorial complexe, l’opposition rencontrée par le groupe Pierre & Vacances – Center Parcs est forte. La destruction d’une partie de la forêt et de la zone humide induit une forte protestation de la part des opposants. Par ailleurs, ce conflit d’aménagement s’inscrit dans un contexte national où d’autres projets d’aménagement ont été remis en cause.
L’apparition d’une Zone À Défendre sur le site du projet en 2014 intensifie le conflit, avec cette radicalisation de la contestation qui met à mal le projet bloquant les travaux. À l’instar de Notre-Dames-Des-Landes et aujourd’hui d’Europacity, les opposants espèrent ainsi faire annuler le projet. Toutefois, la ZAD soulève aussi un nouveau questionnement, est-elle ici simplement pour défendre l’environnement ou alors pour défendre un nouveau mode de vie en marge de la société, loin des normes sociales ?
Axelle Egon, Master 1 Géographie et Aménagement, Université Savoie Mont Blanc