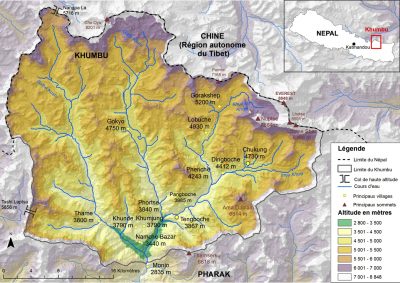Les Cafés Géo de Lyon accueillent le 5 avril 2017 Michel Lussault, professeur de géographie et d’études urbaines à l’ENS de Lyon, chercheur à l’UMR 5600 Environnement Ville Société, directeur de l’Institut français de l’Éducation. Les quatre livres L’homme spatial, De la lutte des classes à la lutte des places, L’avènement du monde et Hyper-lieux doivent être lus ensemble. Hyper-lieux clôt ce cycle. Ces livres s’inscrivent dans la continuité d’un colloque co-organisé avec J. Lévy sur les « Logiques de l’espace, esprit des lieux. Géographies à Cerisy », dont les actes ont été publiés en 2000.
Deux fils directeurs irriguent ces travaux :
- La volonté de comprendre la mondialisation sans la réduire à la globalisation économique. Il ne s’agit pas de nier la globalisation économique. La mondialisation est rattachée à l’urbanisation généralisée du monde avec des conséquences sur l’espace et sur l’individu. Les hyper-lieux sont des « prises » de la mondialisation : la mondialisation s’y met en jeu, en scène, en exergue.
- L’individu comme acteur spatial. L’individu agit avec l’espace, quand les sociétés organisent leur espace. Le point de départ est donc des individus à l’épreuve de l’espace. Exister c’est régler les problèmes que l’espace nous pose, dans les traces de Perec (« vivre c’est passer d’un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner»). L’accent est souvent mis sur le temps qui nous contraint en tant qu’être fini, mais il s’agit ici de mettre la lumière sur notre relation à l’espace.
Comprendre un individu passe par la manière d’organiser son espace de vie au quotidien, qui se heurte à trois types d’épreuves.
- La première épreuve est la distance. Tout individu doit régler au quotidien doit régler ses rapports de distance avec autrui, les objets et les non-humains. Le cinéma burlesque trouve un de ses ressorts comique dans la tension entre proche et lointain : le mauvais rapport de distance entraîne un comique de situation.
- La deuxième épreuve spatiale est l’épreuve du placement. Ne pas savoir se placer a pu poser par exemple des problèmes de bienséance, qui est étymologiquement l’art de bien se tenir assis.
- La troisième épreuve spatiale est le franchissement : il s’agit de savoir traverser les seuils, les sas, les frontières…
Pour un migrant, ces trois épreuves, dans les espaces publics et privés, peuvent permettre d’assurer la survie.
Hyper-lieux prend naissance dans une perplexité, ressentie à différentes lectures.
- Dans le monde est plat, Thomas Friedman étudie des vecteurs d’aplatissement du monde, c’est-à-dire d’une standardisation ou d’une homogénéisation du monde. Or la géographie étudie la différenciation spatiale.
- De plus, Zygmunt Bauman a théorisé la société liquide : tout circule tout le temps, tout coule, plus rien ne s’arrête, c’est une société sans ancrage, l’espace disparaît, la matière s’efface, la prise matérielle n’est plus là. Pourtant, les géographes voient que les rugosités n’ont pas disparu.
- Marc Augé dans Non-lieux montre que les espaces fonctionnels liés à la nécessité de la mondialisation se multiplient, mais sans authenticité de l’expérience humaine : il en fait des espaces d’aliénation, en opposition à la demeure ou à la maison (le lieu anthropologique). Comme exemples de non-lieux, il cite les gares, les aéroports, les grands centres commerciaux : l’expérience est alors uniquement fonctionnelle.
Et si le non-lieu était en fait un « lieu mal observé » ? Le processus d’homogénéisation existe : il y a une tendance à la standardisation. Mais un travail de terrain montre un regain d’importance des individus dans l’expérience au lieu. La standardisation n’est pas aussi claire : le rapport au lieu des individus n’a peut-être jamais aussi été important.