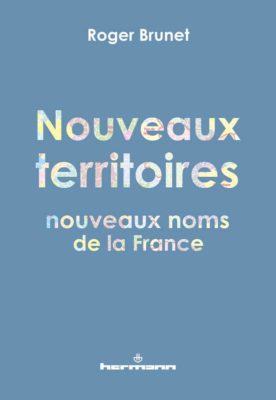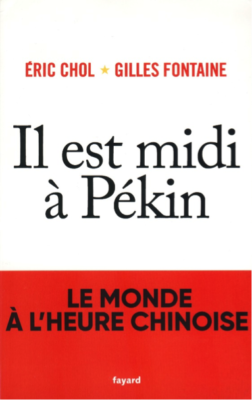
Éric Chol, Gilles Fontaine, Il est midi à Pékin, Fayard 2019
La Chine nous fascine depuis toujours. Les titres d’ouvrages qui lui sont consacrés en témoignent : Quand la Chine nous précédait, Quand la Chine s’éveillera, etc. Aujourd’hui, nul ne l’ignore, la Chine veut redevenir l’empire du Milieu. Elle veut effacer les « 150 années d’humiliations » (1799-1949) vécues sous les dominations coloniales des Occidentaux et des Japonais.
Le 1er octobre 1949, est proclamée la République Populaire de Chine. Pékin retrouve son statut de capitale et pour assurer l’unité nationale, Mao Zedong décide de supprimer les 5 fuseaux horaires en vigueur depuis 1912, au profit d’un seul, celui de Pékin. Actuellement, une même pendule règle la vie quotidienne de 1,4 milliard de Chinois sur les 5 000 km d’Est en Ouest de l’empire du Milieu.
Xi Jinping l’affirme : « Les pays qui ont tenté de poursuivre leurs objectifs de développement par l’usage de la force ont échoué. C’est ce que l’histoire nous a appris. La Chine s’est engagée à maintenir la paix et à construire une communauté de destin pour l’humanité ».
Ces paroles, brutales, illustrent la volonté du Dragon, aujourd’hui bien éveillé, de rattraper puis de dépasser la puissance des Etats-Unis. (suite…)




 Géopolitique de l’art contemporain. Une remise en cause de l’hégémonie américaine ? Nathalie Obadia, Le Cavalier Bleu, 2019.
Géopolitique de l’art contemporain. Une remise en cause de l’hégémonie américaine ? Nathalie Obadia, Le Cavalier Bleu, 2019.