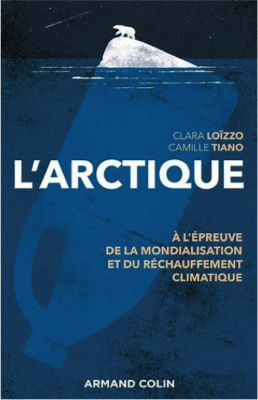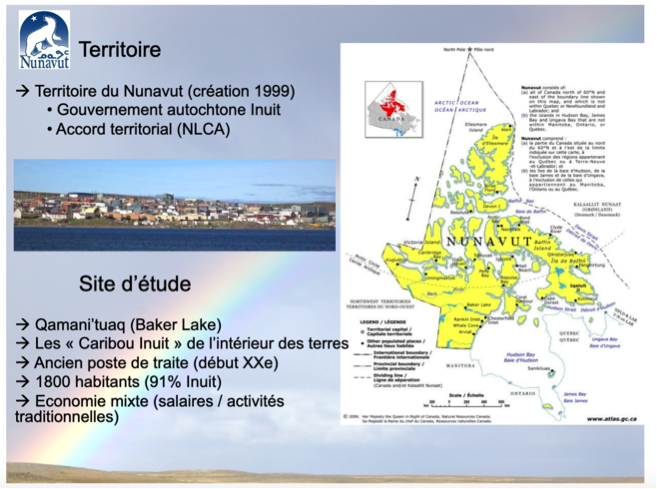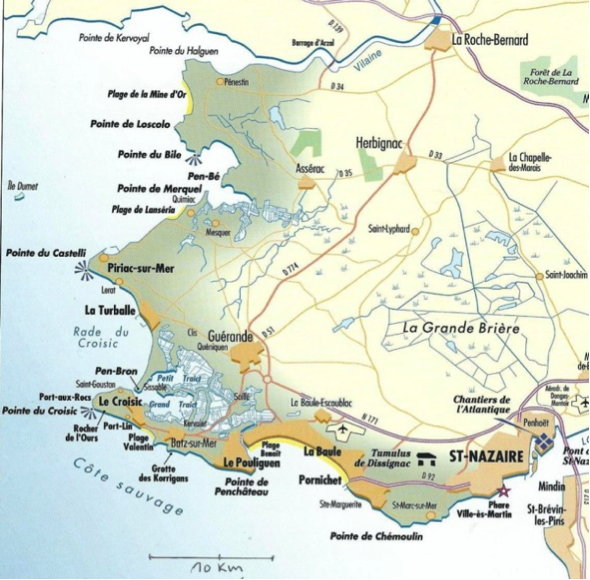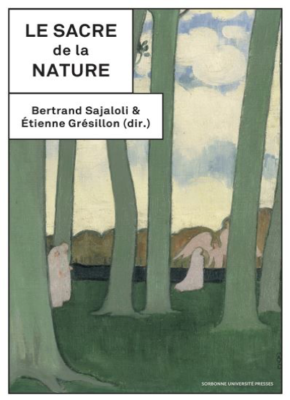
SAJALOLI Bertrand et GRESILLON Etienne (dir.), Le Sacre de la Nature, Paris, Sorbonne Université Presses, 2019
Titre et image de couverture (le détail d’un tableau de Maurice Denis) peuvent tromper le futur lecteur sur la nature de l’ouvrage. Réflexion philosophique, esthétique, religieuse ? C’est aussi cela, mais c’est avant tout un ouvrage collectif dirigé par deux géographes spécialisés dans les relations entre homme et nature, entre religion et écologie.
Le livre paraît après un été caniculaire qui a redonné force et arguments aux mouvements écologistes qui prédisent l’apocalypse, et la consécration de Greta Thunberg comme icone mondiale de la défense planétaire. On pourrait donc évoquer un livre d’actualité. Mais l’objectif de Bertrand Sajaloli et d’Étienne Grésillon est d’appréhender les liens entre nature et sacré dans leur profondeur historique et leur diversité culturelle et géographique. Pour cela ils ont fait appel à plusieurs spécialistes des sciences humaines et même à des théologiens et ont demandé une préface à un historien qui a consacré son travail aux spiritualités médiévales, André Vauchez. Ce dernier définit bien la « nature » comme « construction sociale », mais ni la préface ni l’introduction des deux directeurs de publication ne donnent de définition approfondie des termes « sacré » et « nature »… En fait, il faut les 370 pages de l’ouvrage pour essayer de cerner leur(s) signification(s) dans le temps et dans l’espace.
L’ouvrage qui a réuni les communications de vingt-neuf auteurs, est découpé en trois parties dont la première traite de la place de la nature dans les principales religions et pratiques sacrées. Mais c’est essentiellement le christianisme qui est au cœur de la réflexion, parfois confronté au monde religieux gréco-romain, les autres univers religieux ne sont évoqués qu’incidemment.
Si on peut clairement distinguer une nature, incréée, imprégnée de sacralité chez les Anciens, de la Création biblique fortement anthropocentrique où le sacré est banni du quotidien, les approches de la nature ont varié au sein même de christianisme. (suite…)